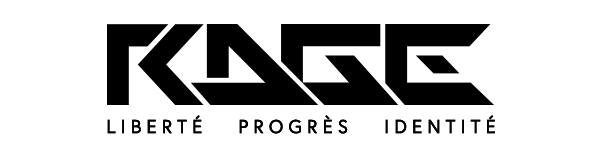Dans une interview donnée à Rick Beato, Steven Wilson – auteur-compositeur et multi-instrumentiste de musique progressive – disait être fasciné par les compositeurs et réalisateurs depuis très jeune, et savait que lui aussi souhaitait incarner le capitaine à bord. Ce rôle, selon lui, serait de disposer et de promouvoir une vision, de la représenter, et, en gros, de suffisamment bien s’entourer pour la mettre à exécution. Je pense que ces propos ne sont pas anodins, et qu’ils reflètent des enjeux, une réalité et un idéal de philosophie politique qu’il me démange de décortiquer.
Tout est monarchie
Steven Wilson est beaucoup de choses, mais probablement pas un néoréactionnaire. Pourtant, ces mots qu’ils prononcent raisonnent dans les oreilles de ceux qui connaissent les écrits de Curtis Yarvin. Pour celui anciennement connu sous le nom de Mencius Moldbug, toute chose fonctionnelle est le fruit d’une monarchie. Votre voiture, votre téléphone, votre logement, votre pain sont tous fruits de structures pyramidales au sommet desquelles quelqu’un choisit et donne de manière quasi-univoque une direction absolue à suivre. Il en va de même pour une grande partie des films et albums que vous consommez, y compris ceux de notre cher Steven, du coup.
Donc, pourquoi est-ce que je crois en la monarchie ? Il y a une réponse très simple à cette question, qui est que tout ce qui est fonctionnel dans notre société est géré comme une monarchie. Si vous conduisez une voiture, cette voiture a été construite par une monarchie, car elle a été construite par une société avec un PDG. Si vous mangez dans un restaurant, c’est la même chose, il y a un chef cuisinier. Maintenant, ce PDG et ce chef cuisinier peuvent être responsables de manières particulières, le PDG est responsable devant un conseil d’administration, le chef cuisinier est responsable devant le propriétaire du restaurant, mais c’est toujours une monarchie parce que cette responsabilité ne se transforme pas en microgestion. Le conseil d’administration ne microgère pas le PDG, le CA veut que le PDG produise des résultats efficaces.
Curtis Yarvin (2022), Curtis Yarvin on the Monarchy as the way to be.
En partant de là, les monarchies sont nombreuses, et en réalité, elles nous entourent ; elles constituent l’essentiel des structures sociales productives qui nous entourent. Et effectivement, ce qui frappe, c’est leur nombre – mais c’est surtout ce qui fait leur force ; nous y reviendrons.
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
L’erreur de Popper
Un problème avec la monarchie en tant que modèle politique demeure la préoccupation popperienne concernant les mécanismes de la correction des erreurs, qui lui manquerait, ce qui peinerait à en faire un système d’organisation sociale durablement fonctionnel et efficace. Selon lui, un bon système politique – tout comme un bon système de création de la connaissance, c’est-à-dire, la science – est un système faillibiliste, autrement dit, qui soit capable de corriger les erreurs.
[La question] « Qui doit gouverner ? » […] appelle une réponse autoritaire telle que « le meilleur », ou « le plus sage », ou « le peuple », ou « la majorité ». […] Cette question politique est mal posée, et les réponses qu’elle suscite sont paradoxales. Elle devrait être remplacée par une tout autre question telle que : « Comment organiser nos institutions politiques pour que les gouvernants mauvais ou incompétents […] ne puissent pas faire trop de dégâts ? ». Je crois que ce n’est qu’en modifiant ainsi notre question que nous pouvons espérer avancer vers une théorie raisonnable des institutions politiques.
Karl Popper (1960), Knowledge without Authority.
La question des sources de nos connaissances peut être remplacée de manière similaire. Elle a toujours été posée dans l’esprit suivant : « Quelles sont les meilleures sources de notre savoir – les plus fiables, celles qui ne nous conduiront pas à l’erreur, et celles vers lesquelles nous pouvons nous tourner, en cas de doute, comme dernière cour d’appel ? » Je propose de supposer, au contraire, qu’il n’existe pas de telles sources idéales – pas plus que de gouvernants idéaux – et que toutes les « sources » sont susceptibles de nous conduire parfois à l’erreur. Et je propose de remplacer, par conséquent, la question des sources de notre connaissance par une question entièrement différente : comment pouvons-nous espérer détecter et éliminer l’erreur ?
De la même manière qu’un Churchill qui dira que la démocratie est le pire des régimes politiques à l’exception de tous les autres, ce que dit Popper, et ce qu’il fait de lui un démocrate, c’est que cette dernière serait la moins pire de toutes à corriger les erreurs, c’est-à-dire qu’elle dispose de la capacité à changer les gouvernants par une boucle de rétroaction négative que seraient les élections.
Là où Popper a raison dans son diagnostic, c’est que le seul véritable progrès qui puisse exister ne pourrait naïvement se faire sans processus d’essai-erreur, et qu’il faille donc, véritablement, un système qui permette de corriger les erreurs, et qu’elles ne soient pas graves. La psychologie des représentations naïves qui ne partent pas de ce principe est parfaitement illustrée par ces propos de David Deutsch :
L’induction, l’instrumentalisme, et même le Lamarackisme font tous la même erreur : ils supposent un progrès sans explications. Ils supposent que les connaissances soient crées par décret avec peu d’erreurs, et non par un processus de variation et de sélection qui constitue un flux continu d’erreurs et des corrections subséquentes.
David Deutsch (2011), The Beginning of Infinity.
Là où, en revanche, il n’apporte pas de réponse – contrairement aux véritables libertariens et néoreactionnaires – c’est qu’il faille que le système politique en question permette en pratique que des erreurs puissent être détectées, afin que de nouvelles solutions et corrections soient implémentées. Et c’est précisément cela dont la démocratie n’est pas capable. Des élus financièrement irresponsables de leurs actions peuvent prendre des mauvaises décisions des mandats durant, et des institutions indépendantes de toute concurrence ne cessent jamais de voir leurs coûts augmenter et leur qualité diminuer.
Là où le marché est une structure qui, par le système de prix, permet de donner une information aux individus sur les coûts et bénéfices de chacune des actions, et, par le libre choix de consommation des biens et services par les consommateurs, permet d’entretenir plusieurs systèmes parallèles, la démocratie ne dispose d’aucun indicateur permettant d’évaluer la réussite ou l’échec d’un système politique imposé à tous. Le marché demeure le système qui soit le meilleur dans l’arrangement de fourniture de biens et services.
Les consommateurs ne déterminent pas seulement en dernier ressort les prix des biens de consommation, mais tout autant les prix de tous les facteurs de production. Ils déterminent le revenu de chaque membre de l’économie de marché. Les consommateurs, non pas les entrepreneurs, paient en définitive ce que gagne chacun des travailleurs, que ce soit la vedette illustre ou la femme de ménage. Chaque franc dépensé par les consommateurs détermine la direction de tous les processus de production et des détails d’organisation de toutes les activités professionnelles. Cet état de choses a été décrit en appelant le marché une démocratie où chaque pièce de monnaie représente un droit de vote. Il serait plus exact de dire qu’une constitution démocratique est une combinaison qui cherche à donner au citoyen, dans la conduite du gouvernement, la même souveraineté que l’économie de marché leur donne en leur qualité de consommateurs. Néanmoins, la comparaison est imparfaite. En démocratie politique, seuls les votes émis en faveur du candidat ou du programme qui a obtenu la majorité ont une influence sur le cours des événements politiques. Les votes de la minorité n’influent pas directement sur les politiques suivies. Tandis que sur le marché aucun vote n’est émis en vain. Chaque franc dépensé a le pouvoir d’agir sur les processus de production. Les éditeurs ne travaillent pas seulement pour la majorité qui lit des histoires policières, mais aussi pour la minorité qui lit de la poésie ou des essais philosophiques. Les boulangeries ne font pas seulement du pain pour les bien-portants, mais aussi pour les gens malades ou soumis à un régime médical. La décision d’un consommateur est mise à exécution avec toute la force qu’il lui imprime en décidant de dépenser une certaine quantité de monnaie.
Ludwig von Mises (1949), L’action humaine (Chapitre XV, partie 4).
Non, un bon système n’est pas celui qui permet de retirer les mauvais dirigeants. Un bon système est un système duquel il est possible de se retirer. Un mauvais système peut demeurer mauvais quand bien même ses pilotes changent. La démocratie ne permet pas de sortie, là où le marché permet de servir une multiplicité de besoins parallèles.
Horreur
Augmentée
Sélection de textes de
Zero HP Lovecraft
Horreur
Augmentée
Sélection de textes de
Zero HP Lovecraft
Monarchie fonctionnelle
Si Yarvin a raison, et que tout ce qui fonctionne est une monarchie, alors va pour la monarchie. En fait, va pour n’importe quel système. Ce qui est important, c’est que la sécession demeure une possibilité, ou plutôt, une norme. Que la taille des systèmes ne soit pas une barrière à la sortie est le plus important puisque c’est le « vote avec les pieds » qui permet le mieux d’envoyer un signal positif ou négatif au gouvernement, plus que l’urne.
Quand bien même Yarvin avait tort sur ce point – ou encore sur l’importance pour les actionnaires de l’Etat néocaméraliste de détenir des clés cryptographiques pour exercer leur pouvoir de décision en toute sécurité – il a raison sur le point le plus important lorsqu’il mentionne le modèle du Patchwork comme un idéal vers lequel tendre : le droit à la sortie, c’est-à-dire à la sécession, aboutirait en un grand nombre de systèmes politiques fragmentés, donc multiples ou particulièrement décentralisés. Ce que je reprocherais, en conséquence, aux idées de Yarvin, c’est qu’elles soient si superfétatoire aux idées réellement libertariennes, et qu’elle n’en restent qu’une interprétation plus « concrète » possible.
Yarvin a peut-être raison. Peut-être que tout ce qui est fonctionnel est une monarchie. Mais ce qui fait que Steven Wilson est un monarque à la tête d’un système artistique fonctionnel et efficace, c’est que ses sujets et collaborateurs veulent être sous son règne et consentent à le faire. Tout ce qui est fonctionnel est une monarchie dans son processus de fonctionnement uniquement, indépendamment des liens qui unissent les individus dans ce système. Ils doivent être unis par-delà le système politique, par un vouloir vivre-ensemble, tout en ayant la possibilité de ne pas le faire.
Le vouloir vivre-ensemble, ou la nation par consentement
C’est ce qu’avait très bien compris Ernest Renan. Selon lui, une nation est un groupe de personnes qui partagent une histoire commune, une culture commune et un sentiment d’appartenance commun.
Pour Renan, la nation n’est pas simplement un concept politique, mais surtout un phénomène culturel et psychologique ; elle résulte de l’interaction entre les individus au sein d’une communauté. Il soutenait que la nation était fondée sur un consensus implicite entre les membres de ladite communauté qui acceptaient de vivre ensemble et de partager une certaine vision du monde relevant d’une expérience commune. Selon lui, la nation est le résultat de l’action humaine et de la volonté de vivre ensemble, non pas le résultat d’autres facteurs plus déterministes.
Renan soulignait également l’importance d’une volonté générale de faire de grandes choses ensemble dans sa définition de la nation. Selon lui, elle est est une communauté de destin, un groupe de personnes liées par une volonté de coopération et de collaboration, qui ont un projet commun et qui sont prêtes à travailler ensemble pour le réaliser, et ainsi faire avancer la communauté dans son ensemble. Cette idée de coopération et de collaboration souligne l’importance de la solidarité et de l’esprit de communauté dans la construction et le maintien de la nation.
Cette vision, Renan l’a notamment synthétisée dans sa conférence intitulée « Qu’est-ce qu’une nation ? », prononcée en 1882 à l’Université Sorbonne :
Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. L’homme, Messieurs, ne s’improvise pas. La nation, comme l’individu, est l’aboutissant d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j’entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu’on a consentis, des maux qu’on a soufferts. On aime la maison qu’on a bâtie et qu’on transmet. Le chant spartiate : « Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes » est dans sa simplicité l’hymne abrégé de toute patrie.
[…] Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a fait et de ceux qu’on est disposés à faire encore. Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de vie. Oh ! Je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu historique. Dans l’ordre d’idées que je vous soumets, une nation n’a pas plus qu’un roi le droit de dire à une province : « Tu m’appartiens, je te prends ». Une province, pour nous, ce sont ses habitants ; si quelqu’un en cette affaire a droit d’être consulté, c’est l’habitant. Une nation n’a jamais un véritable intérêt à s’annexer ou à retenir un pays malgré lui. Le vœu des nations est, en définitive, le seul critérium légitime, celui auquel il faut toujours en revenir.
Nous avons chassé de la politique les abstractions métaphysiques et théologiques. Que reste-t-il, après cela ? Il reste l’homme, ses désirs, ses besoins. La sécession, me direz-vous, et, à la longue, l’émiettement des nations sont la conséquence d’un système qui met ces vieux organismes à la merci de volontés souvent peu éclairées. Il est clair qu’en pareille matière aucun principe ne doit être poussé à l’excès. Les vérités de cet ordre ne sont applicables que dans leur ensemble et d’une façon très générale. Les volontés humaines changent ; mais qu’est-ce qui ne change pas ici-bas ? Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel. Elles ont commencé, elles finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons. À l’heure présente, l’existence des nations est bonne, nécessaire même. Leur existence est la garantie de la liberté, qui serait perdue si le monde n’avait qu’une loi et qu’un maître.
[…] L’homme n’est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s’appelle une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu’exige l’abdication de l’individu au profit d’une communauté, elle est légitime, elle a le droit d’exister. Si des doutes s’élèvent sur ses frontières, consultez les populations disputées. Elles ont bien le droit d’avoir un avis dans la question. Voilà qui fera sourire les transcendants de la politique, ces infaillibles qui passent leur vie à se tromper et qui, du haut de leurs principes supérieurs, prennent en pitié notre terre-à-terre. « Consulter les populations, fi donc ! Quelle naïveté ! Voilà bien ces chétives idées françaises qui prétendent remplacer la diplomatie et la guerre par des moyens d’une simplicité enfantine ».
Ernest Renan (1882), Qu’est ce qu’une Nation ?
Le droit du consommateur – puisque citoyen d’un Etat privé – à la sortie, à la défection appliqué à la politique, permettra une cristallisation des identités autour d’une volonté commune, et donc d’une identité, d’une appartenance en poupée russe, de la ville à la civilisation, en passant par la nation. L’idée de la décentralisation libertarienne de propriété privée n’est pas une idéologie hors-sol prônant un certain déracinement et un globalisme mal compris. C’est une compréhension double d’une verticalité consentie (contractuellement au moins) horizontalement (parce que plurielle). Cette décentralisation est, en plus, coopérante, le protectionnisme – et, de surcroît, l’autarcie – devenant progressivement impossible pour des entités à la superficie décroissante.
Au final, le système politique qu’il siéra le plus aux humains est celui d’un vivre-ensemble responsable financièrement, autrement dit, celui dans lequel choisir de ne pas vivre avec et pour certains autres est possible.
Cet article vous a plu ? Soutenez-nous sur Tipeee