Quand on parle de la République romaine, on pense droit, Etat, urbanisme planifié de marbre blanc. On pense également magistrats, tribunaux, légions, bref, on pense aux institutions. Mais les institutions de la République romaine étaient occupées par des hommes, dont il est nécessaire de comprendre l’identité pour que celles-ci ne restent pas des constructions abstraites comme suspendues hors du temps et de la société leur ayant donné naissance, décrites comme le ferait un Mommsen. Expliciter sur quoi reposait la vie de ces hommes, c’est-à-dire leur identité, et expliquer par quels moyens ils agissaient au quotidien, et donc par quels moyens les institutions fonctionnaient concrètement, d’homme à homme. L’individu romain comportait trois composantes essentielles. Premièrement, les liens personnels formaient un réseau entre citoyens tel qu’il permettrait de se passer de bureaucratie publique pour faire œuvre collective tout en donnant à la cité antique, le corps des citoyens, une existence concrète face à l’oliganthropie. Deuxièmement, la religion rituelle des Romains fondait cette identité civique en donnant l’occasion de la pratiquer. Troisièmement, la petite patrie qu’était la cité locale doublait la patrie romaine en garantissant une force civique localement, au plus près des hommes, dans l’Urbs ou hors d’elle.
Dans ce premier article, nous allons nous intéresser aux réseaux personnels sous-tendant la République romaine.
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
L’homme romain était caractérisé par un réseautage à outrance, du haut au bas de l’échelle sociale. Ces systèmes personnels permettaient de résoudre les problèmes, publics comme privés, sans bureaucratie publique faisant écran entre les citoyens et le politique, mais plutôt en mobilisant son carnet d’adresses personnel. Ces liens personnels étaient donc au fondement de la cité en donnant une existence concrète et pas seulement idéologique au corps des citoyens.
- La famille
Le premier réseau du citoyen était la famille, qui était le pilier de la cité. La famille romaine n’était pas une conception sentimentale, ou en tout cas pas seulement, mais était surtout une cité miniature à laquelle on n’avait pas le choix d’appartenir ou pas. Ce réseau familial avait donc de fortes implications politiques et religieuses.
Cette importance accordée à la famille, symbolisée par le fait qu’un homme sans enfant était dans le cens le plus bas, s’expliquait par trois fondamentaux de la pensée romaine.
D’abord, la peur fondamentale de la cité antique était l’oliganthropie, c’est-à-dire la dissolution du corps civique face aux Autres par déclin démographique. Rappelons que ces Autres étaient les 20 à 30% de démunis totaux vivant dans les nécropoles, cimetières au bord des routes, aux alentours des cités. Ces déchettivores, qui étaient plus miséreux que le plus bas des plébéiens et que les esclaves, attaquaient les voyageurs isolés. Les escortes d’honneur des magistrats et des hommes illustres pour rentrer et sortir des villes prenaient alors une toute autre dimension. Vivant totalement hors de la cité, plus bas même que les esclaves disposant au moins d’un statut légal, leur mort ne semblait pas avoir la moindre importance. Une borne fut retrouvée portant l’inscription « Défense de jeter ici les excréments et les cadavres ». Une analogie moderne serait que 30% de la population vive sans identité légale aucune dans les souterrains des métros, attaquant les rames isolées.
Le second point fondamental était que dans le monde des cités classiques, la famille était le moyen standard d’avoir un ersatz d’immortalité. Deux possibilités étaient disponibles, soit on était un héros restant dans les mémoires, soit on restait sur Terre en vivant au travers de ses enfants, élevés pour nous ressembler, par les valeurs et le sacerdote familial transmis.
Enfin, les grandes familles n’étaient rien sans la cité, qui n’était elle-même rien sans elles. Le prestige des gens reposait sur la reconnaissance par les concitoyens, conception indo-européenne de reconnaissance de la bravoure au combat dont étaient témoins les camarades, et sans les gens, la cité n’aurait ni les sénateurs ni les hommes glorieux que les gens produisaient à la chaîne. Remarquons que l’exigence du maintien et de l’accroissement de la majesté du Peuple romain par l’action de ces hommes glorieux donnait aux gens une importance particulière.
Le magistrat de la petite cité familiale était le pater familias.
Il était d’abord un chef politique, dont il possédait les deux principaux attributs. Il représentant la faille légalement comme le magistrat représentant la cité. En effet, les autres membres de la famille étaient en minorité légale tant qu’il était en vie. Concrètement, un fils devait demander l’autorisation du père pour toute démarche légale, même s’il était marié et consul, son mariage comme son élection ayant par ailleurs été soumis à son approbation. Le deuxième attribut, outre la représentation, était l’application des lois dans la petite cité, qui était autant un droit qu’un devoir. Le Pater Familias était contraint de les appliquer à sa famille sous peine d’être lui-même condamné en plus des proches qu’il aurait voulu épargner. Les lois portaient principalement sur les mœurs, et les plaintes pouvaient être déposées par n’importe qui, un censeur s’occupant des investigations. Par exemple, l’adultère d’une fille était puni de mort.
En plus de ce rôle politique, le Pater Familias était un chef religieux. Remarquons que les magistrats de Rome avaient également des pouvoirs religieux et que les prêtres étaient des magistrats. Le chef de famille portait la responsabilité de la perpétuation et de la transmission du sacerdoce familial, un culte domestique similaire au culte civique. Les dieux domestiques étaient principalement des génies familiaux, sources de réussite et de prestige, et des démons, dont les Lémures, les Mânes et les Larves envahissant les maisons lors des Lémuries. Le Pater Familias avait alors pour mission de maîtriser sa peur pour les chasser, tout comme le prêtre de la cité maîtrisait ses émotions face aux dieux, comme un homme romain devait le faire.
En raison de ce double rôle, le Pater Familias devait être un homme d’âge mûr. Il imposait son pouvoir public face à sa femme, qui avait vingt ans de moins que lui car un homme de trente-cinq ans se mariait généralement à une jeune fille de quinze ans, mais aussi à ses fils. Ceux-ci atteignaient trente-cinq ans, âge de mariage et donc d’indépendance, quand le Pater Familias en avait soixante-cinq, alors proche de la retraite de la vie publique et de la mort. Un Pater Familias plus jeune aurait été insupportable pour un fils désirant entrer dans la vie publique mais étant maintenu en minorité, ce qui aurait abouti à des parricides nombreux.
La matrone romaine, moins femme du Pater Familias que mère de ses enfants, avait le monopole du pouvoir domestique, le Pater Familias n’interférant pas, occupé qu’il était par son rôle public. Son pouvoir sur la domus était symbolisé par le trousseau de clefs qui lui appartenait. Son pouvoir privé était garanti contre tout empiètement illégitime du Pater Familias par son réseau personnel. Parlant quotidiennement aux autres matrones qui discutaient avec leur mari, elle pouvait porter atteinte à la réputation de son mari. A Rome, où tout était apparence et prestige, l’affaire montait jusqu’aux censeurs, garants du respect sous peine de déclassement. Non, la matrone romaine, la mère, n’était pas une femme battue.
L’entrée dans cette famille dipolaire était à Rome un acte politique, comme l’admission dans le corps des citoyens en était un, et en cela, elle concernait la cité et ses jeux de pouvoir tout entier. Le mariage était toujours arrangé pour lier des gentes dans des alliances. La mort d’une femme avait de graves conséquences, rompant une alliance si un autre mariage n’était pas organisé. Sylla abdiqua juste après que sa femme Metella, garante de l’alliance avec la grande famille des Metellii, mourût. Était-ce une coïncidence ou un message transmis à Sylla de la défection des familles nobles de Rome ? Certains hommes poussèrent le jeu d’alliances par mariage à l’excès. Caton l’Ancien se maria trois fois et Caton le Jeune prêta sa femme à un ami pour qu’elle lui fasse un enfant, divorçant et se remariant peu après avec elle. L’adoption, toujours d’un homme d’une gens de prestige équivalent, permettait de gagner un fils afin de garantir le prestige de la lignée, notamment en cas de défaut de fils biologique suite à des morts par malchance. Il était admis que le fils en question puisse avoir le même âge que le Pater Familias, l’utilité étant alors que la lignée et le nom se perpétue au travers de sa descendance en dépit de la rupture du lien de sang. Le phénomène de l’adoption était non négligeable numériquement. A Pompéi, 4% des consuls et 10% des magistrats étaient des adoptés.
- L’amitié et la clientèle, des réseaux de bienveillance
Le deuxième réseau des citoyens était celui des relations de bienveillance sans échange, fondées sur l’art de donner et de recevoir, les liens étant garantis par la valeur la plus haute pour les Romains, la fides divinisée, la Confiance.
Deux conséquences de ce système étaient exploitées à fond par l’homme romain. La première, individuelle, était que ces réseaux étaient l’unique rempart contre les attaques imprévues. Même défait par une surprise ou un coup du sort, il était possible d’être aidé gracieusement par son réseau pour se relever, les aidants attendant bien sûr la même chose quand eux seront confrontés à des difficultés inattendues. La seconde était collective. En tant que peuple de la Fides, les Romains méritaient une place exceptionnelle dans ce monde. Concrètement, Rome disposait toujours d’un prétexte pour intervenir quelque part en guerre juste, à savoir qu’un peuple avait manqué de fides envers un allié de Rome, voire pire envers Rome elle-même. Le peuple perfide devait alors être réorganisé en peuple de confiance au cas par cas par des provinces. Ainsi, la politique à Rome devenait l’affrontement de réseaux soudés par la Fides, groupes d’amis et clientèles.
A Rome, il était essentiel d’avoir des amis, comme partout et en tout temps me direz-vous. Peut-être, mais à Rome, l’amitié était un fait objectif, pas nécessairement fondé sur les sentiments ou l’utilité du moment. Ainsi, on pouvait hériter d’une amitié comme on héritait de biens, les descendants d’amis étant automatiquement amis même s’ils ne s’étaient jamais rencontrés. Nous savons que Scipion partit combattre Carthage en Espagne accompagné de cinq cents amis, alors qu’un être humain ne peut connaître personnellement que cent quatre-vingts personnes en moyenne. L’amitié était alors un fait d’égalité entre deux personnes, impliquant une bienveillance réciproque :
« Qui peut être assez opulent, ou l’avoir été pour que sa fortune puisse rester entière sans que ses amis lui rendent de nombreux services ? Et ces services, si l’on en supprimait le souvenir et la reconnaissance, ne sauraient exister. Quant à moi, je considère que rien n’est aussi caractéristique de l’être humain que de se sentir lié non seulement par un bienfait, mais par un témoignage de bienveillance, et rien n’est plus contraire à l’humanité, plus monstrueux, plus sauvage que de se mettre dans le cas de sembler, je ne dis pas indigne d’un bienfait mais incapable de le rendre ».
Celle-ci se révélait pratique en politique où la force se mesurait au nombre et à la réussite de ses amis. Ceux-ci formaient un cortège électoral de gens de bien, envoyaient des lettres de recommandation et accordaient un soutien politique direct, tel Cicéron pour son ami Pompée. En politique extérieure, la pratique de l’hospitalité était l’équivalent de l’amitié avec les notables étrangers, notamment les rois, très utile comme pratique diplomatique, une alliance informelle.
La clientèle était une relation comparable mais cette fois-ci fondée sur l’inégalité entre le patron et le client. Les réseaux de clientèle étaient particulièrement entretenus par la nobilitas cherchant à intégrer la plèbe à ses jeux politiques, dans le but de prévenir l’alliance entre les bas citoyens et les Autres, le tiers de marginaux absolus des nécropoles de Rome. Sous la République, cette alliance honnie, hantise de la noblesse de fonction, fut toujours prévenue, pour le meilleur. Le patron offrait au client une super mutuelle, avec assistance juridique, il le défendait lors de procès, services sociaux, il exerçait son influence pour lui obtenir des remises de dette et de loyers, agence matrimoniale, il utilisait le mariage du client comme occasion de placer un pion dans le jeu des familles, et filet de secours privé. Le patron recevait également quotidiennement ses clients dans sa maison pour prendre leurs demandes :
« Il faut en effet que la dignité d’un personnage soit réhaussée par sa maison, mais ce n’est pas de sa maison qu’il doit attendre toute sa dignité ; ce n’est pas non plus la maison qui doit honorer le maître, mais le maître la maison. De même que dans les autres domaines il ne faut pas tenir compte de soi seulement, mais aussi des autres, de même en va-t-il dans la maison d’un homme en vue : il faut y recevoir des hôtes nombreux et y admettre une foule d’hommes et de concitoyens ; on doit donc y apporter le souci de l’espace. D’autre part, une vaste demeure devient souvent le déshonneur de son maître, s’il y règne la solitude et surtout si dans le passé un autre maître, d’ordinaire, y attirait la foule. C’est chose fâcheuse en effet quand les passants disent « Ô maison du passé, comme il est inférieur le maître qui te possède ».
Horreur
Augmentée
Sélection de textes de
Zero HP Lovecraft
Horreur
Augmentée
Sélection de textes de
Zero HP Lovecraft
Le client payait la super-mutuelle en s’ajoutant au capital politique du patron. S’il avait des compétences spécifiques, il rendait toute sorte de services dans ses opérations, sur demande et à sa propre initiative. Les clients plus standards pouvaient s’armer de matraques pour défendre les intérêts du patron dans des bagarres de rues. Ceux qui aspiraient à une vie plus calme se contentaient d’accompagner le cortège électoral, de fournir l’escorte des hommes prestigieux et, bien sûr, de voter pour lui :
« Les petites gens n’ont, à l’égard de notre ordre, d’autre moyen de s’attirer des bienfaits ou de les reconnaître, que de nous rendre cet office et de nous escorter lorsque nous sommes candidats […] Seuls des amis d’humble conditions et inoccupés sont capables de cette assiduité et leur affluence ne manque pas d’ordinaire aux hommes vertueux et bienfaisants ».
Le soutien clientélaire allait jusqu’à fournir de faux témoignages lors des procès, concernant le patron directement ou un autre client de sa bande. Des deux côtés, l’assistance était garantie part la Fides, valeur suprême. Il était d’un déshonneur extrême d’abandonner son client ou son patron, digne de l’intervention d’un censeur. Pour les grandes clientèles que les patrons ne pouvaient plus gérer seuls, plus de mille hommes, les patrons utilisaient leurs clients les plus notables comme sous-patrons représentant les clients sous eux. Aucune perte de Fides de proximité grâce à ces instances représentatives.
La politique romaine était donc un affrontement super-mutuelles privées en concurrence pour le soutien politique des clients.
- Les Ancêtres, le mos majorum
Le troisième réseau des citoyens était le réseau des fantômes, les Ancêtres, avec qui l’homme romain était en dialogue permanent dans sa recherche de modèles de comportement. Si l’homme moderne est à l’avant de la locomotive, regardant la ligne des rails jusqu’à l’infini, l’homme antique reste à l’arrière du train et se souvient des paysages traversés.
Les Ancêtres sont pour le Romain des exemples de dignitas à surpasser en tant que modèles de comportement auxquels il est comparé en permanence. Le jeune romain est donc en concurrence avec des fantômes, qui parfois viennent apparaître sur la place publique à l’occasion des funérailles d’un homme glorieux.
« Lorsqu’un personnage en vue meurt et qu’on célèbre ses obsèques, le corps est porté avec toute la pompe possible au Forum, près de ce qu’on appelle les Rostres. Il est généralement offert aux regards du public dans une posture verticale, plus rarement allongée. Quant la foule s’est massée tout autour, un grand fils – si le défunt en a laissé un et si celui-ci se trouve à Rome, sinon quelqu’un de sa famille – monte à la tribune et prononce un discours dans lequel il évoque les mérites du défunt et ce qu’il a accompli au cours de sa vie. Ainsi, dans la foule, on se souvient, on revoit ce qu’il a fait, et cela n’est pas vrai seulement pour ceux qui ont eu part à ses exploits, mais aussi pour les autres. Telle est alors l’émotion ressentie par tous, que le deuil frappant la famille du mort apparaît comme le deuil de la cité toute entière.
Ensuite après qu’on a enseveli le corps en observant le rituel établi, on place son portrait à l’endroit le plus en vue de sa maison, dans une sorte de tabernacle en bois. Ces portraits sont des masques reproduisant avec une très grande ressemblance les traits et la physionomie des disparus.
A l’occasion des fêtes religieuses officielles, on ouvre les tabernacles et on pare les masques avec le plus grand soin. Lorsqu’un personnage important de la famille vient à mourir, on les fait porter dans le cortège funèbre par des hommes ayant une stature et une corpulence comparables à celles des disparus qu’ils représentent. Ces hommes revêtent en outre une toge bordée de pourpre s’ils portent le masque d’un ancien prêteur ou d’un ancien consul, une toge toute de pourpre s’il s’agit d’un ancien censeur, ou une toge brodée d’or si le disparu a reçu les honneurs du triomphe ou accompli quelque action d’éclat. Les figurants avancent sur des chars précédés des faisceaux et des autres insignes auxquels chacun des personnages incarnés par eux, selon la charge qu’il avait, au cours de sa vie, exercée dans la cité, avait eu droit. Lorsqu’ils atteignaient les Rostres, ils s’asseyent tous à la file sur des sièges d’ivoire.
On ne saurait imaginer plus noble spectacle que celui-là pour un jeune homme épris de gloire et de vertu. Est-il en effet quelqu’un qui, voyant réunies les images pour ainsi dire vivantes et animées, de ces grands hommes honorés pour leur mérite, ne serait stimulé par un tel spectacle ? Se peut-il rien voir de plus beau ? »
En-dehors de ces cérémonies, le jeune homme se voyait rappeler jusque dans le foyer qu’il devait être ambitieux pour sa dignitas et celle de sa lignée par les trophées privés ramenés par les Pères et accrochés aux endroits le plus en vue de la maison. Les archives de famille apportaient les détails de leurs exploits. Tous attendaient qu’il en fasse autant, voire plus.
Cette insistance sur les actes des Ancêtres, donc sur l’histoire, s’expliquait par l’absence de grande œuvre de référence à Rome comparable à L’Illiade et l’Odyssée et les épopées perdues de la Grèce, exposant des modèles faisant consensus. Remarquons que l’histoire telle qu’elle était pratiquée par les Romains se rapprochait donc nécessairement plus du journalisme que de la science historique. Les historiens romains étaient des compilateurs, s’intéressant surtout aux anecdotes, à vertu d’exemple par définition, et aux historiettes belles et morales. Un même paragraphe pouvait placer au même rang une analyse politique de grande échelle et une triviale péripétie n’ayant même pas forcément de lien direct, la première étant un prétexte pour évoquer la seconde. Les historiens ne réfléchissaient pas à la chaîne de causalité des événements, juxtaposant parfois des contradictions dans leurs compilations, le passé se révélant être pour l’homme romain un grand tableau illustratif des vertus à déployer pour être un vrai Romain. Cincinnatus (mort en -430) et Scipion (mort en -129) étaient deux grands hommes, peu importait que le contexte dans lequel ils vécurent n’eussent rien à voir.
Ces grands hommes du passé qu’il fallait imiter et surpasser apparaissaient tous construits sur un socle commun de vertus auxquelles s’ajoutaient quelques spécificités personnelles.
Premièrement, ils s’étaient engagés militairement et avaient combattu les ennemis de Rome avec succès.
Deuxièmement, ils s’étaient engagés politiquement pour la cité, en tant que magistrats puis sénateurs, même en période calme. Cicéron affirmait que même en l’absence de besoin politique immédiat, l’engagement politique était essentiel à la fois pour occuper la place de pouvoir qu’un méchant pourrait occuper et pour être en position d’agir quand l’occasion se présenterait.
Troisièmement, ils étaient éloquents à la romaine. Ils étaient capables d’avoir le dernier mot dans un débat public, devant le Peuple assemblé, par exemple lors d’un procès. Le peuple appréciait particulièrement l’humour lourd visant à humilier son adversaire sur son accent, son physique ou ses habitudes de vie.
Quatrièmement, le grand homme marquait son statut. Il possédait des terres, caution pour le respect des finances publiques durant sa carrière de magistrat, et des esclaves, métayers, serviteurs domestiques ou spécialistes ayant des compétences spécifiques en médecine et enseignement.
Mais le jeune Romain n’était pas qu’en concurrence avec ses Ancêtres, ceux-ci lui transmettaient également le mos majorum en héritage, sur lequel prend appui pour les dépasser, tâche autrement impossible :
« Il est indispensable au sénateur d’avoir une connaissance complète de la res publica et cette connaissance est étendue : le nombre de soldats dont il dispose, les ressources du trésor public, ses alliés, amis et tributaires, chacun en vertu de quelle loi, convention, ou traité. Il faut connaître aussi les usages des délibérations, les exemples des ancêtres. Vous voyez quelle science, quelle activité, quelle mémoire tout cela exige ; et à défaut de ces connaissances, un sénateur ne sera jamais prêt »
Le mos majorum était le capital de connaissances transmis par l’apprentissage par l’exemple, permettant au jeune de récupérer le capital humain de son père. Il l’enrichirait à son tour par ses expériences de carrière. Dans les plus hautes sphères du pouvoir, ce capital comportait les pratiques du Sénat, les Pères amenant leurs enfants aux séances pour leur montrer quand il était approprié de parler, quand il fallait se taire, quand il fallait résister et interpeler, et comment le faire sans se ridiculiser. C’était également l’occasion d’enseigner le jeu des factions dès le plus jeune âge.
Ce capital, particulièrement développé par les familles de la nobilitas, de la noblesse de fonction, était également un savoir d’empire sur les provinces. Une grande part de cette culture venait de l’expérience acquise au cours des provinces et des relations nouées par les membres des familles les ayant remplies, ceux-ci amenant leurs fils en début de carrière avec eux. Ainsi, tout un ensemble de connaissances géographiques et ethnographiques, militaires et administratives, juridiques et fiscales étaient acquises, celles-là pour comprendre les peuples concernés par la province, celles-ci pour y voir clair dans le patchwork de statuts juridiques et d’exemptions résultant de la succession des provinces. Des informations précieuses fuitaient des familles et entraient dans la sphère publique des savoirs d’Etat à l’occasion des rapports et comptes rendus envoyés par les promagistrats ou présentés lors de leur retour de province.
Comparez ces structures à nos sociétés bureaucratiques modernes. Si on a un souci, on se retrouve seul, ou alors on peut s’aventurer dans les méandres des bureaux et se rendre compte que personne ne nous aidera. Suivre les procédures est long et compliqué, et requiert un véritable savoir administratif dont l’homme de base ne disposera jamais. A Rome, vous seriez simplement allé voir votre boss, qui aurait arrangé la situation car lui dispose personnellement des savoirs et moyens requis. Et le lendemain, vous l’auriez accompagné au Forum pour sa descente quotidienne, avec les autres clients.
Cet article vous a plus ? Soutenez nous sur Tipeee
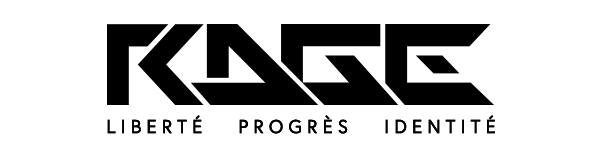

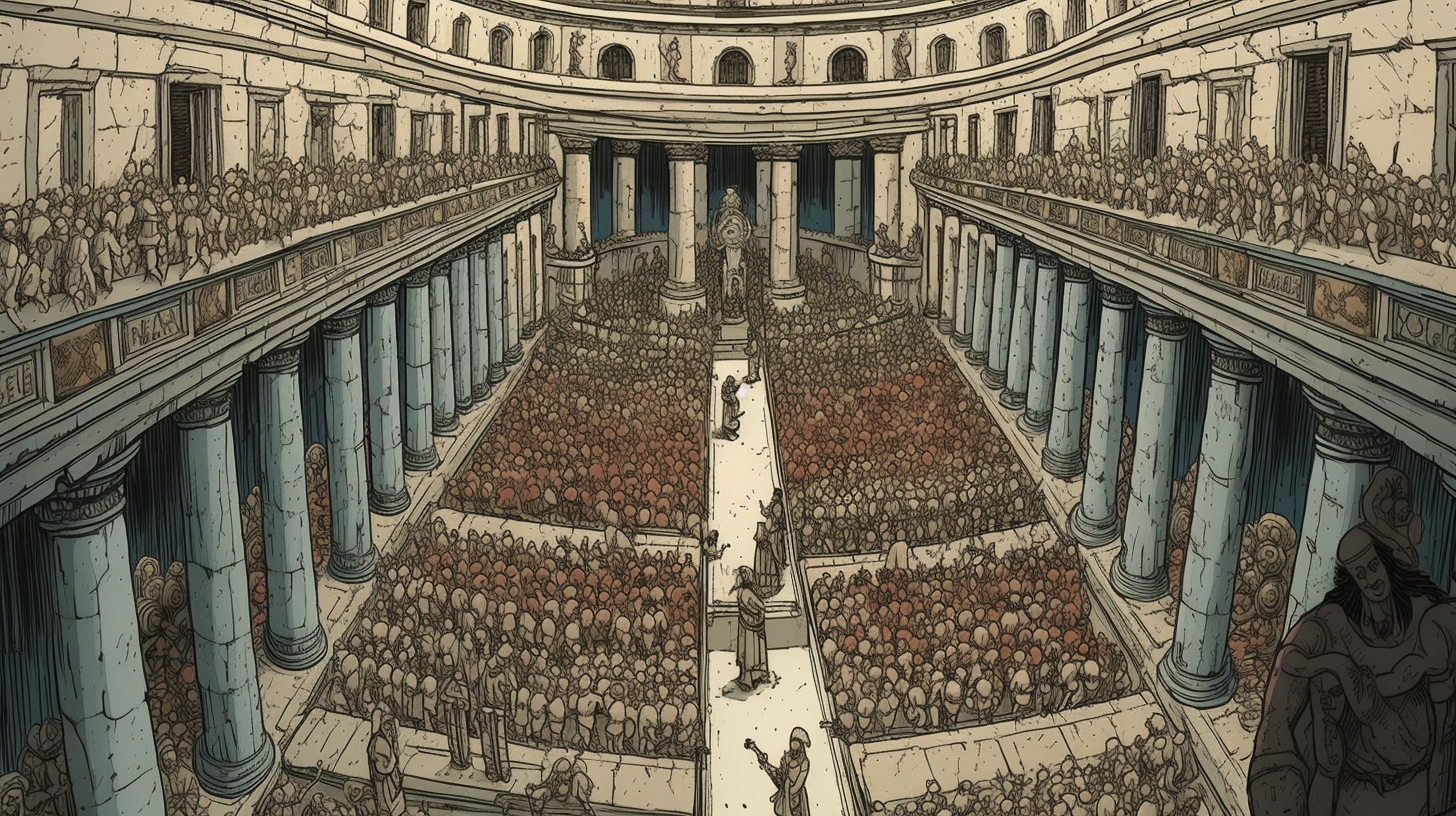





Un beau morceau d’anthropologie culturelle, merci.
Bonjour et merci de votre commentaire.
Il y a un autre commentaire sur un article (Lettre ouverte aux transhumanistes) qui correspond à celui-ci je pense.
Effectivement, il en est de même dans les hautes classes aujourd’hui. Le réseau personnel fait tout. Et c’est un système très bien, qui fait que là haut, on se sent beaucoup mieux que quand on est en bas de l’échelle.
La spécificité de la République Romaine, et de tous les systèmes politiques qui marchent en fait, c’est que ces réseaux arrivaient jusqu’au citoyen de base. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Si vous avez un problème, vous tombez sur le répondeur du numéro vert. Par contre, si vous êtes haut placé, vous allez voir votre pote et le problème est résolu. A Rome, l’homme de base pouvait aller voir son boss en cas de besoin.