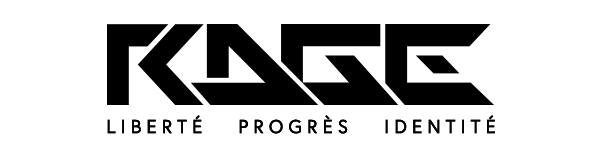Le texte ci-dessous est une traduction d’un texte initialement écrit par Curtis Yarvin sur son blog Unqualified Reservations.
L’autre jour, alors que je bricolais dans mon garage, j’ai décidé de créer une nouvelle idéologie. Quoi ? j’ai perdu la boule ou quoi ? Tout d’abord, tu ne peux pas créer une idéologie comme ça te chante. Elles se transmettent à travers les siècles, comme la recette des lasagnes. Elles doivent prendre de l’âge, comme un bourbon. Tu ne peux pas simplement la boire directement à la bouteille. Et regarde ce qui arrive si tu essaies. Qu’est-ce qui cause tous les problèmes du monde ? L’idéologie et rien d’autre. Qu’est-ce que Bush et Obama ont en commun ? Ce sont deux idéologues maboules. A-t-on vraiment davantage besoin de ça ? De plus, il n’est tout simplement pas possible de bâtir une nouvelle idéologie. Les gens parlent d’idéologie depuis que Jésus est un petit garçon. Et quoi ! Je suis censé faire mieux sur le sujet ? Des random sur internet, qui ont foiré leurs études supérieures, et qui ne connaissent ni le latin ou le grec ? Je me prends pour qui, Wallace Shawn ?
Que d’excellentes objections.
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Répondons à chacune d’entre elles, puis parlons du formalisme. Premièrement, on trouve, bien entendu, de splendides traditions idéologiques ancestrales auxquelles internet nous permet d’accéder dans leurs moindres détails. Elles ont beaucoup de noms, mais appelons les « progressisme » et « conservatisme ».
Mon problème avec le progressisme est que depuis un siècle, la vaste majorité des écrivains, penseurs et personnes intelligentes ont été progressistes. Par conséquent, tout intellectuel en 2007, à moins qu’il n’y ait un genre de distorsion spatio-temporelle et que mes mots soient diffusés en direct sur Fox News, et quiconque lit ceci, a fondamentalement été biberonné à l’idéologie progressiste.
Peut-être que ceci pourrait légèrement nuire à notre capacité à voir un quelconque problème susceptible d’exister dans la vision du monde progressiste.
Tout comme pour le conservatisme, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. De même, tous les conservateurs ne sont pas des crétins, mais la plupart des crétins sont des conservateurs. Le mouvement conservateur américain moderne – qui est paradoxalement beaucoup plus jeune que le mouvement progressiste, ne serait-ce que parce qu’il a fallu le réinventer après la dictature de Roosevelt – a été nettement touché par ce public.
Il souffre aussi de la coïncidence électorale qu’il doit mépriser tout ce que le progressisme adore, une étrange tare congénitale pour laquelle ne semble exister aucun remède. La plupart des gens qui ne se réclament ni du « progressisme » ni du « conservatisme » sont de deux choses l’une, soit des « modérés », soit des « libertariens ».
D’après mon expérience, la plupart des gens sensés se considèrent comme « modérés », « centristes », « indépendants », « non idéologiques », « pragmatiques », « apolitiques », etc. Compte tenu des vastes tragédies provoquées par la politique du XXe siècle, cette attitude est tout à fait compréhensible. Ceci est également, à mon avis, responsable de la plupart des morts et des destructions dans le monde aujourd’hui.
La modération n’est pas une idéologie. Ce n’est pas une opinion. Ce n’est pas une pensée. C’est une absence de pensée. Si vous pensez que le statu quo de 2007 est fondamentalement juste, alors vous croierez la même chose si une machine à voyager dans le temps vous transportait à Vienne en 1907. Mais si vous faisiez le tour de Vienne en 1907 en disant qu’il devrait y avoir une Union européenne ; que les Africains et les Arabes devraient diriger leur propre pays, et même coloniser l’Europe ; que toute forme de gouvernement, à l’exception de la démocratie parlementaire, est mauvaise ; que le papier-monnaie est bon pour les affaires ; que tous les médecins devraient travailler pour l’État, etc, etc – eh bien, vous pourriez probablement trouver des gens qui seraient d’accord avec vous. Ils ne se qualifieraient pas de “modérés”, et personne d’autre ne le ferait non plus. Non, si vous étiez un modéré à Vienne en 1907, vous penseriez que Franz Josef I est la meilleure chose depuis le pain en tranches. Alors, lesquels choisir ? Les Habsbourg ou les eurocrates ? Assez difficile de trancher, pour le coup.
Autrement dit, le problème avec la modération est que le « centre » n’est pas fixe. Il se déplace. Et comme il se déplace, et les gens étant ce qu’ils sont, les gens vont tenter de le déplacer. Ceci crée une incitation à la violence – quelque chose que nous, formalistes, essayons d’éviter.
Maintenant, les libertariens.
J’aime les libertariens à en crever. J’ai constamment une page ouverte sur mon PC vers le Mises Institute. Selon moi, quiconque a délibérément choisi de rester ignorant de la pensée libertarienne (et, en particulier, de la pensée de Mises et Rothbard), à une époque où il suffit de quelques clics de souris pour être submergé de suffisamment de libertarianisme de grande qualité pour noyer un Élan, n’est pas une personne que l’on peut prendre intellectuellement au sérieux.
De plus, je suis un programmeur informatique qui a beaucoup trop lu de science-fiction – deux facteurs de risques majeurs pour le libertarianisme. Je pourrais donc me contenter de dire « lisez Rothbard », et en rester là. D’un autre côté, il est difficile de passer à côté de deux faits élémentaires concernant l’univers. Le premier est que le libertarianisme est une idée d’une évidence foudroyante. Le second est qu’elle n’a jamais été mise en pratique.
Cela ne prouve rien. Mais cela suggère que le libertarianisme est, comme ses contempteurs sont toujours prompts à le claironner, une idéologie essentiellement impraticable. J’adorerais vivre dans une société libertarienne. La question est : Existe-t-il un chemin pouvant nous mener à destination ? Et s’il nous y mène, y resterons-nous ? Si votre réponse à ces deux questions est un « oui » évident, il se pourrait que nous ne partagions pas la même définition du mot « évident ».
C’est pourquoi j’ai décidé de créer ma propre idéologie : le « formalisme ».
Bien entendu, le formalisme n’a rien de nouveau. Les progressistes, les conservateurs, les modérés et les libertariens reconnaîtront tous de larges pans de leur propre réalité indigeste. Même le mot « formalisme » est emprunté au formalisme légal, qui est essentiellement la même idée habillée plus modestement.
Je ne suis pas Vizzini. Je suis simplement un type qui achète beaucoup de livres d’occasion, et qui n’a pas peur de les broyer, d’ajouter de la saveur, et de réétiqueter le résultat comme une sorte de surimi politique. La majorité de ce que j’ai à dire est disponible, en mieux écrit, avec plus de détails et beaucoup plus d’érudition, chez Jouvenel, Kuehnelt-Leddihn, Leoni, Burnham, Nock, etc, etc.
Si vous n’avez jamais entendu parler d’aucune de ces personnes, moi non plus avant de commencer la procédure. Si ça vous effraie, c’est normal. Remplacer sa propre idéologie ressemble beaucoup à une chirurgie du cerveau que l’on s’administrerait à soi-même. Cela nécessite de la patience, de la tolérance, un seuil élevé de résistance à la douleur, et une main ferme. Qui que vous soyez, vous avez déjà une idéologie et si elle voulait prendre congé, elle l’aurait déjà fait de son propre chef.
Il ne sert à rien de commencer une expérimentation aussi chaotique pour installer une autre idéologie simplement parce que quelqu’un d’autre vous dit de le faire. Le formalisme, comme nous le verrons, est une idéologie conçue par des geeks pour d’autres geeks. Ça n’est pas un kit. Elle n’est pas livrée avec des batteries. Il n’y a rien à insérer. Au mieux, c’est un point de départ rudimentaire pour bricoler sa propre idéologie. Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec le fait de travailler avec un banc de scie, un oscilloscope ou un autoclave, le formalisme n’est pas pour vous.
Cela étant dit :
L’idée fondamentale du formalisme est tout simplement que le problème principal dans les affaires humaines est celui de la violence.
L’objectif est de concevoir un moyen pour les humains d’interagir, sur une planète remarquablement petite, sans violence. Tout spécialement la violence organisée. En dehors de la violence organisée entre humains, un bon formaliste pense que tous les autres problèmes – la pauvreté, le réchauffement climatique, la décadence morale, etc, etc, etc – sont essentiellement insignifiants.
Peut-être qu’une fois que nous nous serons débarrassés de la violence nous pourrons nous soucier un petit peu de la décadence morale, mais étant donné que la violence organisée a causé la mort de quelques centaines de millions de personnes au cours du dernier siècle, alors que la décadence morale nous a donné « American Idol » [NDT : équivalent américain de « nouvelle star »], je pense que les priorités sont assez claires.
La clef est de considérer cela, non pas comme un problème moral, mais comme un problème d’ingénierie. Toute solution qui permet de résoudre le problème est acceptable. Toute solution qui ne résout pas le problème est inacceptable.
Par exemple, il existe une idée qui s’appelle le pacifisme, qui fait partie de la panoplie générale du progressiste, et qui claironne être une solution à la violence. Telle que je la comprends, l’idée du pacifisme est que si vous et moi ne pouvons être violents, les autres ne le seront pas non plus. Je ne doute pas que le pacifisme puisse être efficace dans certains cas. En Irlande du Nord, par exemple, ça pourrait faire l’affaire à première vue. Mais il y a une sorte de logique du « centième singe » qui échappe constamment à mon esprit occidental linéaire. Il est frappant que si tout le monde est pacifiste et qu’une seule personne décide de ne pas l’être, celle-ci finira par dominer le monde. Humm….
Une autre difficulté est que la définition du mot « violence » n’est pas si évidente. Si je vous soulage avec doigté de votre portefeuille, et que vous me pourchassiez avec votre Glock [arme de poing] et me faites supplier d’être autorisé à vous le rendre, lequel de nous deux est violent ? Disons que je dise, « eh bien, c’était votre portefeuille – mais maintenant c’est le mien » ?
Cela suggère, au minimum, que nous avons besoin d’une règle nous indiquant à qui appartient le portefeuille. La violence est, dès lors, tout ce qui viole la règle, ou la remplace par une règle différente. Si la règle est claire et que tout le monde la suit, il n’y a pas de violence.
En d’autres termes, la violence revient à l’équation suivante : conflit plus incertitude.
Tant qu’il y aura des portefeuilles dans le monde, il y aura de la violence. Toutefois, si l’on peut éliminer l’incertitude – s’il existe une règle non ambigüe, inviolable, qui nous indique, à l’avance, à qui appartient le portefeuille – je n’ai pas de raison de glisser ma main dans votre poche, et vous n’avez pas de raison de me courir après en tirant rageusement dans tous les sens. Aucune de nos actions, par définition, ne peut affecter l’issue du conflit.
La violence, quelle que soit son importance, n’a aucun sens sans incertitude. Considérez une guerre. Si une armée sait qu’elle va perdre la guerre, informée peut-être par quelque oracle infaillible, elle n’a pas de raison de se battre. Pourquoi ne pas se rendre et passer à autre chose ?
Mais cela ne fait que multiplier les difficultés. D’où viennent toutes ces règles ? Qui les rend inviolables ? Qui peut devenir un oracle ? Pourquoi ce portefeuille est à « vous » et à pas à « moi » ? Que se passe-t-il si nous sommes en désaccord à ce sujet ? S’il existe autant de règles que de portefeuilles, comment se souvenir de toutes ? Et supposons que ce soit moi et non pas vous qui ai le Glock ?
Fort heureusement, les grands philosophes ont passé de très longues heures à soupeser ces détails. Les réponses que je vous donne sont les leurs, pas les miennes.
Premièrement, une manière sensée d’établir des règles est de n’être tenu de les respecter que si, et seulement si, vous y consentez. Nos règles ne nous sont pas données par des dieux quelque part. Ce que nous avons ne sont en réalité pas des règles, mais des accords. Certainement, donner son accord à quelque chose puis le retirer, à votre propre convenance, unilatéralement, est l’acte d’un goujat. En fait, quand vous passez un accord, l’accord lui-même peut bien inclure les conséquences de ce type de comportement irresponsable.
Si vous êtes un sauvage et que vous ne consentiez à rien – pas même à ne pas tuer des gens au hasard dans la rue – pas de souci. Allez vivre dans la jungle où je ne sais où. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous permettent de vous balader dans leur rue, pas plus qu’ils ne toléreraient, disons, un ours polaire. Il n’existe pas de principe moral absolu affirmant que les ours polaires sont mauvais, mais leur présence n’est tout simplement pas compatible avec la vie urbaine moderne.
Deux types d’accords commencent à se dessiner ici. Il y a les accords conclus avec d’autres individus spécifiques – je m’engage à peindre votre maison, vous vous engagez à me payer. Et il y a des accords comme ; « Je ne tuerai personne dans la rue ». Ces deux types d’accords sont-ils pour autant réellement différents ? Je ne le pense pas. Je pense que le second type d’accord est simplement un accord avec quiconque possède la rue.
Si les portefeuilles ont des propriétaires, pourquoi les rues n’en auraient-elles pas ? Les portefeuilles doivent avoir des propriétaires, évidemment, parce qu’à la fin des fins quelqu’un doit décider de ce qu’il faut faire du portefeuille.
Est-ce qu’il part dans votre poche ou dans la mienne ? Les rues restent en place, mais il reste encore beaucoup de décisions à prendre – qui pave la rue ? Quand et pourquoi ? Les gens sont-ils autorisés à en tuer d’autres dans la rue, ou s’agit-il d’une de ces rues spéciales où il est interdit de tuer ? Que faire des marchands ambulants ? Etc.
Horreur
Augmentée
Sélection de textes de
Zero HP Lovecraft
Horreur
Augmentée
Sélection de textes de
Zero HP Lovecraft
Évidemment, si je possède la 44e rue et que vous possédez la 45e et la 43e, la possibilité d’une relation complexe entre nous devient non triviale. Et la complexité est proche de l’ambiguïté, qui est proche de l’incertitude, et là, les Glocks ressortent. Donc, de manière réaliste, nous parlons probablement davantage de posséder non pas des rues, mais des unités plus grandes et plus clairement définies – des quartiers, peut-être, ou même des villes.
Posséder une ville ! Ça pourrait être plutôt sympa, mais ça nous ramène à un problème que nous avons complètement mis de côté, qui est « qui possède quoi ». Comment décidons-nous ? Est-ce que je mériterais de posséder une ville ? Suis-je à ce point méritant ? Je crois que oui. Peut-être pourriez-vous garder votre portefeuille et que je pourrais avoir, disons, Baltimore.
Il y a cette idée appelée « justice sociale » à laquelle beaucoup de gens croient.
Cette notion est, en fait, plutôt universellement partagée à l’heure où j’écris ces lignes. Ce qu’elle nous dit, c’est que cette terre est petite et qu’on y trouve un ensemble de ressources limitées, comme des villes, que nous désirons tous autant que possible. Mais nous ne pouvons pas avoir toutes les villes, ou même une rue. Par conséquent, nous devrions les partager de manière égale. Car nous sommes tous égaux et que personne n’est plus égal qu’un autre.
L’idée de justice sociale semble très sympathique. Mais elle soulève trois problèmes.
La première est que beaucoup de ces choses que nous désirons ne sont pas comparables. Si j’obtiens une pomme et vous une orange, sommes-nous égaux ? On pourrait toujours débattre du sujet – avec des Glocks peut-être. La deuxième est que, même si tout le monde partait avec des possessions égales, les gens étant différents, ayant des besoins différents et des talents différents, etc., et le concept de propriété impliquant que si vous possédez quelque chose vous pouvez le donner à quelqu’un d’autre, ceci ne manquerait pas de produire de nouvelles inégalités. En fait, il est fondamentalement impossible d’établir un système dans lequel des accords restent convenus avec un autre dans lequel l’égalité reste égale.
Cela nous enseigne que si nous essayons d’imposer une égalité permanente, nous pouvons probablement nous attendre à une violence permanente. Je ne suis pas trop fan de l’idée de « preuve empirique », mais je pense que cette prédiction correspond assez bien à la réalité.
Mais le troisième problème, qui classe l’affaire – pour ainsi dire – est que nous ne sommes pas, en fait, en train de concevoir une utopie ici. Nous tentons de réparer le monde réel, qui, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, est extrêmement bordélique. Dans beaucoup de cas, il n’existe aucun accord clair concernant qui possède quoi (la Palestine, vous vous souvenez ?), mais la plupart des bonnes choses dans le monde semblent avoir une chaîne de contrôle plutôt bien définie.
Si nous devons commencer en égalisant la distribution des biens, ou bien en changeant tout simplement cette distribution, nous nous mettons nous-mêmes bien inutilement derrière la boule 8. Nous disons « nous venons en paix », « nous croyons que tous devraient être libres et égaux », « embrassons-nous ». « Mets ton bras atour de moi ! Tu sens cette masse dans ma poche arrière ? Ouaip, c’est bien ce que tu crois que c’est. Et il est chargé. Maintenant, file-moi ta ville/ portefeuille/ pomme/orange, car je connais quelqu’un qui en a plus besoin que toi ! »
L’objectif du formalisme est de nous épargner ce petit détour déplaisant.
Le formalisme dit : découvrons exactement qui possède quoi, maintenant, et donnons-leur un petit certificat bien sympathique. Ne nous embarquons pas dans la question de savoir qui devrait posséder quoi. Car, que cela plaise ou non, c’est là la recette pour plus de violence. Il est vraiment difficile d’élaborer une règle qui explique pourquoi les Palestiniens devraient récupérer Haïfa, ou qui explique pourquoi les Gallois devraient récupérer Londres.
Jusqu’à présent, tout ça doit beaucoup ressembler à du libertarianisme. Mais il y a une grosse différence. Les libertariens peuvent penser que les Gallois devraient récupérer Londres. Ou pas. Je ne suis pas sûr. Je peux interpréter Rothbard sur cette question – ce qui est, en tant que tel, un problème comme nous l’avons vu. Mais s’il est une chose que tous les libertariens croient, c’est que les Américains devraient récupérer l’Amérique. Autrement dit, les libertariens (les vrais libertariens, du moins) croient que les États-Unis constituent fondamentalement une autorité illégitime et usurpatrice, que l’impôt est un vol, qu’ils sont essentiellement traités comme des bêtes de somme par cette bizarre mafia armée officieuse, qui a en quelque sorte convaincu tout le monde dans le pays de l’adorer comme s’il s’agissait de l’Église de Dieu, ou un truc du genre, et pas simplement une bande de types avec des badges fantaisistes et des gros flingues.
Un bon formaliste n’acceptera rien de tout cela.
Parce que pour un formaliste, le fait que les États-Unis puissent décider de ce qui doit être sur le continent nord-américain entre le 49e parallèle et le Rio Grande, AK [Alaska] et HI [Hawaii], etc., signifie que cette entité possède le territoire. Et le fait que le gouvernement des États-Unis extorque des paiements réguliers des bêtes de somme mentionnées plus haut ne signifie rien d’autre qu’il possède ce droit. Les diverses manœuvres et pseudo-légalités par lesquelles il a acquis ces propriétés relèvent simplement de l’histoire. Ce qui compte, c’est qu’il les possède maintenant, et qu’il ne veuille pas les céder, pas plus que vous ne vouliez me céder votre portefeuille.
Donc, si l’obligation de débourser une partie de votre salaire fait de vous un serf (une réutilisation raisonnable du mot, sûrement, pour notre âge moins agricole), cela fait des Américains – des serfs.
Adaptation de la nouvelle de
Lovecraft en animation grâce
à l’IA
Adaptation de la nouvelle de
Lovecraft en animation
Des serfs d’une entreprise, pour être exact, parce que les États-Unis ne sont rien d’autre qu’une entreprise. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une structure formelle par laquelle un groupe d’individus s’engage à agir collectivement pour obtenir un résultat.
Et alors ? Je suis donc le serf d’une entreprise. Est-ce si horrible ? J’ai l’impression que je m’y suis plutôt bien habitué. Deux jours dans la semaine, je travaille pour le seigneur Snooty-Snoot. Ou pour une multinationale sans visage, ou je ne sais quoi. L’identité de l’émetteur du chèque a-t-elle une importance ?
La distinction moderne entre les corporations « privées » et les « gouvernements » est en réalité un développement récent. Les États-Unis sont certainement différents de, disons, Microsoft, du fait que les Etats-Unis se chargent de leur propre sécurité. D’un autre côté, tout comme Microsoft dépend de l’État américain pour l’essentiel de sa sécurité, les Etats-Unis dépendent de Microsoft pour la plupart de ses logiciels. On ne voit pas trop pourquoi il faudrait accorder un statut spécial à l’une de ces entreprises et pas à l’autre.
Bien entendu, l’objectif de Microsoft n’est pas de créer des logiciels, mais de faire de l’argent pour ses actionnaires. La Société de lutte contre le cancer est aussi une corporation et elle a également une raison d’être – éradiquer le cancer. J’ai perdu beaucoup de travail à cause des prétendus « logiciels » de Microsoft et ses actions, franchement, ne vont nulle part. Et le cancer semble toujours être là.
Au cas où le PDG de MSFT ou de l’ACS lirait ceci, je n’ai pas vraiment de message pour vous les gars. Vous savez ce que vous tentez de réaliser et vos employés font probablement du mieux qu’ils peuvent. Et sinon, virez les incapables !
En revanche, je n’ai aucune idée de la finalité des États-Unis.
J’ai entendu dire que quelqu’un dirige les États-Unis, paraît-il. Mais il ne semble même pas capable de virer ses propres employés, ce qui est probablement une bonne chose, car ça n’est pas exactement Jack Welch, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je serais ravi d’entendre qui que ce soit capable de m’expliquer si un quelconque évènement signifiant survenu en Amérique du Nord est dû au fait que c’est Bush qui remporta l’élection de 2004 et non Kerry. Parce que mon impression est que, fondamentalement, le Président a à peu près autant d’emprise sur les actions des États-Unis que l’Empereur souverain Céleste, le Divin Mikado, en a sur les actions du Japon. Autrement dit, pratiquement aucune.
Bien entendu, les États-Unis existent. L’État américain fait des trucs, à l’évidence. Mais la manière dont il décide des choses à faire est tellement opaque, pour quiconque regarde ça de l’extérieur, qu’il pourrait tout aussi bien consulter des entrailles de bœuf.
Voici donc la thèse centrale du manifeste formaliste : les États-Unis ne sont qu’une entreprise.
Rien à voir avec une confiance mystique qui nous est confiée par les générations. Il n’est pas le dépositaire de nos espoirs et de nos peurs, la voix de la conscience et l’épée vengeresse de la justice. C’est juste une vieille et grande entreprise qui détient une énorme pile d’actifs, qui n’a aucune idée claire de ce qu’elle essaie d’en faire et qui se débat comme un requin de dix tonnes dans un seau de dix-huit litres, l’encre rouge jaillissant de chacune de ses milliards de branchies.
Pour un formaliste, la façon de réparer les États-Unis est de se passer de l’ancien raifort mystique, des prières d’entreprise et des chants de guerre, de décider à qui appartient cette monstruosité et de les laisser décider ce qu’ils vont en faire. Je ne pense pas qu’il soit tellement insensé de dire que toutes les options – y compris la restructuration et la liquidation – devraient être sur la table. Que nous parlions des États-Unis, de Baltimore ou de votre portefeuille, un formaliste n’est heureux que lorsque la propriété et le contrôle ne font qu’un.
Pour reformaliser, il faut donc savoir qui détient réellement le pouvoir aux États-Unis, et répartir les actions de manière à reproduire au plus près cette répartition. Bien sûr, si vous croyez au raifort mystique, vous direz probablement que chaque citoyen devrait recevoir une part. Mais c’est une vision des choses plutôt aveugle à la structure de pouvoir réelle des États-Unis. N’oubliez pas que notre objectif n’est pas de savoir qui devrait posséder quoi, mais de savoir qui possède quoi.
Par exemple, si le New York Times devait soutenir notre plan de reformalisation, cela augmenterait grandement les chances que celui-ci soit mis en œuvre. Cela suggère que le New York Times a pas mal de pouvoir, et qu’il devrait donc obtenir pas mal d’actions.
Mais attendez. Nous n’avons pas répondu à la question. Quelle est la finalité des États-Unis ?
Supposons, uniquement à titre d’illustration, que nous donnions toutes les actions au New York Times. Que va faire « Punch » Sulzberger avec son nouveau pays rutilant ?
Beaucoup de gens, y compris probablement M. Sulzberger, semblent considérer les États-Unis comme une entreprise caritative. Comme l’American Cancer Society, simplement avec une mission plus large.
Peut-être que la raison d’être des États-Unis est simplement de faire le bien dans le monde.
C’est une perspective très compréhensible. Sûrement, s’il reste quelque chose de mauvais dans le monde, il peut être vaincu par une méga-charité titanesque et lourdement armée, avec des bombes H, un drapeau et 250 millions de serfs. En fait, il est en réalité assez étonnant que, compte tenu des dotations prodigieuses de cette grande institution philanthropique, elle semble faire si peu de bien.
Peut-être cela a-t-il à voir avec le fait qu’elle est si bien gérée qu’elle n’a pas de budget à l’équilibre depuis les années 1830. Peut-être que si vous reformalisiez les États-Unis, que vous les gériez comme une véritable entreprise, et distribuiez ses parts parmi un vaste ensemble d’organismes de bienfaisance distincts, chacun ayant probablement une charte spécifique pour un objectif spécifique, plus de bien pourrait en résulter.
Bien sûr, les États-Unis n’ont pas seulement des actifs. Malheureusement, ils ont aussi des passifs. Certains de ces passifs, comme les bons du Trésor, sont déjà très bien formalisés. D’autres, comme la sécurité sociale et l’assurance-maladie, sont informels et soumis aux incertitudes politiques. Si ces obligations étaient reformalisées, leurs destinataires ne pourraient qu’en profiter. Bien sûr, elles deviendraient ainsi des instruments négociables et pourraient être, par exemple, vendues. Peut-être en échange de crack. La reformalisation nous oblige donc à distinguer entre la propriété et la charité, un problème difficile, mais important.
Tout cela ne répond pas à la question : les États-nations, comme les États-Unis, sont-ils même utiles ? Si vous reformalisiez les États-Unis, la question serait laissée à ses actionnaires. Peut-être que les villes fonctionnent mieux lorsqu’elles sont détenues et exploitées de manière indépendante. Si tel est le cas, elles devraient probablement être scindées en sociétés distinctes. L’existence de cités-États telles que Singapour, Hong Kong et Dubaï suggèrent certainement une réponse à cette question. Peu importe la manière dont on les appelle, ces endroits sont remarquables pour leur prospérité et leur relative absence de politique. En fait, il se pourrait que la seule façon de les rendre plus stables et sûres soit de les faire passer du statut de sociétés familiales (Singapour et Dubaï) ou de filiales (Hong Kong), à celui de sociétés publiques anonymes, éliminant par là même le risque de long terme que la violence politique puisse se développer.
Certes, l’absence de démocratie dans ces cités-États ne les rend nullement comparables à l’Allemagne nazie ou à l’Union soviétique. Toutes les restrictions à la liberté individuelle qu’elles maintiennent semblent viser principalement à empêcher le développement de la démocratie – une préoccupation compréhensible compte tenu de l’histoire du gouvernement par le peuple. En fait, le Troisième Reich et le monde communiste ont souvent prétendu représenter tous deux le véritable esprit de la démocratie.
Comme Dubaï en particulier le montre, un gouvernement (comme n’importe quelle entreprise) peut fournir un excellent service client sans posséder ni appartenir à ses clients. La plupart des habitants de Dubaï ne sont même pas des citoyens. Si Cheikh Al-Maktoum a un plan astucieux pour tous les arrêter, les enchaîner et les faire travailler dans les mines de sel, il s’y prend d’une manière très sournoise. En tant que lieu, il n’y a pratiquement rien à recommander concernant Dubaï. Le temps y est horrible, les sites touristiques sont inexistants et le quartier est atroce. C’est minuscule, au milieu de nulle part, et entouré de maniaques fous d’Allah avec une affinité suspecte pour les centrifugeuses à grande vitesse. Néanmoins, on y trouve un quart des grues du monde et elles y poussent comme de la mauvaise herbe. Si nous laissions les Maktoum gérer, disons, Baltimore, que se passerait-il ?
L’une des conclusions du formalisme est que la démocratie est – comme la plupart des écrivains avant le XIXe siècle l’ont compris – un système de gouvernement inefficace et destructeur. Le concept de démocratie sans politique n’a aucun sens et, comme nous l’avons vu, la politique et la guerre forment un continuum. La politique démocratique est mieux comprise comme une sorte de violence symbolique, comme décider que la victoire sur le champ de bataille serait fonction du nombre de soldats que le commandant a amenés avec lui.
Les formalistes attribuent le succès de l’Europe, du Japon et des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale non pas à la démocratie, mais à son absence. Tout en conservant les structures symboliques de la démocratie, tout comme le principat romain a conservé le Sénat, le système occidental d’après-guerre a attribué presque tout le pouvoir de décision réel à ses fonctionnaires et juges, qui sont « apolitiques » et « non partisans », c’est-à-dire non démocratiques.
Car en l’absence d’un contrôle externe efficace, ces administrations se gèrent plus ou moins elles-mêmes. Comme toute entreprise sans direction, elles semblent souvent exister et se développer dans le seul et unique but d’exister et de se développer. Mais elles évitent le système de spoliation qui se développe invariablement lorsque les tribuns du peuple ont un pouvoir réel. Et elles effectuent un travail raisonnable, sinon stellaire, pour maintenir un semblant de loi.
En d’autres termes, la « démocratie » semble fonctionner parce qu’il ne s’agit pas en fait de démocratie, mais d’une mise en œuvre médiocre du formalisme.
Ce rapport entre symbolisme et réalité a subi une épreuve édifiante, bien que déprimante, sous la forme de l’Irak, où il n’y a pas de loi du tout, mais à qui nous avons octroyé la forme de démocratie la plus pure et la plus élégante (la représentation proportionnelle), et instaurer des ministres qui semblent diriger leurs ministères. Bien que l’histoire ne fasse pas d’expériences contrôlées, la comparaison de l’Irak à Dubaï plaide certainement en faveur du formalisme plutôt que de la démocratie.
Cet article vous a plus ? Soutenez nous sur Tipeee