Coorganisateur du Colloque Walter Lippmann de 1938 à Paris, qui visait une refondation du libéralisme après la crise de 1929, et membre de la Société du Mont-Pèlerin, le philosophe Louis Rougier (1889-1982) est un des grands représentants de la pensée libérale française d’après-guerre.
Dans Le génie de L’Occident, publié en 1969, Rougier se donne pour objectif de définir le propre de la civilisation occidentale, ce qui la distingue des autres civilisations. La réponse est donnée dès les premières lignes de l’ouvrage. Les Occidentaux se distinguent par une mentalité singulière ; le prométhéisme :
« Arnold Toynbee prétend qu’il y a toujours un mythe fondamental qui préside à la genèse d’une civilisation. Ce mythe, pour la civilisation qui nous occupe, n’est pas difficile à découvrir : c’est celui de Prométhée ».
Pour Rougier, les civilisations reposent d’abord et avant tout sur un état d’esprit, persistant dans le temps, qui va commander tout leur développement. « En un mot, le psychologique prime le politique et l’économique ; et en définitive, le caractère d’une civilisation s’explique avant tout par un état d’esprit ». La mentalité, où l’état d’esprit, d’une civilisation désigne ainsi « la façon dont un peuple réagit aux défis de toutes sortes qui l’assiègent au cours de son histoire ». Le livre de Rougier s’attachera par conséquent à décrire la formation de la mentalité occidentale.
Cette mentalité prométhéenne permit aux Occidentaux d’accéder à l’idée de progrès, comprise comme « la possibilité d’améliorer sans cesse la condition humaine, grâce à la maîtrise de la nature par la connaissance de ses lois et grâce à une organisation de la société susceptible de sauvegarder la liberté des individus contre l’omnipotence de l’État et d’assurer à chacun des chances d’épanouissement ».
Pour Rougier, l’idéal d’autonomie est central dans notre civilisation. Cette autonomie ne peut être réalisée qu’à travers le développement d’une connaissance rationnelle de la nature, qui est le seul moyen de nous en rendre maîtres, ainsi que par l’établissement de formes de gouvernements fondées sur le consentement des gouvernés et le respect des libertés fondamentales.
La mentalité occidentale repose ainsi sur la conviction que nous sommes les acteurs de notre destin et non les jouets passifs de forces supérieures qui nous dépassent. Le mythe de Prométhée synthétise cet état d’esprit :
« Prométhée, c’est l’esprit de révolte contre les interdits des dieux jaloux, qui symbolisent les craintes de l’humanité primitive face aux forces aveugles de la nature, qui la dominent et qui l’effrayent. C’est l’esprit de curiosité et d’aventure qui pousse Ulysse vers des horizons inconnus, lui fait affronter les périls de la mer, les ruses de Poséidon, et surmonter les dangers qui l’assaillent à force d’intelligence et de courage. C’est le culte du travail et de l’effort qui incite Hercule à purger la terre de ses tyrans, de ses brigands et de ses monstres, à dompter les fleuves, à assainir les vallées, à percer les montagnes, à ouvrir des isthmes, à pacifier et à civiliser la nature. C’est la soif de connaître qui précipite Pline l’Ancien sur le Vésuve en éruption, quitte à perdre la vie. C’est l’esprit critique qui s’élève contre la superstition, cet esprit que célèbre Lucrèce en faisant l’éloge d’Épicure : « Alors que l’humanité traînait sur la terre une vie abjecte, écrasée sous le poids d’une religion dont le visage terrifiant menaçait les mortels du haut des régions célestes, un homme, un Grec, le premier, osa lever ses yeux mortels et se dresser contre elle », en libérant les humains des vaines terreurs de l’Achéron et du Tartare ».
Comme nous le verrons, Rougier s’emploie à montrer comment cet état d’esprit prométhéen s’est formé en Occident au fil des siècles. Notre objectif dans cet article sera de présenter les grandes lignes de son argumentation.
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Le rationalisme grec et l’invention de la démocratie
Rougier s’emploie tout d’abord à montrer comment les Grecs inventèrent la pensée rationnelle et la science et comment l’idée de démocratie en découla. En effet, les Hellènes inventèrent le raisonnement déductif et la pensée démonstrative ; « celle-ci ne se contente plus de l’évidence sensible, qui constate le comment des choses, elle cherche l’évidence intelligible qui en explique le pourquoi ». Les phénomènes naturels s’expliqueront désormais par des causes naturelles, et non plus par des mythes. Dans cet esprit, les Hellènes créèrent également l’astronomie mathématique. Ainsi, les pythagoriciens :
« […] ont pressenti, eux et leurs successeurs, la physique mathématique, en découvrant que l’univers a une structure dont les mathématiques peuvent rendre compte ; que les éléments qui le composent reproduisent certaines figures géométriques définies ; que les phénomènes qui s’y succèdent obéissent à des lois quantitatives immuables, et que le monde mérite vraiment le nom de cosmos, parce qu’en lui tout est ordre, nombre, poids et mesure ».
Pour Rougier, nous devons aussi aux Grecs l’idée d’appliquer le raisonnement mathématique (la géométrie) à la physique. En effet, pour lui, toute la physique expérimentale était en germe chez les astronomes grecs formés à la géométrie euclidienne pour qui la trajectoire des astres peut être décrite par des mouvements circulaires et uniformes. La redécouverte de leurs œuvres au XVe siècle rendra possibles la Renaissance et la révolution scientifique :
« C’est en les lisant que Léonard de Vinci, Tartaglia, Stévin, et surtout Galilée apprendront l’art d’appliquer les mathématiques à la nature, et réaliseront la révolution scientifique qui engagera la civilisation occidentale dans la voie de l’industrie et de la technique, qui transformeront la condition humaine ».
Nous leur devons par ailleurs l’idée de médecine scientifique.
Rougier montre ensuite comment la démocratie, l’économie monétaire et la « science de l’éthique » découlent, elles aussi, du rationalisme grec.
Pour les Grecs, la démocratie est le gouvernement de la loi, par opposition au gouvernement des hommes. La démocratie, c’est l’isonomia, c’est-à-dire l’égalité devant la loi. « Dans le respect des lois, chacun est libre de vivre à sa guise, de mener ses propres affaires comme il l’entend ». En effet, les Grecs ont conscience que l’égalité devant la loi est la condition de la liberté. Conséquemment, l’égalité des droits civils et politiques est accordée à tous les citoyens, riches et pauvres.
Les fonctions publiques sont ouvertes à tous, à l’exception de celle de stratège. Les magistrats sont tirés au sort et devront rendre compte sur la façon dont ils exerceront leur charge. Toutes les délibérations sont publiques.
Les Grecs inventent également la loi écrite :
« qui soumettait tous les citoyens à son empire, se soumettait elle-même à la raison. Dès qu’elle fut votée par l’Assemblée des citoyens, elle modifia tous les rapports humains, et créa une nouvelle vie sociale en substituant à l’obéissance hiérarchique la discussion entre égaux, à la cohésion du corps social obtenue par la force, celle obtenue par la persuasion ».
Du fait que les affaires de la cité sont soumises à la délibération collective de tous les citoyens, la puissance de la parole se trouva au cœur de la démocratie :
« Il s’agit de la vertu de l’argumentation dans une libre discussion, qui entraîne la conviction, et, par cela même, la décision. Toutes les questions, que les prêtres ou les rois se réservaient de régler sans appel, sont soumises à l’Assemblée, qui pèse le poids des arguments opposés, et, par son vote, tranche le débat ».
La publicité des débats et des décisions concernant les affaires de la cité devient la norme, ainsi que le contrôle « incessant de la communauté des citoyens sur l’exercice des magistratures de l’État », inaugurant la notion de « reddition de comptes », centrale à toute démocratie. À quoi il convient d’ajouter l’isonomie, évoquée plus haut, c’est-à-dire l’égalité des citoyens devant la loi. Ainsi « tous ceux qui participent à la gestion de l’État se proclament et se sentent homoioi : des semblables ; puis, d’une façon plus abstraite, des isoi : des égaux ».
Avec la démocratie, régime dans lequel les affaires de la cité deviennent celles de tous les citoyens, émerge le patriotisme, qui ne doit pas être compris comme la loyauté qu’un sujet doit à un prince ou un seigneur, « mais comme le sentiment qu’en défendant la cité, on défend un bien commun, et par conséquent, un bien propre ». L’ouverture des fonctions publiques et la participation de tous les citoyens aux affaires de l’État, inclinent par conséquent chacun à identifier le bien de la cité avec son bien propre.
Le rationalisme en moral donna naissance à l’idée selon laquelle la raison permet de connaître le souverain bien et les moyens pour l’atteindre. Une vie morale est une vie conforme à la raison ; « qui consiste à tempérer les passions et à subordonner toutes ses facultés au contrôle de la raison ». La vertu suprême est le juste milieu, l’arété, dont la démesure, l’hubris, est le pendant. Une vie bonne, raisonnable, est synonyme d’ordre et d’harmonie, qu’il s’agisse de la vie intérieure de l’individu ou de la vie de la cité. « L’harmonie, qui fait la bonté de l’âme, fait aussi la beauté des corps. Pour le Grec, le beau est la splendeur du bien, et la kalokagathia, une belle âme dans un beau corps, est l’expression de l’humanisme antique ».
Les Grecs inventèrent également l’économie monétaire et donnèrent avec Athènes l’exemple d’une première économie de marché, dont la division du travail, les échanges commerciaux internationaux et l’innovation technique garantirent la prospérité.
En résumé, le « rationalisme grec » est tout simplement à la base de toute la civilisation occidentale moderne :
« Sans lui, la révolution scientifique du XVIIe siècle, qui commande la révolution industrielle du XVIIIe siècle et l’avènement de la révolution technicienne du XXe siècle, eût été inconcevable.
Sans lui, l’idée de gouvernement par la loi dont on a préalablement délibéré, en en pesant les conséquences, et qu’on a librement acceptée suivant une procédure consentie, n’aurait pas été le levain qui présida, au XIVe siècle, à la naissance des Parlements, et qui conduira, à la fin du XVIIIe siècle et dans le cours du XIXe, à l’événement des grands États démocratiques.
Sans lui, une certaine conception de l’autonomie de la personne humaine, appelée à développer harmonieusement toutes ses facultés et à choisir son propre destin, et qui, sous le nom d’humanisme, s’oppose à cet individu embrigadé et fonctionnarisé que les Allemands appelleront Teilmensch, aurait pu ne pas s’imposer comme un idéal et un espoir.
Sans lui, nous en serions peut-être encore à un âge mythique et magique, avec toutes ses superstitions, ses tabous et ses contraintes. Persée tuant la Méduse, c’est le symbole du génie grec : la raison s’affranchissant des maléfices de la fable ».
Horreur
Augmentée
Sélection de textes de
Zero HP Lovecraft
Horreur
Augmentée
Sélection de textes de
Zero HP Lovecraft
L’ordre romain
Le chapitre III insiste sur l’invention du droit par les Romains. En effet, l’idée d’un droit écrit, abstrait, impersonnel et universel est un legs de la civilisation romaine :
« Les principes du droit romain tendent à s’identifier avec ceux du « droit naturel », que les stoïciens considèrent comme un code moral, implanté en tout être doué de raison. C’est ainsi que Gaius définit le jus gentium, comme « la loi que la raison naturelle a établie dans toute l’humanité » » .
Le droit romain se présente comme « la raison écrite » et inspirera, plus tard, les théoriciens du droit naturel, John Locke et les pères fondateurs des États-Unis, tout autant que les révolutionnaires français.
Sous l’empire, émerge également la conscience chez les peuples européens d’appartenir à une même civilisation :
« À partir du début du second siècle, l’Empire n’est plus qu’une fédération de cités, chacune jouissant des mêmes droits, groupées autour de la plus puissante d’entre elles : Rome, tutrice et législatrice de l’Univers qui les gouverne à l’aide des mêmes lois et de la même administration. Au droit des étrangers, au droit latin, s’est substitué partout le droit romain. À l’exploitation des provinces, en vertu du droit de conquête, a succédé leur sauvegarde en vertu du droit des gens, qui, sous les Antonins, tend à se confondre avec le droit naturel ».
Les Romains développèrent également des machines à vapeur et firent preuve d’une grande maîtrise de l’ingénierie et de l’architecture, comme en témoignent les vestiges des aqueducs. Certaines grandes villes, comme Rome, bénéficiaient même du « tout-à-l’égout » et de l’eau courante. L’école d’Alexandrie, fondée au IIe siècle av. J.-C. par Ctésibios, connaissait les principes de l’hydraulique et de la pneumatique leur permettant de créer des automates :
« L’exemple le plus significatif est celui d’un jouet : l’éolypile, « la boule d’Éole ». Pour l’actionner, Héron utilise le principe de la chaudière tubulaire et du robinet de Watt, dans un appareil appelé aussi Milliaron, par suite de sa ressemblance avec les bornes militaires. Or jamais l’idée ne lui vint de brancher son éolyphe sur une machine-outil, d’en faire une turbine à vapeur pour soulager l’effort humain ».
Mais si les Grecs et les Romains étaient aussi avancés intellectuellement, s’ils connaissaient déjà les « arts mécaniques » notamment (école d’Alexandrie), pourquoi cette antique civilisation n’accoucha pas de la révolution industrielle ? Les raisons principales, selon Rougier, sont à chercher du côté de la dévalorisation du travail manuel et de la technique au profit d’une conception purement contemplative de la science, recherchée pour elle-même, et de l’institution de l’esclavage :
« L’esclavage empêcha le développement du machinisme et des sciences appliquées ; l’insuffisance du machinisme, par un cercle vicieux inévitable, renforça la nécessité de l’esclavage, au point de le rendre statutaire. Parce qu’accompli le plus souvent par les esclaves, le travail manuel, artisanal et mécanique, fut disqualifié. Parce que disqualifiée, l’attention des savants s’en détourna, et la science prit un aspect le plus souvent théorique, spéculatif, sans aucun souci d’applications pratiques susceptibles de soulager la peine des hommes et d’améliorer leur condition ».
Avec une main-d’œuvre bon marché abondante, le besoin de soulager le travail des hommes en ayant recours à la technique se fait moins pressant. L’enseignement devient purement littéraire, tourné vers l’étude des grands classiques au détriment de l’étude des mathématiques et des arts mécaniques. En induisant un mépris pour les sciences appliquées, l’esclavage eut, de plus, pour conséquence l’arrêt du progrès scientifique et de l’esprit d’entreprise :
« Non seulement les sciences fondamentales périclitent, mais leurs applications techniques, les inventions pneumatiques et hydrauliques de Ctésibos, de Héron et de leurs successeurs, ne sont pas exploitées. Les architectes et les ingénieurs de l’Empire romain n’apportent aucune amélioration révolutionnaire aux procédés que leur ont légués le monde hellénistique et l’Italie républicaine. Les propriétaires, les constructeurs, les exploitants préfèrent investir en machines humaines plutôt qu’en machines de bois ou de fer, étant donné l’affluence et le prix modique des esclaves. Avec l’esclavage croissant s’éteint l’esprit d’entreprise ».
En outre, la civilisation antique ne sut penser l’idée de progrès du fait d’une conception cyclique du temps. En effet, celle-ci présuppose une vision linéaire du temps et une philosophie de l’histoire pour laquelle l’histoire est téléologiquement orientée.
Si les Grecs inventèrent la science démonstrative et l’organisation rationnelle de la cité, ils échouèrent cependant à promouvoir les sciences appliquées qui leur auraient permis de domestiquer les forces de la nature au service de l’homme.
Le christianisme, en condamnant l’esclavage et en réhabilitant le travail manuel et la technique, produisit toutefois à cet égard une révolution sociale et morale.
Le Moyen Âge
Avec le Moyen Âge et la christianisation des sociétés européennes, le rapport au travail et à la technique évolua. En effet, proclamant l’égale dignité des hommes et la nécessité du travail pour tous, le christianisme provoqua une revalorisation du travail manuel et des « arts mécaniques ». La glorification du travail artisanal suscita des innovations importantes, comme le moulin à vent et le moulin à eau :
« Entre le Xᵉ et le XIe siècle, l’emploi de l’énergie motrice que représente le moulin à eau se généralise explosivement, grâce à l’abondance des cours d’eau. Il va provoquer une véritable révolution industrielle, basée sur la mécanisation des divers métiers ».
« Ainsi, dans tous les domaines, dans l’exploitation agricole, dans l’exploitation du sous-sol, dans l’exploitation du monde animal, dans les techniques du feu, dans les procédés chimiques, dans l’armement, dans les grands travaux, des progrès techniques sont réalisés. Grâce à la disparition progressive de l’esclavage, grâce à la sécurité relative que procurent les grandes monarchies féodales qui se constituent à partir du XIe siècle, une civilisation technique s’esquisse et se développe, qui va modifier considérablement la vie économique et sociale, et l’attitude de l’homme en face du monde ».
Toutefois, les innovations techniques du Moyen Âge se développèrent pour répondre aux besoins nés de l’accroissement de la population, du climat, du développement de la vie urbaine, des guerres et du commerce. Elles ne furent pas le fruit de la science appliquée. Pour cela, il faudra attendre la Renaissance et la redécouverte des œuvres des savants grecs pour que la science moderne prenne enfin son essor ; ce qui impliquait de l’emporter d’abord sur la culture purement livresque promue par l’Église par le truchement de l’étude des Écritures et de la pensée d’Aristote.
Adaptation de la nouvelle de
Lovecraft en animation grâce
à l’IA
Adaptation de la nouvelle de
Lovecraft en animation
La Renaissance et la redécouverte de l’Antiquité
À la faveur de la redécouverte de l’Antiquité, l’humanisme de la Renaissance, d’abord dans la Florence des Médicis, puis dans toute l’Italie, va mettre à mal le théocentrisme pour lequel « l’homme et la création n’existent que pour Dieu, pour Le glorifier et Le servir ». Alors que la vie terrestre était principalement vue comme une épreuve préparant au salut après la mort pour le christianisme, l’avènement de l’humanisme à partir du XIVe siècle consacrera le bonheur terrestre comme un objectif légitime, justifiant que l’on utilise la science et les arts mécaniques afin de rendre l’homme « comme maître et possesseur de la nature » et soulager sa peine. De contemplative, la science devint ainsi opérative. Elle devra désormais être utile et satisfaire les besoins des hommes. Dorénavant, l’homme existera et vivra pour lui-même et la science et les techniques l’aideront dans cette entreprise :
« L’exhumation par les humanistes de la civilisation gréco-latine, qui pendant un millénaire avait atteint les sommets de la science, de la philosophie, de la littérature et de l’art, dans une indépendance totale à l’égard du judaïsme et du christianisme, fut une révélation plus bouleversante pour les esprits que ne devait l’être celle provoquée par les grandes découvertes. […] Une civilisation avait existé où les hommes n’avaient pas entendu parler de Moïse et du Christ, ignoraient le péché originel et les sanctions infernales, ne jetaient pas l’anathème sur la nature, déchue et corrompue, mais la suivaient comme une conseillère de sagesse et une institutrice de beauté. Une civilisation avait existé, où les rites étaient séparés des croyances, où l’intelligence n’était pas humiliée devant la foi, où le désir de savoir n’était pas taxé de concupiscence périlleuse ».
Cette renaissance concernait autant la science que les arts. Les artistes italiens (Michel-Ange, Botticelli, Léonard de Vinci, Raphaël, etc.) commencèrent à s’inspirer de l’art gréco-romain, renouvelant les canons de l’art occidental.
La Renaissance est également l’époque de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492, ouvrant l’ère des grands explorateurs (Amerigo Vespucci, Vasco de Gama, etc.) qui repousseront les limites du monde connu.
La révolution scientifique
Le XVIe siècle verra la révolution scientifique initiée par Nicolas Copernic (1473-1543), Léonard de Vinci (1552-1619), Francis Bacon (1561-1626) et Galileo Galilei (1561-1643). La science, visant dorénavant l’utilité, cesse d’être purement spéculative pour devenir opérative ; les « arts mécaniques » de l’Antiquité sont réhabilités. Les grands savants de la Renaissance, comme Léonard de Vinci ou Galilée, sont autant ingénieurs que purs savants.
C’est aussi à cette époque que l’on invente la méthode expérimentale moderne :
« La méthode scientifique repose sur une analyse de l’expérience qui ne se borne pas à enregistrer passivement le témoignage des sens, mais qui décompose les éléments de la perception, en les isolant un par un de leur contexte, souvent à l’aide d’expériences purement mentales, qui réalisent de véritables passages à la limite, et à l’aide d’instruments d’observation et de mesure tels que ceux que Galilée invente ou améliore : la lunette, le microscope, le thermomètre, l’horloge à balancier que met au point Huygens. Les lois que cette méthode permet de découvrir s’expriment sous forme de fonctions mathématiques, car « le livre de la nature est écrit dans le langage géométrique ». L’induction baconienne, qui permet de formuler des hypothèses suggérées par l’expérience, doit être complétée par la méthode hypothético-déductive, qui permet de déduire mathématiquement, à partir des hypothèses retenues, des conséquences susceptibles d’être soumises au verdict de l’expérimentation ».
La méthode scientifique se caractérisera par l’observation rigoureuse, l’expérimentation contrôlée, et l’utilisation de la logique mathématique pour formuler des lois universelles. Le scientifique jouera désormais un rôle actif en concevant des expériences pour isoler certains aspects de la réalité et faire varier différentes grandeurs physiques, ceci dans le but de tester ses hypothèses en cherchant à expliquer les phénomènes par des lois générales exprimées sous forme de fonctions mathématiques.
Une nouvelle cosmologie
Avec la Renaissance et l’essor de la science moderne, les Occidentaux passent d’une conception du cosmos comme d’un monde clos à celle d’un univers infini. La vision aristotélicienne du monde, qui divisait la réalité en un monde sublunaire, domaine de la contingence, du changement et de la corruption, et un monde céleste, domaine des sphères célestes incorruptibles, est abandonnée. En effet, avec Copernic et Galilée, l’héliocentrisme supplante le géocentrisme. La terre perd son privilège de centre de l’univers, le soleil, centre de notre système planétaire, n’étant lui-même qu’un astre parmi des millions d’autres au sein d’une vaste galaxie abritant potentiellement des millions de mondes. À la place du monde clos et hiérarchisé des Anciens, l’homme moderne se retrouve confronté à « un univers infini, dont le centre est partout et la circonférence nulle part ».
Alors que Copernic, le premier, mit à mal le modèle géocentrique, Kepler et Galilée consolidèrent l’idée d’un univers régi par des lois mathématiques précises, accessibles par l’observation et l’expérimentation, tandis que Sir Isaac Newton, en établissant la synthèse des lois du mouvement et de la gravitation universelle, fondera, à la fin du XVIIe siècle, un cadre cohérent pour la physique classique.
L’invention du progrès
L’idée de progrès commence également à s’imposer en Occident. Celle-ci distinguera radicalement l’Occident des civilisations qui ont une vision cyclique du temps. En effet, à partir du XVIIe siècle, les Occidentaux commencent à regarder l’avenir avec confiance. La flèche du temps pointe vers un futur gros de promesses radieuses. Chaque génération apporte son lot de connaissances supplémentaires à celles léguées par les générations passées, de sorte que « toute la suite des hommes, pendant le cours de tant de siècles, doit être considérée comme un même homme, qui subsiste toujours et qui apprend continuellement » comme le souligne Blaise Pascal.
Le respect des Anciens consistera désormais à mettre à profit leurs contributions et à corriger leurs erreurs « en invoquant l’expérience et la raison », non à les répéter servilement en invoquant leur autorité.
Avec le XVIIIe siècle s’imposeront la notion de « perfectibilité de l’homme » et l’idée d’un progrès infini des mœurs. En développant la science et les techniques, l’humanité approfondit sa connaissance des lois de la nature et se donne les moyens d’en devenir « comme maître et possesseur » selon la formule de Descartes. On croit dorénavant à la toute-puissance de l’éducation pour transformer les individus et à celle de la législation pour transformer les peuples. Pour Helvétius, « l’esprit, le génie et la vertu sont les produits de l’instruction », et non des dons innés, tandis que Diderot décrète que « si les lois sont bonnes, les mœurs sont bonnes, et elles sont mauvaises si les lois sont mauvaises. Le législateur forme à son gré des héros, des génies et des hommes vertueux ». L’esprit est dès lors vu comme une table rase sur laquelle on peut imprimer ce que l’on veut. Il n’y a dès lors plus de nature humaine immuable. D’éclairés éducateurs et législateurs peuvent tenter façonner l’homme idéal. On connaît le succès qu’aura cette idée à gauche jusqu’à nos jours.
Ainsi, à mesure que se développent les sciences et l’industrie humaine, l’histoire commence à être comprise comme un processus téléologiquement orienté vers l’accomplissement de l’humanité (moral, scientifique, économique, etc.) et son bonheur terrestre. L’homme occidental s’affirme comme acteur autonome de son histoire, confiant dans l’idée que ces progrès moraux, politiques, économiques et scientifiques sont dus à ses seules capacités et à ses efforts.
Cette prise de conscience de l’historicité des sociétés humaines suscitera de nombreuses philosophies de l’histoire, mais toutes « admettront que l’homme est l’artisan conscient et responsable de sa destinée. Il n’est pas un instrument passif, le jouet de forces cosmiques ou surnaturelles, ce qui lui procurerait à la fois une excuse, un alibi ».
Le Moment
Straussien
Ebook offert à nos tipeurs
sans montant minimum
Le Moment
Straussien
Ebook offert à nos tipeurs
sans montant minimum
Le capitalisme et l’éthique protestante
Un autre grand pilier de la modernité se met en place progressivement à partir du XVIe et XVIIe siècle ; le capitalisme. Pour Rougier, la mentalité capitaliste est principalement attribuable à l’expansion du commerce et à la Réforme protestante, calviniste surtout.
En effet, l’Église catholique, au Moyen Âge, condamnait le commerce et la recherche des richesses comme des activités peccamineuses. Le prêt à intérêt était condamné comme relevant de l’usure. « La pratique de l’intérêt revient à « vendre le temps » ; or le temps ne peut être propriété individuelle : le temps n’appartient qu’à Dieu ». L’argent n’avait pas vocation à être thésaurisé ou investit. Il devait être dépensé.
De plus, le droit corporatif et le droit canon soumettaient la production à une réglementation tatillonne, bloquant tout développement économique :
« Dans une corporation, tout est réglementé : la durée de l’apprentissage, le nombre des compagnons, le taux des salaires, les heures de travail, la technique de la production. Ce n’est pas le procédé le plus rapide et le plus efficace, mais le plus lent, celui qui exige le plus de main-d’œuvre, qui est préféré. : toute nouveauté est suspecte, et ne peut être introduite qu’après accord préalable des anciens de la corporation et des juges de la ville. On aboutit à un malthusianisme économique ».
À partir du XVIe siècle, la réforme protestante, le calvinisme en particulier, va complètement bouleverser le rapport des sociétés occidentales au commerce et à la richesse. Sous l’effet de cette doctrine religieuse, le travail professionnel sera promu à la dignité d’un service divin.
Rappelons d’abord rapidement les dogmes promus par Jean Calvin (1509-1564). Celui-ci repose sur cinq dogmes ; la « dépravation totale » – à cause du péché originel les hommes sont esclaves du péché. « L’élection inconditionnelle », ou prédestination ; Dieu sait d’avance qui sera sauvé. « La grâce irrésistible » : nul ne peut rejeter l’appel de Dieu. « L’expiation limitée » : le sacrifice du Christ sur la croix ne vaut que pour une poignée d’élus, prédestinés à être sauvés, et non pour l’humanité entière. Et enfin, la « persévérance des saints » : quiconque possède la foi ne saurait la perdre. Comme tout bon protestant qui se respecte, les calvinistes souscrivent également au dogme de la « justification par la foi seule » (sola fide), et n’admettent que la seule autorité des Écritures (sola scriptura).
La foi salvifique se faisant connaître par les fruits qu’elle donne, la réussite dans les affaires sera interprétée comme un signe d’élection. Les calvinistes, rejetant toute distinction du temporel et du spirituel, du politique et du religieux, entreprennent de christianiser toutes les formes de l’activité humaine. Il n’est pas de meilleure manière de participer au plan divin qu’en se vouant à sa vocation professionnelle. De cette tournure d’esprit naîtra le culte du travail, le sens de l’épargne et de l’investissement auxquels on associe volontiers les pays protestants :
« Calvin, qui gouverne une cité industrielle et commerçante, reconnaît, avec un sens aigu des nécessités économiques, la valeur productive de l’argent, le rôle du crédit, la légitimité du prêt à intérêt perçu en argent, à la seule condition de la bien distinguer, par un taux légitime, de l’usure, qui prétend entretenir son homme sans travailler avec la dépouille de l’impécunieux ».
Dieu accorde aux hommes des talents pour qu’ils les fassent fructifier. C’est faire injure à sa providence que de les négliger :
« Il est licite de travailler de la manière qui vous assure le gain légitime le plus élevé. Vous avez le devoir de mettre en œuvre et de développer le plus possible vos facultés et vos talents ».
Travailler est un devoir. Perfectionner ses dons est le meilleur moyen pour participer à la gloire de Dieu. Le principe d’efficience, véritable impératif catégorique des pays capitalistes, est une conséquence économique de cette théologie. On voit ainsi tout ce que la mentalité capitaliste, du sens de l’effort, de l’épargne et de l’investissement et de l’efficacité maximale dans l’utilisation des ressources, doit à l’éthique protestante :
« L’éthique protestante, substituée à l’éthique catholique médiévale, crée ainsi la mentalité capitaliste : en faisant accepter aux masses la discipline du travail ; aux consommateurs, l’uniformisation des produits et des services ; aux chefs d’entreprises, l’art de s’enrichir en économisant, ce qui leur permet d’investir ».
Cette mentalité va progressivement se séculariser dans les siècles qui suivront et pénétrera toutes les couches des populations occidentales.
La révolution économique
Révolution économique, politique et industrielle seront les conséquences lointaines de ce basculement dans la mentalité collective. La première, la révolution économique, résulte de la découverte des lois de l’économie de marché. Les Occidentaux découvrent les vertus de la division du travail et des échanges économiques. En effet, les économistes français, Turgot et les physiocrates comme Quesnay (1694-1774) en tête, et les économistes écossais, comme Adam Smith, comprennent que l’économie n’est pas un jeu à somme nulle dans lequel les gains des uns seraient les pertes des autres. Il est possible de s’enrichir mutuellement par le commerce. Cela vaut pour les individus, comme pour les nations.
Au XVIIIe siècle, l’Europe découvre ainsi les vertus du libre-échange. La célèbre formule de Gounay « laissez faire, laissez passer » :
« […] était une arme de guerre pour abattre les douanes intérieures et les frontières entre les peuples. Elle se justifiait par cet ordre naturel et providentiel qui, grâce à la loi de l’offre et de la demande sur les marchés concurrentiels, adapte spontanément la production aux besoins de la consommation. Le rôle du souverain consistait à empêcher que le jeu des lois naturelles ne soit faussé par des coalitions d’intérêts ».
Louis Rougier crédita Adam Smith d’avoir fondé la science économique moderne avec son ouvrage La richesse des nations, publié en 1772, dans lequel l’économiste écossais explique que l’intérêt individuel est le moteur principal de l’action humaine. C’est le souci de leur intérêt personnel qui pousse les hommes à accomplir le travail pour lequel la société consent à les payer. Comme l’explique Smith dans sa célèbre citation :
« Ce n’est pas à la générosité du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous devons notre repas, mais au souci que chacun a de son intérêt personnel. Ce n’est pas à leur humanité que nous faisons appel, mais à leur égoïsme, et nous ne leur parlons jamais de nos besoins, mais de leurs avantages ».
La concurrence jouera un rôle modérateur dans la recherche de l’intérêt personnel en empêchant les uns et les autres d’abuser de leur position avantageuse. En effet, si un commerçant pratique un prix que les consommateurs jugent trop élevé, ils iront voir ses concurrents. Si un employeur paie ses employés à un salaire inférieur à ceux pratiqués par ses concurrents, il risque de se retrouver sans main-d’œuvre. Par l’action de la loi de l’offre et de la demande, les prix et les salaires se fixent spontanément à un niveau satisfaisant le producteur et le consommateur, le vendeur et l’acheteur de travail, sans qu’il ne soit nécessaire que l’État intervienne :
« En bref, qu’il s’agisse du marché du travail, du capital, des produits ou des services, la loi de l’offre et de la demande, utilisant l’intérêt individuel comme élément moteur, et la concurrence comme élément modérateur, tendra, par le mécanisme des prix, à fixer les salaires, les profits, les taux d’intérêt, les prix, au point d’équilibre qui permettra à toute l’offre disponible d’être acceptée et à toute la demande solvable d’être satisfaite. […]
« Le mécanisme du marché n’explique pas seulement l’équilibre spontané qui tend à adapter l’offre à la demande, la production aux besoins. Il explique la dynamique économique, c’est-à-dire les forces qui incitent les sociétés, comme les individus, à accroître sans cesse leur revenu. L’explication réside dans le désir naturel de l’homme d’améliorer sa situation, ce qui le conduit à épargner et à employer productivement son épargne, d’où résulte, comme l’avaient bien vu les prédicateurs protestants, l’accumulation du capital ».
Adaptation de la nouvelle de
Lovecraft en animation grâce
à l’IA
Adaptation de la nouvelle de
Lovecraft en animation
La révolution industrielle
Conséquence des révolutions scientifique et économique décrites plus haut, la révolution industrielle, à partir du XVIIIe siècle, va profondément bouleverser les sociétés occidentales. Pour Rougier, la révolution industrielle peut être comprise comme :
« […] la substitution de la machine, actionnée par une énergie naturelle, à l’outil actionné par la force musculaire de l’homme, et simultanément, la substitution d’énergies régulières et utilisables à volonté (telle la force de la vapeur, en attendant l’énergie chimique, électrique, nucléaire), à des énergies aléatoires (celle de l’eau et de l’air) qui dépendant de la configuration du sol, du climat, des intempéries ».
Le développement de la machine à vapeur fut l’agent principal de ces transformations. Celle-ci suscita une profonde transformation des mentalités et des structures sociales. Les chemins de fer accélérèrent grandement les échanges et contribuèrent fortement à unifier les pays d’Europe, contribuant à l’émergence du sentiment national.
Le développement du moteur à essence, via l’exploitation du pétrole, bouleverse les transports. L’exploitation de l’électricité, et la possibilité de transformer le courant alternatif, continu et triphasé, permettant de transporter cette énergie à distance, révolutionne les télécommunications en rendant possibles le télégraphe, puis le téléphone inventé par Graham Bell en 1875.
La révolution industrielle s’accompagne d’une révolution de l’agriculture qui mettra fin aux disettes et aux famines. En effet, les engrais chimiques décupleront le rendement des terres en fournissant aux sols, dans les proportions désirées, les trois éléments nourriciers que sont le phosphore, l’azote et le potassium. La mécanisation et la motorisation agricoles permirent, de leur côté, de remédier à la pénurie de main-d’œuvre et d’accroître les rendements tout en soulageant la peine des hommes.
Les conditions de vie furent bouleversées, l’espérance de vie augmenta considérablement :
« La première révolution industrielle a bouleversé complètement la structure des sociétés dans les pays où elle s’est développée. Elle a fait disparaître l’esclave et le serf, remplacés par l’ouvrier d’usine. Elle a substitué aux corporations artisanales les syndicats ouvriers et les comités d’entreprise. À côté du monde du travail, elle a développé les différentes formes de capitalisme : financier, commercial, industriel, privé, collectif, étatique. Aux civilisations aristocratiques, artisanales, et qualitatives d’autrefois, elle a substitué les sociétés démocratiques, industrielles et quantitatives d’aujourd’hui ».
Un nouveau monde naît de la révolution industrielle. ; de nouveaux modes de vie, de nouvelles classes sociales, de nouveaux modes d’organisation, etc.
Pour Rougier, la révolution de la cybernétique au XXe siècle doit être comprise comme une nouvelle révolution industrielle, prolongeant les bouleversements du siècle précédent.
La révolution politique
Une révolution politique résulta de ces révolutions économiques et industrielles : la révolution démocratique et libérale dont les révolutions anglaises, américaine et française aux XVIIe et XVIIIe siècles sont les exemples paradigmatiques. Les gouvernements reposent désormais sur le consentement des gouvernés et ne sont institués qu’afin de garantir leurs droits et leurs libertés. Le rapport des gouvernés à leurs gouvernants s’en trouve bouleversé.
Pour Rougier, cette révolution politique est le fruit d’un long processus historique remontant à l’Antiquité et au christianisme. En effet, le christianisme, en introduisant la distinction du temporel et du spirituel, met fin à l’idolâtrie de l’État :
« Au-dessus de la cité terrestre, il y a la cité céleste ; au-dessus de la loi juridique, il y a la loi morale. L’homme n’est plus l’esclave du maître du jour, il est le serviteur de Dieu. Il a un for intérieur, une conscience inviolable, un jardin secret que nul ne peut enfreindre, et la mystique chrétienne a entouré d’une sextuple enceinte le château de l’âme. Il a un idéal de perfection qu’il doit servir, même contre la raison d’État. Le martyr chrétien demeurera, jusqu’à la fin des temps, le prototype du défenseur des droits imprescriptibles de la conscience humaine ».
La loi divine impose une limite morale à l’exercice du pouvoir temporel des États qui devront se conformer à un principe de légitimité supérieur. L’Église se posera ainsi comme la gardienne de l’ordre spirituel auquel l’ordre temporel doit se soumettre.
Le christianisme diffusera dans tout l’Occident les idées d’unité du genre humain et de l’égalité de tous les hommes au regard de Dieu. Ces idées saperont les justifications traditionnelles de l’aristocratisme. Selon Rougier, avec le triomphe du christianisme en Occident, il n’existera désormais plus que des « aristocraties de fait » plutôt que des « aristocraties de droit ou de nature » :
« Bien que l’Église, en tant que corps organisé ayant des intérêts temporels, fût le plus souvent l’alliée des souverains, des nobles, des grands feudataires, néanmoins, en reniant le fondement idéologique des gouvernements aristocratiques, en donnant une voie à la revendication des pauvres et des faibles, le christianisme, tel qu’il fut vécu dans l’âme des croyants, rendit possible l’avènement des démocraties modernes, et concourut sentimentalement à les établir ».
Toutefois, Rougier tempère ce jugement en soulignant que l’Église catholique n’invoqua la distinction du temporel et du spirituel que lorsqu’elle se sentait menacée. En position de force, elle aspira à les confondre, car elle incline naturellement à la théocratie, c’est-à-dire à une société dans laquelle Dieu est roi, comme en témoigne la doctrine du « césaro-papisme ». Cette tendance n’est cependant pas propre à l’Église catholique et se retrouve aussi dans les diverses églises protestantes.
Le principe de division des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, est repris des pensées d’Aristote, de Polybe et de Cicéron et deviendra un pilier des démocraties libérales sous les plumes de John Locke et de Montesquieu au XVIIe et XVIIIe siècle.
Comment faire en sorte que le pouvoir confié aux gouvernants par les gouvernés ne devienne pas tyrannique ? « Comment limiter constitutionnellement le pouvoir ? » Ou, pour le dire dans les termes de Montesquieu, comment faire en sorte que « le pouvoir arrête le pouvoir » ?
Pour Rougier, nous devons en outre à l’Angleterre cinq institutions visant à protéger les libertés individuelles : « le régime représentatif, le bicamérisme, l’habeas corpus, le gouvernement constitutionnel (c’est-à-dire un régime politique obéissant à des règles supérieures au gouvernement), et le parlementarisme ».
Quoiqu’elles ne visassent qu’à consacrer les privilèges des seigneurs féodaux anglais, on considère que la Magna Carta de 1215 exprima les principes du droit moderne. Ces principes sont 1) le roi doit respecter les droits du peuple anglais. S’il les bafoue, le peuple a le droit de se révolter. 2) Aucun homme ne peut être emprisonné ou exilé sans avoir eu droit à un procès équitable. Principe qu’expliciteront et consacreront l’Habeas corpus de 1679 et le Bill of rights de 1689. 3) « Pas de taxation sans représentation ». Le roi ne peut lever un nouvel impôt sans le consentement exprès de ses sujets.
La « glorieuse révolution » anglaise de 1688 établira le triomphe du Parlement qui assumera seul le pouvoir législatif, tandis que les juges assureront le pouvoir judiciaire. Le juge et le Parlement deviennent les garants des lois et des libertés britanniques.
La révolution américaine de 1776 consacrera les principes de souveraineté populaire et les droits de l’individu. S’inspirant fortement du Second traité du gouvernement civil de John Locke, la Constitution fédérale des États-Unis (1787) s’appuiera sur l’idée selon laquelle :
« La société politique résulte d’un contrat original, par lequel un certain nombre d’hommes indépendants ont consenti à aliéner une part de leur liberté primitive, celles dont ils disposaient à l’état de nature, pour défendre, de toute la force du corps social ainsi constitué, les libertés fondamentales, notamment la liberté individuelle et la propriété privée. Le consentement populaire est la seule légitimité d’un gouvernement. Il suit de là qu’il ne peut y avoir de gouvernement absolu ».
En France, au moment de la Révolution, la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » du 26 août 1789 consacrera également les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme » dont la sauvegarde est le but unique du gouvernement. Ces droits sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ». La souveraineté réside dans la nation. La loi est « l’expression de la volonté générale » et doit être identique pour tous (égalité devant la loi). Cette Déclaration des droits de l’homme décrète pareillement « l’ouverture des carrières aux talents », sans distinction d’ordres et de classes sociales (autrement dit, la méritocratie). Elle consacre aussi la liberté d’expression : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Tout citoyen peut parler, écrire et publier librement, « sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Autrement dit, la liberté d’expression est garantie par la Déclaration, mais elle n’est pas absolue.
La conception libérale de l’État repose sur la reconnaissance des droits naturels de la personne humaine. Les individus ne doivent aliéner à la puissance publique que ce qui est strictement nécessaire à la protection des libertés fondamentales :
« Une société se révèle d’autant plus prospère, heureuse et apte à résoudre pacifiquement ses propres conflits intérieurs, qu’elle laisse plus de liberté aux individus pour entreprendre, discuter, décider du meilleur emploi de leurs facultés et de leurs biens ; qu’elle est plus ouverte et permet une rapide circulation des élites ; qu’elle permet à l’État de réaliser d’autant mieux ses fonctions propres, qu’il n’entreprend pas de réaliser celles dont s’acquittent pour le mieux les individus, les familles, les collectivités locales, les associations particulières : en un mot, qu’elle laisse les individus plus libres d’administrer leurs propres affaires, dans le respect des lois garantissant le bien commun ».
L’essor de l’Occident
L’essor de la civilisation occidentale est ainsi le fruit des effets cumulés de la révolution scientifique, de la révolution économique, de la révolution industrielle et de la révolution politique.
La libéralisation des sociétés occidentales et l’ouverture des carrières aux talents, libérèrent des énergies qui ne demandaient qu’à être employées. L’extension graduelle à toutes les couches de la population de la scolarisation, couplée à la méritocratie, rendit possible une circulation continuelle des élites conduisant « au sommet de l’échelle sociale une bourgeoisie d’hommes entreprenants, de producteurs, de techniciens, à la place d’un clergé et d’une noblesse à laquelle, dans certains pays, toute activité lucrative était interdite ».
Conclusion :
En résumé, Louis Rougier nous offre, dans cet ouvrage, le récit d’une humanité occidentale qui, à l’image de Prométhée, dérobe le feu des Dieux pour en faire don au reste de l’humanité.
En réalisant l’idéal prométhéen qui était en gestation depuis l’époque de la Grèce et de la Rome antique, l’Occident arrive à sa pleine maturité avec la modernité. En maîtrisant les lois de la nature, grâce à la méthode scientifique, l’homme occidental l’assujettit à ses fins. Il n’est désormais plus le jouet passif d’une nature opaque qui l’écrase, il en devient comme « maître et possesseur » et prétend lui commander. Dans la mesure où les démocraties libérales prétendent exprimer l’autonomie de l’individu, les démocraties libérales peuvent également être vues comme l’expression de cet idéal prométhéen en politique. En effet, les États ont perdu leurs fondements mythiques et religieux, pour ne plus être que des organisations établies par les hommes pour garantir leur sûreté et leurs libertés fondamentales. Dès lors, l’homme devient un acteur politique, un citoyen, et non plus seulement un sujet d’un roi gouvernant au nom d’une loi divine. Le souverain n’est plus un monarque, mais le peuple. L’obéissance aux gouvernements sera dorénavant conditionnée au respect des droits naturels de l’individu et devra reposer sur le consentement des gouvernés.
Le propos de Louis Rougier date un peu et peut être enrichi avec la lecture de l’ouvrage de Joseph Heinrich « The Weirdest people in the world ». Pour réévaluer l’apport du Moyen Âge et du christianisme dans l’émergence de la modernité, on gagnerait à lire le livre de Rodney Stark, « How The West Won : The Neglected Story of the Triumph of Modernity ». Remettant en cause la thèse selon laquelle la Renaissance constituerait une rupture radicale avec un Moyen Âge ténébreux, Stark montre que les acquis de la modernité (la rationalité, la science moderne, le capitalisme, les principes de la démocratie libérale, etc.) sont le fait de tendances de long terme auxquelles le Moyen Âge et le christianisme auraient pleinement contribué.
On pourrait aussi objecter que Rougier propose une vision bien idéalisée de la démocratie libérale, dissimulant ses dysfonctionnements.
En effet, il y a quelques raisons d’être sceptique concernant les vertus supposées des régimes démocratiques. Pour n’en citer que quelques-unes ; Hayek, et Benjamin Constant avant lui, souligne, bien avant Peter Thiel, la tension existante entre le principe de la souveraineté du peuple et la protection des libertés fondamentales. Schumpeter montre de son côté que les notions de « Bien commun » ou « d’intérêt général » sont opaques. Les travaux de l’école des choix publics, Jason Brennan, Bryan Caplan montrent, en outre, que l’idéal démocratique, dans la mesure où il repose sur des hypothèses contestables, pour ne pas dire irréalistes, concernant la rationalité des électeurs, est largement illusoire. Par ailleurs, le système politique des démocraties « réellement existantes » ne repose pas sur un mécanisme de feed-back négatif qui lui permettrait de corriger ses erreurs et d’améliorer la qualité des politiques publiques. Les élections, censées fournir un tel mécanisme selon Schumpeter, semblent bien insuffisantes dans cette tâche. On gagnerait ici à lire les écrits de Curtis Yarvin sur la démocratie.
Un lecteur de Nick Land pourrait également souligner le défi que représentante pour le prométhéisme promu par Rougier l’accélération du développement technique et économique qui ne cesse de bouleverser en profondeur nos conditions d’existence. En effet, si on suit Land, ce processus est devenu autonome. Car l’accélération n’est pas un objectif qu’il faudrait promouvoir, mais quelque chose qui advient, que cela nous plaise ou non. L’homme n’est plus l’acteur de ces transformations, si tant est qu’il ne le fût jamais. Pis, il est même vain d’espérer les piloter, encore plus de croire que l’on peut les stopper. Il n’est d’autre espoir que de s’y adapter. Dans ces conditions, comment l’idéal prométhéen, au cœur de l’identité occidentale selon Rougier, pourrait subsister ? L’occident est à la croisée des chemins.
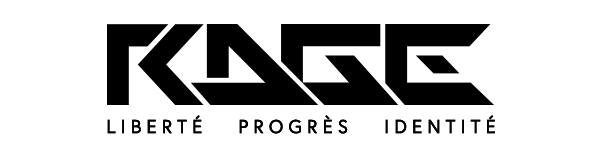







Banger
Merci, Picard’ssiette ! 😉