La réflexion présente est dans la droite ligne de ma conclusion de mon article sur la raison et le libre arbitre. Je concluais qu’il était nécessaire d’arrêter de vouloir un Bien immuable, la fin de l’Histoire. L’Histoire est toujours en marche, ce qui veut dire qu’il faut en accepter les péripéties. Encore une fois, nous nous trouverons en bute avec le marxisme, largement diffusé dans la pensée contemporaine, et cela à propos de la crise. Marx et Engels voyaient en la crise un défaut du capitalisme, une sorte de bug de la matrice qui le conduirait à sa perte. C’est ainsi qu’à chaque crise, le refrain inévitable de « l’échec du capitalisme » reparaît, sans jamais que la prophétie ne se réalise. La crise actuelle et future due au Covid-19 n’échappe pas à la règle. L’État intervient énormément, débloque beaucoup de fonds pour contrevenir à la crise. L’État veut arrêter la catastrophe. Et la population de gauche, très heureuse de recevoir de l’argent public (bien qu’en quantité insuffisante à son goût) fulmine de voir une masse plus conséquente aller aux entreprises. Ils en ont assez de la « socialisation des pertes et privatisation des gains ». Et ils ont raison.
Cependant, ils ne voient pas que c’est eux qui ont institué ce système, que ce seront eux les premiers qui hurleront si vous leurs dites « D’accord, laissons tout tomber, que l’État n’intervienne pas ». L’idée leur est insupportable. Car ce qu’ils voudraient, en somme, serait la nationalisation pure et simple. La social-démocratie ne leur suffit pas. En même temps, ils sont les cocus dans l’histoire, nous ne pouvons leur en vouloir. Mais nous en serons les victimes si nous ne mettons pas fin à ce statu quo insupportable pour eux, comme pour nous, et qui en réalité leur bénéficie.
En effet, je vais reprendre la thèse de Schumpeter sur la mort du capitalisme. Celle-ci se décompose ainsi : il faut d’abord rappeler ce qu’est le capitalisme, un moteur de production de richesse, par une organisation efficiente (mais non dénuée de défauts) et une promesse de récompense (mais non dénuée de mirages). Il faut alors voir son évolution, à la fois au niveau des acteurs et du marché, pour comprendre d’où arrive la mort : par la destruction « organique » du capitalisme — l’accaparement de la richesse par un certain nombre de gestionnaires plutôt qu’entrepreneurs — et par la destruction « symbolique » du capitalisme par une classe d’intellectuels parasites. Mais alors comment éviter la mort du capitalisme (Schumpeter lui-même l’annonçait en la déplorant) ? Il faut comprendre que la crise n’est absolument pas un bug de la matrice, absolument pas un défaut, c’est un mécanisme de rééquilibrage. La crise est inhérente au capitalisme, non comme un défaut, mais comme une vertu, car elle est la condition du progrès. Elle est le choc entre l’anticipation de profit (due à un nouveau débouché, une innovation, une opportunité quelconque) et la réalité. Et cette anticipation et sa différence avec la réalité aura toujours lieu, quelque soit l’anticipateur (institutionnel ou individuel). Seule la stagnation peut empêcher la crise, et voulons-nous stagner ? Le fait de vouloir effacer la crise est en fait un mécanisme de protection des élites contre le peuple (sans aucun manichéisme, les élites pouvant être vertueuses, le peuple mauvais, ou inversement, ou les deux de la même nature (bon ou mauvais)). Le refus de la crise protège le politicien contre la prise de pouvoir des masses, le riche contre l’appauvrissement. Le refus de la crise protège la cigale de la fourmi, en somme. Le système social en son entier est l’achat de la paix sociale, donc politique. Pourtant, si la solution m’apparaît mauvaise, le constat de départ est vrai : comment faire pour que la société ne s’effondre pas ? Les producteurs (qu’ils soient travailleurs ou capitalistes) peuvent-ils s’organiser eux-mêmes efficacement ? Est-il donc possible d’intégrer la crise dans la vie économique courante, sans en passer par la redistribution ?
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Schumpeter dans Capitalisme, socialisme et démocratie (1942) prophétise la mort du capitalisme par ses vertus, et non par ses défauts comme le prétendaient Marx et Engels. Tout d’abord, qu’est-ce que le capitalisme ? Il est un système de production où les capitalistes, grossièrement, ceux qui ont l’argent, produisent avec les travailleurs, qui vendent leur force de travail, dans le but de faire du profit. Nous avons vu dans mon article précédent que le profit est le vecteur d’information le plus efficient pour mettre en relation les besoins des individus et les moyens de les combler. Le patron, qui est celui qui crée au moins un emploi, est au début du capitalisme et encore parfois aujourd’hui l’entrepreneur. Il est un idéal Prométhéen dans la théorie, celui qui produit, celui qui innove. En vertu de ses idées, des risques qu’il prend, il espère être récompensé par la fortune. Le patron peut également arriver après l’innovation, ayant simplement la vertu de produire des biens et services en assez grand nombre pour la population, le tout en créant des emplois dans son entreprise et en faisant travailler ses sous-traitants. Le travailleur, lui, est un individu avec un savoir-faire, ou une capacité d’apprentissage, mais qui ne possède pas les outils de production. Le marxiste dira qu’il doit vendre sa force de travail au capitaliste, et que ce capitaliste va lui voler une grande partie de la plus-value qu’il va produire. Pour ma part, je considère que le travailleur loue le capital du patron (capital social (le réseau, les contrats, la stratégie de com), intellectuel (savoir-faire de l’entreprise, formation, culture d’entreprise) et surtout économique (locaux, machine, investissement)) afin de pouvoir exercer son savoir-faire, récupérant sa plus-value retranchée de cette location (le salaire).
Le capitalisme a évolué, le capitaliste est de plus en plus devenu la caricature que les marxistes en faisaient : patron et détenteur de capitaux se sont dissociés. Le patron n’est plus que le gestionnaire de l’entreprise tandis que les détenteurs de capitaux sont les actionnaires qui ne cherchent plus que du rendement sans apporter de plus-value au travailleur en termes de leadership ou d’innovation. D’énormes entreprises se sont constituées, quasi-indifférente à la concurrence, ou des grands groupes (comme dans la téléphonie) ont verrouillé le marché. Le chômage de masse a détruit la capacité de négociation du travailleur dans beaucoup de domaines, et la division du travail s’est accrue au point que « l’occupation de la très majeure partie de ceux qui vivaient de travail, c’est-à-dire de la masse du peuple, se borne à un très petit nombre d’opérations simples, très souvent une ou deux. Or l’intelligence de la plupart des hommes se forme nécessairement par leurs occupations ordinaires. Un homme qui passe toute sa vie à remplir un petit nombre d’opérations simples, dont les effets sont aussi peut-être toujours les mêmes, n’a pas lieu de développer son intelligence, ni d’exercer son imagination à chercher des expédients pour écarte des difficultés qui ne se rencontrent jamais ; il perd donc naturellement l’habitude de déployer ou d’exercer ses facultés et devient en général aussi stupide et aussi ignorant qu’il soit possible. » (Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Adam Smith) L’État est devenu comme on l’a vu un gestionnaire de misère, qui « redistribue » des classes productives vers les improductives, ce qui dans les faits se traduit par le fait d’être l’otage des privilégiés, la ponction des classes moyennes et la subvention au besoin des plus précarisés. Il devient le bouclier des premiers, le bourreau des seconds et le tuteur des derniers.
Il devient alors quasi-impossible pour les classes moyennes, seules qui pourraient y prétendre, d’évoluer grâce à leur travail. Les effets de seuil du système fiscal sont trop importants, les droits de succession trop élevés pour eux qui n’ont pas accès à des fiscalistes et ne connaissent pas toujours des notaires. Les démarches pour créer une société sont lourdes, les impôts de production aussi, et les revenus sont très taxés. La figure de l’entrepreneur, même s’il reste des « Elon Musk », est écornée. Le riche est un héritier. Les réglementations sont faites par un État consanguin avec les grandes entreprises. Bref, la récompense n’est plus à la mesure de l’effort, et la concurrence internationale est par-dessus le marché trop forte. Lors des crises, on sauve les banques et les grandes entreprises « too big to fail », mais pas les petites entreprises. Ni les grandes qui n’ont pas leurs entrées dans l’appareil étatique (Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde — documentaire sur Arte, montre bien comment cette banque s’est servie de la crise pour détruire ses principaux concurrents en se faisant sauver par le gouvernement américain, donc le contribuable). C’est la socialisation des pertes dont nous parlions. À la rigueur, la documentation sur ce point est foisonnante, mais l’originalité de Schumpeter (je trouve) tient au second facteur de la mort du capitalisme : ayant instauré une société prospère, il favorise l’émergence d’une classe de sous-intellectuels (trivialement, l’étudiant en sociologie). Il y avait en effet 517 490 étudiants en « Lettres et Sciences humaines », donc plus qu’en sciences (360 055), le double qu’en économie et administration économique et sociale (238 789) et qu’en Droit et sciences politiques (209 327). On constate bien à la lecture de ces chiffres que la France n’aura pas besoin de tant « d’intellectuels », à comprendre se destinant au travail de l’esprit. Ces Bac+8 en genre ou en psycho, voire même en géographie, qui au sortir de leurs études ne trouveront aucun débouchés (sauf pour les plus brillants) et qui accuseront le système de ne pas les accueillir à leur « juste valeur ». Ces éternels adolescents dont l’égo culmine avec la demande d’un revenu étudiant ne peuvent appréhender le fait que c’est leur choix qui les a conduits à leur situation, en faisant égoïstement le choix de tenter de vivre de leur passion, quand bien même elle ne serait utile à personne. Nos sociétés capitalistes, en outre, permettent la critique de leur système, qui devient alors le gagne-pain de cette classe désœuvrée, qui trouvera ses alliés dans les masses inadaptées au marché du travail (nous en reparlerons plus tard).
Il faut donc remettre en cause l’idée selon laquelle empêcher la crise sauve le capitalisme. Au contraire cela le tue. L’essence même du capitalisme, le compromis qu’il instaure, est que vous soyez rétribué pour vos efforts, mais également sanctionné pour vos manquements, vos erreurs. C’est une compétition, c’est une course perpétuelle. En instaurant le « too big to fail », la social-démocratie laisse pourrir la jambe pour ne pas couper l’orteil. Nous avons ici une véritable socialisation des pertes et privatisations des profits. C’est un pire remède qu’une nationalisation temporaire. La chute d’une banque veut dire qu’elle a trop prêté à des gens trop peu solvables, ou qu’elle a fait des investissements hasardeux. Comment justifier qu’on la sauve ? D’abord, elle paie ses erreurs. Ensuite, la laisser mourir serait libérer des ménages de l’endettement excessif (la sauver n’a donc en réalité aucune dimension sociale). Il s’agit donc seulement de protéger les créanciers. Le reste du temps, la redistribution étatique est là pour acheter la paix sociale, en témoignent les conditions dans lesquelles cette redistribution a été mise en place : la pression des masses rouges après la seconde guerre mondiale. Elle permet de faire faire passer le fait que l’erreur ne soit plus sanctionnée pour les puissants par le fait que la réussite soit superflue pour les plus pauvres. Le tout se fait évidemment au détriment de la classe moyenne, et des individus demandant à vivre de leur travail à la mesure de leurs efforts.
Mais alors faut-il laisser la crise « tout détruire » ? Tout cramer pour repartir sur des bases saines régulièrement ? Ça n’est pas tenable, ni au niveau intérieur, ni vis-à-vis de la concurrence internationale. Il n’est nullement ici question de vanter un nihilisme apocalyptique. Je pense simplement que d’autres moyens de régulation de la crise, d’autres filets de sécurité sont possibles. Tout d’abord, il faut que la pression fiscale soit bien moins élevées, pour que les revenus servent à vivre et non à payer les taxes, impôts et cotisations. Ensuite, une solidarité « désÉtatisée » est possible. Comme à l’origine des caisses de chômages, retraites et santés. Que les créateurs de richesses (travailleurs comme capitalistes) mettent en commun volontairement leurs moyens pour préparer une éventuelle crise. Ils pourraient alors décider eux-mêmes des conditions d’acceptation dans ces caisses, ce qui éviterai de nourrir les ennemis de la France, soit dit en passant. De leur côté, personne ne soutiendra que les grands patrons du CAC40 ne sont pas capables d’épargner pour ne pas dépendre d’argent public. Les mécanismes actuels d’assurance chômage, santé et retraite seraient alors conservés (mais pas comme monopole), car il est évident que dans certaines situations (personnes isolées ou en grande difficulté) le mécanisme précédent est inopérant. Cette assistance serait financée par l’impôt le moins immoral selon moi, la TVA. Dans mon idée, il faudrait d’ailleurs l’instaurer comme impôt unique. Je me permets ici une digression ; La TVA est « le seul impôt moral » car il taxe les comportements de consommation : les comportements de cigales sont plus taxés que les comportements de fourmis. On arbitre soi-même sa consommation, tout en connaissant à l’avance parfaitement le montant d’impôt qu’on payera. On évite les effets de seuil et on favorise l’ascenseur social des épargnants. Les stratégies individuelles auraient alors un vrai impact sur la situation sociale.
Car l’impératif reste le même, la concession insoutenable est toujours là : il faut protéger les individus des forces collectives des « perdants ». Il y a ici les profiteurs, qu’ils soient d’en haut (patron pratiquant la connivence avec le pouvoir pour assurer leur position sans effort), ou d’en bas avec le cas de la racaille, qui ne vit que pour et par le pillage plus ou moins institutionnalisé (fraude aux allocations et aides diverses ou trafics et vols). Ceux-là doivent être durement réprimés par la force publique. Mais il y a aussi les inconscients, c’est-à-dire les personnes de bonne foi qui ne savent pas « se gérer » économiquement ou ne répondant pas aux besoins économiques de la société (les inadaptés dont nous parlions plus haut). On leur en donne par ailleurs plus ou moins les moyens (bas salaires, contrats courts, etc.). Pour ces personnes-là, comme pour les autres victimes de coup du sort, il faut maintenir une solidarité diffuse afin de conserver une paix sociale relative (ça a toujours été le but de l’État-providence) et surtout un environnement sain (au niveau tensions sociales, santé collective, etc.). Je raccrocherai ici avec le propos initial du succès du capitalisme qui induit sa fin. Friedrich Hayek disait dans une interview en 1985 :
« Vous seriez surpris si je vous disais qu’à priori je suis tout à fait d’accord avec Karl Marx lorsqu’il soutient que le prolétariat est une création du capitalisme. Le capitalisme a maintenu en vie le prolétariat : ainsi, cette population supplémentaire du monde qui n’aurait pas pu vivre sans capitalisme, c’est le capitalisme qui lui a permis de survivre. Karl Marx émet une absurdité lorsqu’il déclare que le capitalisme a été créé aux dépens du prolétariat. Au contraire, c’est le prolétariat qui est un produit du capitalisme car seul le capitalisme pouvait maintenir en vie cette population supplémentaire. Elle serait morte si le capitalisme n’avait pas permis l’accès à tant de nouvelles ressources. »
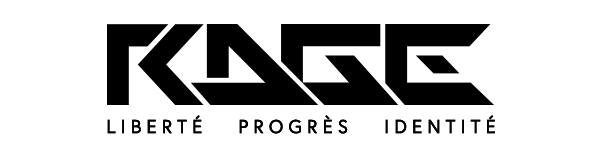







“J’aime les crises, voilà pourquoi vous devriez aussi”
C’est tellement fandar de se prendre une petite crise économique assortie d’une crise sanitaire, n’est-ce pas ? 😛
Alors, là, mec, provocation/20. J’avoue.