Henry Gee affirme que l’humanité, affaiblie par la domination totale, le déclin démographique et l’effondrement écologique, se dirige vers une disparition inéluctable. Il estime que notre unique chance de survie est de devenir une espèce interplanétaire avant qu’il ne soit trop tard.
L’empire humain déjà sur le déclin
L’être humain n’en a plus pour très longtemps.
Vous, moi, nos familles, nos lignées, partout sur terre : nous sommes peut-être déjà engagés sur la pente qui mène à notre disparition. Et il ne s’agirait pas d’une extinction dans quelques centaines de milliers d’années, quelque part au fond des temps géologiques, mais d’un processus qui aurait déjà commencé.
C’est, en tout cas, la thèse du dernier livre de Henry Gee, célèbre paléontologue et biologiste britannique, auteur de l’énorme succès Une très brève histoire de la vie sur Terre. Outre ses livres, il est l’un des rédacteurs de Nature, la revue scientifique de référence (très marquée à gauche politiquement, soit dit en passant, mais toujours stimulante).
Dans Grandeur et décadence de l’empire humain (publié en français chez Jean-Claude
Lattès), il se propose rien de moins que de raconter notre chute inéluctable – et, peut-être, le seul moyen d’y échapper.
La forme choisie m’a laissé sceptique : chaque chapitre commence par une citation tirée de l’ouvrage classique d’Edward Gibbon, Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain, et Gee essaie d’établir un parallèle entre la fin de Rome et le destin de « l’empire humain ».
À mes yeux, cela ne fonctionne pas vraiment. D’abord parce que l’idée centrale de Gibbon est profondément idéaliste : il explique la décadence de Rome par la perte du sens civique et par l’adoption du christianisme. Gee, lui, raisonne en termes de structures, de biologie, d’écologie, d’histoire matérielle : causes profondes, dynamiques évolutives, contraintes physiques. Autrement dit, l’exact contraire de l’idéalisme gibbonien.
Un empire, qu’il soit romain ou humain, ne s’effondre pas d’abord à cause d’idées politiques, morales ou religieuses. Les idées ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Ce qui coule le Titanic, ce ne sont pas les conversations des passagers sur le pont, mais la masse invisible de glace sous la surface. Nous en sommes là : un empire planétaire triomphant, déjà fissuré en profondeur, et encore occupé à manger du caviar sur fond de musique, sans remarquer que la coque prend l’eau.
La fin de l’orthogenèse… puis son retour
Pendant longtemps, on a cru que toutes les espèces étaient vouées à disparaître selon une sorte de destin écrit d’avance. C’est ce qu’on appelait l’orthogenèse : à l’image d’un individu, une espèce naîtrait, croîtrait, atteindrait son apogée, puis entrerait dans une phase de sénescence et finirait par s’éteindre. La mort serait inscrite dans l’essence même de l’espèce, comme elle l’est dans la nôtre, à l’échelle individuelle.
Au XIXᵉ siècle, on expliquait ainsi la disparition des dinosaures : après avoir dominé la Terre, ils auraient dû, par une sorte de vieillissement racial, laisser la place à d’autres. Un cycle presque mystique.
Au XXᵉ siècle, ce schéma s’est effondré. On a découvert qu’un astéroïde écrasé dans la péninsule du Yucatán, il y a 65 millions d’années, avait joué un rôle décisif dans l’extinction des dinosaures. Ce n’était donc pas une « fatalité intérieure », mais un accident extérieur. Les causes contingentes, les événements, les cataclysmes, semblaient comptaient bien davantage que toute direction préétablie de l’évolution.
En 2017 toutefois, un groupe de paléontologues réunis à Helsinki a proposé ce qu’on appelle aujourd’hui la « thèse d’Helsinki », qui remet au goût du jour, d’une certaine façon, cette idée d’une trajectoire presque écrite des espèces – mais sur des bases beaucoup plus solides.
Leur idée est la suivante : si les espèces apparaissent pour des raisons diverses, celles qui parviennent à un statut dominant le doivent d’abord à la concurrence avec d’autres espèces. Elles progressent parce qu’elles doivent constamment se battre entre-elles.
Mais une fois le sommet atteint, une fois la concurrence éliminée, ces espèces dominantes engagent un nouveau type de combat : non plus contre d’autres espèces, mais contre le milieu lui-même, contre la planète. Et ce combat-là est toujours perdu d’avance. Quand il ne reste plus que quelques survivants dispersés, il suffit ensuite d’un changement climatique, d’un cataclysme, d’un virus, pour balayer ce qui reste.
La domination totale ouvre ainsi une séquence de vulnérabilité totale.
La victoire fatale d’Homo sapiens
Appliquée à l’homme, la thèse d’Helsinki conduit à une conclusion vertigineuse : notre
disparition serait scellée à partir du moment où il n’est plus resté, sur Terre, qu’une seule espèce d’humain : Homo sapiens.
Il y a 50 000 ans, quand l’homme moderne a commencé à vraiment dominer le monde, la Terre ressemblait un peu à la Terre du Milieu de Tolkien. On y croisait des hominidés de toutes tailles : des grandes brutes façon trolls (les Denisoviens), des êtres beaucoup plus petits comme l’homme de Florès, qui ne dépassait pas le mètre. Et nous ne connaissons seulement qu’une partie de ce drôle de tableau anthropologique !
Aussi, on sait par la génétique que plusieurs populations humaines actuelles portent la trace d’espèces d’hominidés que nous n’avons même pas encore identifiées par des fossiles. La plupart des Africains subsahariens, par exemple, semblent avoir dans leur patrimoine génétique une (ou plusieurs) espèces d’hominidés qui vivaient encore en Afrique il y a seulement 35 000 ans, et dont nous ignorons tout.
Le monde humain était donc, il y a peu de temps à l’échelle de l’évolution, un monde
concurrentiel, peuplé de cousins plus ou moins proches.
Or, suivant la logique d’Helsinki, cette concurrence est vitale : c’est elle qui pousse une
espèce à s’adapter, à se renforcer, à se diversifier. Une fois la concurrence éliminée, le
mouvement s’inverse : la progression cesse, la décadence commence, la vulnérabilité
augmente.
Il y a environ 30 000 ans, Homo sapiens est devenu la seule espèce d’hominidé sur Terre. Puis il s’est répandu sur toute la planète, éliminant voire anéantissant la plupart des grands animaux et soumettant les autres.
Aujourd’hui, l’homme et ses animaux domestiques représentent environ 96 % de la biomasse des mammifères terrestres. Les animaux sauvages ne sont plus qu’une mince fraction résiduelle. Et seules 5 % des terres émergées (hors Antarctique) n’ont encore aucune trace de notre activité.
Autrement dit, nous avons gagné. À plate couture. Mais, dans la logique de Gee, cette victoire globale nous a en même temps condamnés.
Une humanité standardisée et fragile
Notre problème ne vient pas seulement de notre domination, mais de la manière dont nous l’avons organisée : en réduisant partout la diversité.
Nous avons uniformisé notre propre patrimoine génétique (au regard de l’histoire des
hominidés, l’humanité actuelle est peu variée), et surtout, nous avons uniformisé ce dont nous dépendons : nos cultures, nos animaux, nos sols.
Un exemple simple : la banane. Celle que nous consommons presque partout dans le monde est une seule et même variété, la Cavendish, domestiquée en Asie du Sud-Est il y a plusieurs millénaires. Longtemps, il a existé une multitude de variétés de bananes ; nous en avons gardé une poignée, et concentré la production sur une seule. Il ne faudrait qu’un parasite ciblant spécifiquement cette variété pour qu’il n’y ait, du jour au lendemain, plus de bananes du tout.
Nous avons fait la même chose avec notre alimentation de base : blé, riz, maïs, soja…
Quelques céréales et quelques plantes supportent l’essentiel de la charge. Nous avons
abandonné des centaines d’espèces ou de variétés locales qui, pourtant, constituaient une assurance contre les catastrophes.
C’est exactement ce qui est arrivé aux Irlandais au XIXᵉ siècle. Ils avaient réduit leur
alimentation presque exclusivement à la pomme de terre, elle-même appauvrie
génétiquement. Un simple champignon a suffi à détruire les récoltes, provoquant une famine qui a fait plus d’un million de morts.
Selon Henry Gee, nous préparons les conditions d’un désastre du même type à l’échelle planétaire.
À cela s’ajoutent l’épuisement des ressources, la destruction progressive des écosystèmes, la pollution, le réchauffement climatique. Gee reprend notamment une idée développée dans Nature dans les années 1990 : la « dette d’extinction ».
Si vous réduisez l’habitat d’une espèce, même modestement, vous enclenchez un processus qui, à terme, mène à son extinction, parce que les parties de l’écosystème que vous n’utilisez pas directement sont aussi vitales que celles que vous exploitez. Coupez 10 % d’une forêt, et vous condamnez déjà, à long terme, les oiseaux qui nichent dans sa canopée.
L’humanité, nous dit Gee, a déjà commencé à payer sa dette.
L’hiver démographique mondial
Cela est notamment vérifiable, dit-il, par la chute démographique de l’humanité déjà en cours.
Les projections indiquent que la population mondiale devrait continuer à croître jusqu’aux environs de 2075, quasiment uniquement grâce à l’Afrique. Partout ailleurs, le déclin est commencé : Europe, Chine, Amériques, monde arabe, Inde désormais. Les grandes nations humaines entrent les unes après les autres dans un hiver démographique dont on voit mal comment elles sortiront.
L’Afrique elle-même, d’après les études, n’a plus qu’un demi-siècle de croissance positive devant elle avant de rejoindre le reste du monde sur la pente descendante. Si l’on prolonge les courbes, on arrive à quelque chose comme un milliard d’êtres humains en 2300, soit l’humanité du temps de Napoléon.
On pourrait se dire : après tout, c’est peut-être une bonne chose. Nous sommes trop nombreux ; une division par deux, trois ou dix de la population soulagerait la planète, donc, indirectement, l’homme lui-même.
Gee répond que ce n’est, hélas, pas si simple. Car l’effondrement démographique entraîne un effondrement systématique de l’innovation. Pour qu’émerge un Einstein, il ne suffit pas d’un village, il faut des millions d’individus éduqués. Une humanité réduite, vieillissante, dispersée, aura de moins en moins les moyens intellectuels et techniques de faire face à des risques de plus en plus graves, dans un monde abîmé, instable, aux ressources entamées.
Et surtout, ce déclin n’est pas seulement culturel ou économique : il est biologique.
L’infertilité comme destin
On le sait mais on n’en parle presque pas : l’infertilité explose partout.
Entre 1940 et 1990, le nombre moyen de spermatozoïdes par millilitre de sperme a été divisé par deux. Depuis, la chute continue. Les problèmes de fertilité se multiplient, y compris chez des couples jeunes. Et il ne s’agit pas d’un phénomène « occidental » : des études récentes montrent qu’en l’espace de cinquante ans, la concentration spermatique des hommes au Nigeria, par exemple, a baissé de plus de 70 %. Le problème est global.
On soupçonne des causes multiples : perturbateurs endocriniens issus du plastique et de la pétrochimie, pollution, alimentation industrielle, excès de sucres, exposition à certaines substances, dérèglements hormonaux… Gee ajoute un facteur souvent négligé : le stress chronique lié à la vie urbaine de masse.
L’homme, on le sait (ou pas), n’est pas fait pour vivre serré avec des millions d’inconnus, bombardé en permanence de stimuli, enfermés dans du béton. Il est fait pour l’espace, le plein air, des visages familiers, des groupes restreints. Le fait que plus de 55 % des humains vivent aujourd’hui en ville, et que ce chiffre atteindra vraisemblablement 70 % dans deux décennies, n’est peut-être pas sans rapport avec cette crise de la fertilité.
J’ai parlé ailleurs de l’expérience de Calhoun sur les rats en surnombre (Surhommes et Sous- hommes, pour ceux qui veulent creuser) : la ville produit, au sens strict, des pathologies biologiques. On pourrait même comprendre le wokisme à partir de là : une idéologie de cerveaux urbanisés en fin de course, empestés, profondément pollués…
Quoi qu’il en soit, le diagnostic de Gee est clair : si la population mondiale s’effondre, si
l’intelligence moyenne, la capacité d’innovation, l’énergie collective chutent avec elle, alors notre civilisation industrielle n’aura pas de « second départ ». Nous avons déjà brûlé les ressources faciles – le charbon, le pétrole – qui ont rendu possible l’essor de la modernité.
Comme le remarquait déjà Theodore Kaczynski, une humanité qui s’effondrerait demain ne pourrait plus redémarrer un cycle industriel complet : les gisements les plus accessibles sont déjà vides.
Pour Gee, la trajectoire est écrite : pénuries, éparpillement en petits groupes survivalistes, vulnérables aux pandémies, aux catastrophes naturelles, aux famines. Et disparition complète de l’espèce humaine dans environ 8 000 ans.
Vu comme ça, difficile de se motiver pour faire des enfants.
L’issue interplanétaire
Et pourtant, Gee ne se contente pas d’un catastrophisme résigné. Il voit une issue possible – une seule : faire de l’humanité une espèce interplanétaire. C’est aussi l’obsession d’Elon Musk : étendre notre écosystème à d’autres mondes.
Pourquoi ? Parce que seule l’extension spatiale pourrait compenser notre vulnérabilité
terrestre, nous offrir de nouveaux environnements, voire de nouveaux rivaux – condition, on l’a vu, du progrès évolutif.
Au passage, cela permet d’adresser un petit mot aux gauchistes, communistes et autres apôtres du mondialisme et internationalisme. Si la concurrence est un facteur décisif de progression, alors le fait que l’humanité se soit subdivisée en races, nations, cultures et États a été une bénédiction évolutive. C’est dans la rivalité de ces unités ethno-politiques que nous avons avancé. Le grand projet d’un métissage universel, d’un État mondial, d’une humanité homogène serait, d’un point de vue biologique, l’une des pires choses qui pourrait nous arriver. L’internationalisme intégral n’est pas seulement naïf politiquement : il est, scientifiquement, suicidaire.
Revenons à l’espace. Pour Gee, nous avons à peu près deux siècles pour réussir ce saut. Au- delà, il n’y aura plus assez d’hommes, plus assez de ressources, plus assez d’intelligence collective pour franchir le pas.
Cela ne signifierait pourtant pas qu’il faudrait abandonner l’écologie au profit d’un fantasme spatial. Au contraire : prendre soin de la Terre nous ferait gagner un temps précieux avant la fermeture de la « fenêtre interplanétaire ». On ne colonisera pas les étoiles en ruinant d’abord le seul monde qui nous permet de construire des fusées.
Les défis sont immenses : miner les astéroïdes riches en minerais, produire de l’eau et du carburant dans l’espace, établir une véritable industrie orbitale, autonome, capable de fonctionner sans soutien permanent de la Terre. Tout cela est potentiellement réalisable en un siècle ou deux.
Le plus difficile sera autre chose : adapter l’homme lui-même.
Nos corps ne sont pas faits pour l’espace, on le devine. Les radiations solaires et cosmiques, l’absence de gravité, les contraintes physiologiques détruisent lentement l’organisme. Si nous voulons vivre et nous reproduire au-delà de la Terre, il faudra donc modifier notre biologie.
Gee évoque par exemple la possibilité d’introduire dans nos cellules certaines protéines présentes chez des organismes extrêmement résistants, comme les tardigrades, afin de limiter les dégâts des radiations.
Cela implique une reproduction de plus en plus artificielle, des manipulations génétiques assumées – bref, une humanité qui se refaçonne pour survivre ailleurs que sur sa planète d’origine.
Pourquoi continuer à faire des enfants ?
Face à ce tableau, la tentation du nihilisme est forte. À quoi bon se battre politiquement si tout doit finir en poussière ? À quoi bon faire des enfants si l’espèce est condamnée à disparaître, tôt ou tard ?
Curieusement, la lecture de Gee produit chez moi l’effet inverse.
Puisqu’il nous reste peu de temps, nous n’avons pas le droit de l’utiliser à nous abrutir. Nous devons tout faire pour conserver des sociétés intelligentes, structurées, stables, capables d’innovation, et non pas des foules dissoutes dans les comportements de QI négatif que l’on voit aujourd’hui prospérer.
Je veux me battre pour cela tant que je vivrai.
Et pour ce qui est des enfants, je me surprends à y voir une forme de privilège. Peut-être sommes-nous la dernière génération à concevoir encore des enfants « naturellement », à l’ancienne, sans protocole en laboratoire, sans ingénierie génétique massive.
Peut-être élevons-nous les derniers hommes au sens le plus simple, le plus naturel du terme.
Loin de m’abattre, cette idée m’émeut. Elle donne un sens encore plus fort à la paternité. En élevant mon fils, je me dis que je peux essayer de faire honneur à une très vieille espèce, à une longue chaîne de vainqueurs et de naufragés, d’hommes qui, avant nous, ont traversé des extinctions, des glaciations, des guerres et des famines.
Faisons donc encore des hommes, de vrais hommes, fussent-ils les derniers. Surtout, j’ai envie de dire, s’ils doivent être les derniers.
Quoi qu’il arrive, aidés de Dieu, de la nature, de la science, et j’espère des trois à la fois, ces enfants trouveront leur chemin. Ici-bas, et, qui sait, là-haut.
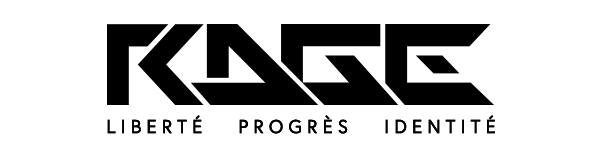







Semblaient compter : on oublie trop la decadence grammaticale