Le texte suivant est une critique du livre de NIMH, Traité Néo-Réactionnaire de la part d’un lecteur qui a compris et pris sa proposition au sérieux. Tout critique soit-il, le propos est argumenté, respecteux et brillamment mené. C’est un article long et exigent qui mérite d’être lu et devrait donner lieu à une discussion entre les auteurs.
Suite à nos nombreux échanges, toujours trop brefs, parfois houleux mais le plus souvent cordiaux, NIMH a tenu à m’offrir son ouvrage intitulé Traité Néo-Réactionnaire. Afin que j’aiguise ma critique et que nous puissions porter notre controverse à un degré plus mûr que les passes de commentaires interposés sur X, celui-ci m’a également offert une tribune pour que j’y tiennes, publiquement et d’un seul trait, l’ensemble des griefs que j’émets à l’endroit de sa doctrine. Je l’en remercie, et tenterai de ne pas le décevoir avec ce billet. Il est en droit d’attendre de moi une réponse corrosive, mais j’ai avant tout souhaité m’exprimer ici dans un vocabulaire et par un ton qui, je l’espère, traduiront bien toute l’amitié que je lui porte.
Si je ne doute pas qu’il ait une connaissance précise de la pensée de NIMH, il est tout à fait probable que le lecteur de ce papier ne connaisse rien en revanche de mes opinions ni de ma formation intellectuelle. Dans le cadre d’un débat d’idées, il est pourtant nécessaire de parvenir à identifier le camp auxquels chacun des contradicteurs appartient. Situer le sujet qui défend son point de vue est toujours nécessaire pour le comprendre. En effet, aucune idée ne peut avoir de sens en dehors du sujet qui la porte.
En préambule de cette réponse, et avant d’ouvrir franchement les hostilités, je prendrai donc le temps de me présenter. Je suis un jeune homme européen occidental. Cette précision n’a rien d’innocente ni d’inutile. Elle n’a rien non plus de fortuite ; en réalité, la plupart des questions que la lecture de l’ouvrage de NIMH a suscité chez moi entrent en relation directe avec cette identité qui est la mienne. Si d’ailleurs je tiens autant à préciser comment je suis, c’est parce que j’adhère avec conviction à ce que l’on pourrait appeler l’identitarisme.
Je suis un jeune homme européen occidental et un identitaire. Ma critique ne partira donc pas d’une neutralité axiomatique, mais de ces spécificités qui me déterminent comme sujet. Je ne crois pas en effet qu’une telle neutralité puisse avoir quelque sorte de sens. Tout sujet est un sujet identisé1, c’est-à-dire un sujet dont les catégories propres le déterminent dans un certain type de rapport au monde. L’identité du sujet est la somme des déterminants2 qui le spécifient et donc le définissent en tant que sujet dans son rapport au monde.
Il est nécessaire d’établir ici ces quelques précisions sur lesquelles d’ailleurs se bâtiront l’ensemble des vues qui viendront en suite. Dans la doctrine identitaire, un sujet est un mode de représentation. C’est une conscience dont les modalités catégorielles ajustent et définissent la façon à travers laquelle il va produire un monde qui lui est propre. Chacun des éléments de sa représentation du monde, chacun des signifiants qu’il manipule, chacun des items qu’il interprète comme constitutifs du monde, dépendent de son identité. C’est elle qui les produit, c’est d’elle qu’ils découlent. La première notion contre laquelle s’insurge ainsi l’identitaire est celle de « réalité objective » : la réalité doit toujours se penser comme une réalité vécue, et vécue par un sujet identisé. Il n’existe pas de réalité objective en soi. Toute réalité est une production du sujet identisé, au fondement de laquelle se trouvent les catégories de l’identité qui permettent de la dessiner et de lui donner forme. Ainsi la réalité d’un jeune homme européen occidental n’est pas la même que la réalité d’un boomer européen, ni la même que la réalité d’une femme musulmane afghane, etc.
Le fait même de se livrer présentement à cet exercice de commentaire d’ouvrage, le fait de se plier à ce type de jeu, et de reconduire ce type d’échanges et d’interactions sociales, dépend évidemment de mon identité de jeune homme européen occidental. Si j’étais d’une autre culture, d’une autre ethnie, d’un autre continent ou d’un autre milieu anthropologique et social, il est certain que je n’aurais pas eu un jour, entre mes mains, l’ouvrage de NIMH, et que je n’en n’aurais donc jamais produit quelque critique. L’intérêt que je porte aux questions politiques, à l’actualité, la façon dont je m’exprime et dont je fait usage des signifiants avec lesquels je construit mes modes de communications ne sont pas indifférents à cette identité qui est la mienne. Ce qui constitue donc ma réalité présente n’a rien d’universelle. Les activités que je mène comme activités sociales, comme ensembles d’interactions, la façon dont je constitue un produit social spécifique sont autant de conséquence de mon identité, c’est-à-dire des déterminants qui me définissent comme sujet politique.
L’identitarisme propose ainsi de concevoir et d’interpréter les phénomènes sociaux à l’aune des jeux d’identités qui caractérisent les acteurs de ces phénomènes. Pour un identitaire, l’universalisme, la Vérité universelle, révélée, valable pour tout sujet en tout temps et en tous lieux n’existe pas. Toute « vérité » dépend, selon lui, du sujet qui se la représente. Chaque sujet a un point de vue différent sur le monde, ou, pour être plus rigoureux, chaque sujet est un point de vue spécifique. Ce qui est vrai pour un sujet ayant telle identité ne sera pas vrai pour un autre sujet ayant telle autre identité. Cela se mesure particulièrement dans le cadre de l’étude des phénomènes sociaux. Prenons par exemple le cas de la baisse de la natalité : un observateur prétendument neutre pourrait considérer que la natalité semble baisser en France au XXIe siècle. Mais cette observation n’a pas de sens en dehors du sujet qui la produit. Les femmes issues de l’immigration ont, en
France, une natalité en hausse. Les femmes autochtones ont une natalité en baisse. Lorsque l’observateur prétendument neutre déploie sa vérité qu’il prétend universelle, il affirme une chose qui se rend fausse dans la réalité de certains types de sujets. Si cet observateur révèle son identité, s’il révèle qu’il est un européen occidental, qu’il a en ce sens intériorisé certains types de représentation du monde, et qu’il tient pour universel les catégories qui lui sont en faite propres et restreintes, alors on comprend que son observation n’était pas bonne : ce n’est pas la natalité qui baisse, mais sa natalité, celle qui fait écho à ses catégories. Un autre type d’observateur, par exemple se définissant comme musulman, en France, en 2025, pourrait tout à fait dire : notre natalité est en hausse. Les deux auraient en même temps raisons, parce qu’ils parlent de deux réalités différentes.
Dans le cadre de la description des phénomènes sociaux, la prise en compte de l’identité est absolument nécessaire. En revanche, celle-ci s’atténue dans le cadre de la description d’autres types de phénomènes, comme les phénomènes physiques. L’étude scientifique de la nature peut produire des propositions d’apparence3 plus universelle. Ainsi les phénomènes physiques s’appliquent indifféremment à n’importe quel sujet : la force de gravité est la même sur Terre pour n’importe quel sujet quelle que soit son identité. En physique on peut volontiers se passer de la prise en compte de l’identité. On n’a pas besoin de connaître, par exemple, l’identité ethnique ou religieuse d’un individu pour savoir qu’il est soumis à la loi de l’attraction gravitationnelle. On peut en revanche requérir des informations sur le sujet pour le traiter en chimie ou en biologie : la posologie d’un médicament ne sera pas la même selon le sexe, l’âge, la taille de l’individu. Mais là encore, la nature même des phénomènes biologiques ou chimiques, comme les physiques, fait que ce sont les mêmes lois et les mêmes principes qui s’appliquent universellement : on peut avoir besoin des informations qui spécifient le sujet pour lui attribuer la bonne posologie, mais les principes chimiques qui président à l’élaboration du médicament sont bien universels.
Dans le cadre des phénomènes sociaux en revanche, cette universalité vient s’abolir complètement. La raison en est simple : la société est bien le lieu dans lequel l’individu vient déployer les spécificités catégorielles qui l’arrachent à l’universel indifférencié de la nature. C’est donc à l’intérieur des rapports sociaux, et non pas à l’intérieur de la physique ou de la thermodynamique, que l’individu va pouvoir faire l’expérience de sa si vivre comme spécificités.
Lorsqu’on parle donc d’identité, on parle nécessairement d’un individu pris à l’intérieur des rapports sociaux. Lorsqu’on dit que le sujet se représente un monde particulier selon son identité, on parle toujours d’un sujet intégrer aux réseaux d’échanges et d’interactions que propose la société humaine. La société est donc le cadre que déploie le sujet pour se vivre comme sujet identisé. Ce qui intéresse donc nécessairement l’identitaire, c’est bien la compréhension des phénomènes sociaux, culturels, anthropologiques, historiques, bref, la politique.
La politique est ce lieu où l’homme se réalise. « Se réaliser » signifie ici, pour un identitaire, faire advenir une réalité impliquée par son activité de sujet identisé. La politique est cet espace où l’homme fait surgir un monde. Or, ce monde, il le fait toujours surgir à partir de ses catégories propres, les catégories de son identité, de sorte qu’il soit toujours son monde, et non pas un monde universel. En conséquence, lorsqu’une société change d’identité, parce que les membres qui la composent changent eux-mêmes, cette société change avec eux : ses normes comportementales et morales, ses lois, ses institutions changeront également.
L’identitarisme, parce qu’il pense la réalité sociale comme étant toujours le produit d’un sujet identisé, s’oppose donc à toute forme d’universalisme. Mais ses implications philosophiques sont encore plus profondes. C’est au niveau de la description de la relation entre le sujet et le monde qu’il s’oppose à l’approche universaliste. L’identitarisme propose une nouvelle description de la relation sujet-monde, où le monde n’est plus un donné objectal externe et indépendant du sujet, mais le produit du sujet lui-même qui le fait surgir à partir des catégories de sa subjectivation, son identité. Cette doctrine requiert donc un certain dispositif conceptuel pour devenir une doctrine valide sur le plan théorique comme pratique : elle nie l’universalité et l’objectivité du monde, préférant s’intéresser à la façon dont chaque sujet fait surgir un monde qui lui est propre, autant matériellement que mentalement, à partir des catégories qui le structurent comme sujet identisé.
La métaphysique contre l’identité
Au fondement théorique de la doctrine identitaire se trouve donc le rejet de la conception du monde comme monde objectif. L’objectivité du monde peut pourtant sembler naturelle, évidente. C’est peut-être la façon de concevoir la réalité qui apparaît la plus démontrable et la plus rationnelle : le monde serait posé-là, devant nous, et l’homme l’arpenterait pour en faire l’expérience. Néanmoins, cette approche n’est pas une évidence par soi, et a dû s’affirmer au cours du temps à travers un long travail de prosélytisme intellectuel et moral. Elle est elle-même un produit de l’histoire, l’aboutissement d’un processus qu’on appelle depuis Heidegger la métaphysique occidentale.
Celui qui connaît l’histoire de la philosophie européenne saura reconnaître que la compréhension du sujet comme sujet identisé, c’est-à-dire comme sujet dont les catégories utiles ne sont jamais des catégories universelles, est une compréhension récente, tardive. Durant le gros de l’histoire occidentale, en philosophie, on a cherché à décrire l’universel abstrait plutôt que le différencié concret. La raison de cette absence d’appréhension du sujet comme sujet d’une ouverture spécifique vers un monde singulier vient précisément de la façon dont la métaphysique occidentale a construit le monde comme un monde objectif.
Depuis Platon, et cette tendance s’est accélérée brutalement avec l’élaboration de la métaphysique chrétienne qui lui emboîte le pas, la philosophie occidentale a développé un Gestell, un dispositif précis de catégories conceptuelles et de notions pour penser l’Homme et son rapport au monde. Ce dispositif est celui de la métaphysique : posant le monde comme monde objectif indépendant du sujet, elle défini ce sujet-séparé-du-monde comme un être contemplatif qui vise à connaître et interpréter cette réalité objective qui lui est externe en l’observant, l’étudiant, la contemplant dans le but d’en comprendre l’essence.
« En effet, ce qui est capable de recevoir l’intelligible, c’est-à-dire la substance, c’est l’intellect, et il est en acte quand il le possède, de sorte que l’intelligible, plus que l’intellect, est ce que l’intellect semble avoir de divin, et que l’étude est le plus grand plaisir et le plus grand bien. »
Aristote, Métaphysique, Lambda (1072b), Flammarion, Paris, 2008.
Le monde décrit par la métaphysique est un monde dans lequel le sujet rencontre des objets. Un objet est un « posé-là » : le préfixe latin ob signifie « en face de ». Le terme d’ob-jet désigne ce qui est jeté, ce qui est posé en face du sujet. L’objectivation du monde que produit la métaphysique tient donc à la réduction des phénomènes mondains à une somme d’éléments posés-là, en face de nous, et nous reviendrait la tâche de les interpréter et de les comprendre par l’étude et la contemplation.
Reste à savoir comment le sujet métaphysique, ce sujet passif contemplant et interprétant le monde objectivé, peut atteindre une connaissance, c’est-à-dire une concordance entre le monde subjectif qu’il se représente et le monde objectif. Tel est le but de la métaphysique : penser les conditions au sein desquelles une connaissance du monde objectif devient possible. La méthodologie qu’elle va alors proposer pourrait s’interpréter comme une méthodologie de la définition : parvenir à produire une définition du posé-là c’est réussir à le saisir de façon conforme à sa réalité. Le sujet doit donc redoubler d’effort pour essayer de définir l’objet de façon conforme à son « être »4 objectif.
Dans le cadre épistémologique défini par la métaphysique, un premier problème vient heurter le sujet dans son activité de définition objective du monde : lorsqu’on l’observe avec nos sens, le monde objectif semble soumis à des tendances qui produisent en son sein des variations innombrables, si bien qu’une définition objective de l’ob-jet semble toujours se dérober à mesure qu’on la cherche. Comment définir objectivement la notion Arbre si chaque arbre que le sujet observe est singulier et différent de tous les autres ? On ne peut pas en effet dire que l’arbre en général fait telle taille, a telle masse, comprend tel nombre de branches, etc., de sorte que ces valeurs soient identiques pour tous les arbres et permettent ainsi de les définir. Chaque arbre qui compose le monde objectif qu’a posé la métaphysique a pour toutes ces entrées des valeurs qui lui sont propres et qui le différencient des autres arbres. On ne trouvera pas, dans la nature, deux arbres identiques. L’identité qui autoriserait en ce sens la définition objective n’existe jamais dans cette réalité que propose la métaphysique.
Placé dans le Gestell de la métaphysique, le sujet fait l’expérience d’un monde sensible qui lui est indépendant. Les éléments qu’il rencontre dans ce monde sensible, les objets qui sont posés là face à lui, sont tous différents. Alors qu’il doit en produire une définition objective, car la connaissance a été réduite à l’intellection des objets tels qu’ils seraient objectivement, il ne parvient pas à dégager les critères qui autorisent cette définition. L’identité manquant toujours, on n’atteint jamais cette définition objective de l’ob-jet. La métaphysique semble alors prise de court : elle s’est elle-même enfermée dans un cadre épistémologique douteux, et n’arrive pas à diagnostiquer ce qui, dans ses axiomes, engage le sujet dans cette spirale de l’oublie de « l’être », où la chose lui échappe systématiquement chaque fois qu’il tente de s’en approcher : « je défini l’Arbre comme un végétal ayant des feuilles au bout de ses branches », mais n’avons-nous jamais vu un arbre sans feuillage en hiver ? « je défini l’Arbre comme un végétal ayant des feuilles au bout de ses branches et qui les perd en hiver », mais n’avons-nous jamais vu un arbre qui ne perd pas son feuillage et le conserve toute l’année ? On pourrait continuer ce jeu longtemps, et montrer que l’arbre, à partir de la seule expérience sensible qu’en fait le sujet, ne peut jamais avoir de « définition » comme la métaphysique l’entend. La définition s’éloigne toujours, si bien que le métaphysicien arrive presque au bout d’une impasse : l’arbre n’existe pas, le monde n’existe pas, car je ne parviens pas à les définir.
Nous disons que le métaphysicien arrive « presque » au bout d’une impasse, car il va sortir sa dernière carte. Ignorant que persevare diabolicum, il va assumer ses prémisses jusqu’au bout, et admettre la conséquence la plus violente de son système : l’être de la chose n’est pas à chercher dans le monde sensible. L’Arbre existe bien, mais il n’est aucun des arbres spécifiques que le sujet observe. Il est un εἶδος, une idée pure abstraite, que les arbres particuliers qu’on observe ne font que phénoménaliser. Le monde métaphysique va entrer dans une inversion radicale, où l’Être, le vrai appartiennent à l’idée pure, et les choses particulières n’en sont que des reflets appauvris, raison pour laquelle ils connaissent quelques variations. Là seulement le Gestell métaphysique devient complet : à la suite de l’affirmation du monde comme monde objectif, il faut toujours distinguer un monde des Idées et un monde sensible. Le monde objectif – et c’est là le plus important à retenir pour ce qui suivra – n’est jamais le monde sensible. Il est le monde des Idées, car c’est au seul niveau de l’abstraction idéelle pure que la définition objective de l’objet peut être produite. Chaque chose a donc un « être », mais celui-ci échappe à la relation sensible sujet-monde, car le sujet n’est pas doué des facultés nécessaires pour connaître l’être à partir de ses sens. S’il veut atteindre la connaissance de l’« être » tel que l’entend la métaphysique, il doit abandonner ses facultés sensibles pour se concentrer sur des facultés ayant une capacité d’abstraction supérieure : l’intellect, la Raison5.
« Donc les choses qui sont toujours mêmes qu’elles-mêmes et semblables à elles mêmes, il est plus probable que ce sont les choses non-composées ? Alors que celles qui sont tantôt d’une façon et tantôt d’une autre, et qui jamais ne sont mêmes qu’elles-mêmes, celles là sont composées ? […] Or les unes, tu peux les percevoir à la fois par le toucher, la vue, et tous les autres sens ; mais les autres, celles qui restent mêmes qu’elles-mêmes, absolument impossible de les saisir autrement que par l’acte de raisonnement propre à la réflexion ; car elles sont invisibles, les réalités de ce genre, elles ne se donnent pas à voir. »
Platon, Phédon, 78c-79a, Flammarion, Paris, 1991.
Le sujet métaphysique va donc se définir par des catégories universelles : il est un sujet de l’intellection, qui cherche à abolir ses spécificités accidentelles (son identité, son temps et son lieu, et tous les éléments qui produisent sa singularité) afin d’atteindre l’universel eidétique. Pour s’échapper de la subjectivité du monde sensible qui ne connaît pas l’Être métaphysique, le sujet doit en effet sortir des catégories qui rendent son point de vue sur le monde non-universel. Les catégories qui rendraient son étude du monde subjective, non-universelle, deviennent des catégories contre lesquelles il faut lutter. L’exercice de la connaissance passe alors par le péristyle d’une négation de ses singularités personnelles – et son identité en fait bien sûr partie.
Le sujet que produit la métaphysique est donc un sujet qui doit travailler sur ses singularités pour s’efforcer de les nier. Le métaphysicien idéal serait ainsi un homme sans corps, sans histoire, sans détermination, juste une âme contemplant les idées pures. Historiquement, ce sujet métaphysique s’incarne dans la figure du moine-copiste, cet être sans identité, sans pulsion, qui a refoulé toutes les déterminations qui le singularisent, jusqu’à uniformiser la longueur de la moindre mèche de ses cheveux, de sorte que son corps singulier et spécifié disparaisse et laisse son âme s’exprimer purement : il passera sa vie dans le monde des idées, à lire et à recopier, à étudier, abolissant tous ses plaisirs et ses désirs jusqu’à jamais se livrer ne serait-ce qu’à une innocente branlette. Son regard sur le monde ne serait soumis à aucune des fonctions de variation que pourrait causer sa subjectivité. Il atteindrait la vérité-objective, la vérité-vraie, en se transformant en être universel-abstrait. En effet, si le monde est objectif et universel, alors le sujet doit aussi se penser et se réaliser dans son universalité : détruire la subjectivité qui le singularise devient la tâche de l’Homme. Cette compréhension du sens de ce que doit être l’humain comme réalisation de l’universalité par l’abolition de la subjectivité est bien sûr le propre de la métaphysique, mais aussi la figure antithétique de l’identitarisme.
Le sujet universel abstrait que produit la métaphysique, et qu’elle a même produit réellement et matériellement au cours de l’histoire, est ce contre quoi s’insurge l’identitarisme. Notre doctrine insiste sur les spécificités qui induisent chez chaque sujet l’expérience d’un monde différent, impliquant que le sujet soit pensé à partir de son corps, de ses déterminations diverses, de ses réalités subjectivantes. Le sujet universel abstrait, celui de la métaphysique, du christianisme et du post-christianisme occidental, c’est ce sujet gauchiste, celui qui refuse d’admettre que son monde n’est pas un monde universel mais un monde qui lui est propre. Que ce monde ne peut être vécu et partagé universellement, car il est le produit d’une identité singulière.
La Modernité contre la métaphysique
Sur le plan philosophique, la bataille de l’identitaire est une bataille contre la métaphysique. Il s’inscrit ainsi dans le processus de rupture de la métaphysique qui s’est ouvert depuis au moins Guillaume d’Ockham, et qui s’est prolongé jusqu’à ce jour. Ce processus, l’histoire l’a nommé la Modernité.
La Modernité est, d’un point de vue sismique, la plus grande secousse qu’à connu le monde occidental depuis l’éclatement du christianisme. À ce titre, elle à la prétention de faire jeu égal avec cela-même qu’elle essaye de combattre : non pas le fait chrétien, qu’elle combat seulement de façon dérivée, mais bien plutôt la métaphysique qui a trouvé dans celui-ci sa caisse de résonance pour soumettre l’Europe.
La Modernité admet de nombreuses acceptions. En histoire, en philosophie, en art ou en architecture, on ne désigne jamais exactement la même période ni le même courant. Historiquement la Modernité s’achève, dit-on généralement, à la Révolution française, laquelle donne suite à la période contemporaine. La période Moderne ou les « Temps Modernes » courraient ainsi de 1492 – la découverte des Amériques qui termine le Moyen Âge – à 1792 – la proclamation de la première République. Elle durerait exactement trois siècle et nous en serions revenu depuis longtemps.
En philosophie évidemment, le terme renvoie à un autre système de jalonnement. Ses balises ne sont plus chronologiques, mais conceptuelles. La Modernité philosophique a été annoncée par une série de fracture à l’intérieur de la structure scolastique, qui s’est finalement effondrée sous le poids des contradictions de sa métaphysiques. Contraint par notre format, nous ne disposons pas de toute la latitude que nous souhaiterions avoir pour présenter au lecteur cette bataille entre Anciens et Modernes qui s’est joué à l’intérieur de la scolastique du Moyen Âge finissant.
Retenons toutefois qu’à l’époque médiévale, l’École, c’est-à-dire la philosophie universitaire, officielle, religieuse et dominante dans toute l’Europe Occidentale, était divisée en deux courants. Le premier, le courant le plus ancien, celui qui repris à son compte toutes les bévues de la métaphysique platono-aristotélicienne, et qui les étira sur presque mille ans d’inflation et de bricolage notionnelle absurde pour faire tenir cet édifice fondamentalement vicié, s’appelle le courant réaliste. Il est la forme pure de la métaphysique occidentale. Ce courant est officiellement soutenu par l’Église médiévale, et ses représentants iront jusqu’à se voir canonisés – ce fut le cas de Thomas d’Aquin dit Saint Thomas, inaugurateur du « thomisme » qui n’est en fait qu’une forme de réalisme scolastique. Ce premier courant propose la thèse suivante : les Idées pures telles qu’elles ont été inventées par les antiques penseurs de la métaphysique sont des choses réelles, elles existent vraiment, et ce sont elles plutôt que les choses particulières qui composent le monde sensible qui sont des « êtres ». La connaissance doit donc apparaître comme la connaissance de l’universel général abstrait, qui est dit être réalité.
« Ce qui doit être avoué, professé par tous les réalistes conséquents, c’est que leur être premier est réellement, substantiellement, le seul être, et que les généralissimes, les genres, les espèces, les individus sont des parties de cet être, si même ils ne sont pas moins encore, c’est-à-dire des apparences sous lesquelles la vérité se dissimule à notre intelligence imparfaite, qui pose l’un, mais ne le connaît pas. »
Barthélemy Hauréau, De la Philosophie Scolastique, tome I, éditions Classics, 2005.
On retrouve donc dans la thèse réaliste la forme la plus pure de la métaphysique occidentale : seules les εἶδος sont vraiment réels. Cette doctrine a bien entendu régner sans conteste pendant toute la durée du triste Moyen Âge. La pensée occidentale, hystérisée par la quête de la connaissance pure du « monde objectif », de la vérité-vraie, s’était enfermée dans une élaboration véritablement labyrinthique et lugubre, où toute réflexion se perdait, se noyait vraiment entre la cause première, l’Un, l’engendré et l’inengendré, l’être, et tous ce réseau de concepts abstraits, hérités des temps anciens, qui cloisonnaient et limitaient l’exercice de l’intelligence humaine. La scolastique était un édifice d’une lourdeur incroyable, et d’un conservatisme véritablement mortifère. La secte réaliste, particulièrement, s’était radicalement éloignée de toute possibilité de produire un discours ne serait-ce qu’utile à l’homme, par l’excès de sa technicisation langagière, qui ne masquait que la vacuité de ses formules et son approche.
« Quelle est la signification de ces expressions : la cause première n’entre pas nécessairement dans la seconde, par l’essentielle subordination des causes secondes, qui en peut aider l’opération ? […] Quand quelqu’un écrit des volumes entiers de ce fatras, est-ce qu’il est fou ou essaie-t-il de rendre les autres fous ? »
Thomas Hobbes, Le Leviathan, Chapitre 8, éditions Gallimard, 2000, page 164-165.
Le réalisme s’est pourtant petit à petit trouvé challengé à l’intérieur de l’École par un second courant, une seconde secte qu’on appelle la secte nominaliste. Guillaume d’Ockham, s’il n’en est pas le fondateur, en fut le plus brillant représentant. Parmi les premiers européens à relever la tête, à outrepasser la tradition brumeuse pour replacer l’homme au centre de l’activité connaissante, d’Ockham est sans conteste l’un des premiers Modernes. Posant son fameux rasoir (Pluralitas non est ponenda sine necessitate ou Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem) il déclare un principe d’économie selon lequel l’explication la plus simple, celle qui admet le moins d’hypothèse ad hoc, doit être privilégiée. Ce faisant, il rappellera l’évidence qui habitait toute la scolastique mais qu’aucun réaliste n’osait formulé, de peur de perdre se chaire ou son âme (car on pouvait être excommunié pour avoir prononcer la critique du réalisme, et ce sera le cas de Guillaume d’Ockham) : les « universaux », les εἶδος, ne sont que de mots, ils ne sont pas des réalités.
« Ainsi, les espèces, les genres, et ce qu’il y a de plus général, tout cela n’est pas la substance, puisque la substance c’est l’individu […]. Ainsi s’expriment les nominalistes éclairés, et cette profession de foi philosophique s’appelle le conceptualisme. »
Barthélemy Hauréau, De la Philosophie Scolastique, tome I, éditions Classics, 2005.
La première ouverture dans la métaphysique, la première brèche, fut donc posé par le parti nominaliste de la scolastique. Ce parti viendra percuter la légitimité intellectuelle de l’université médiévale. Il va faire s’effondrer l’édifice. Le nominalisme vient en effet replacer la subjectivité au cœur du processus de connaissance : les « universaux », les « êtres premiers », la « cause première » et toutes ces choses ne sont que des mots, que des noms que l’homme a inventé lui-même pour produire la mise en narration du monde qu’il observe.
L’enseignement nominaliste est, pour nous, Modernes, d’une importance inquantifiable. Sans ces héros de la pensée orgueilleuse, qui surent rester fidèles à ce qui leur semblait évident plutôt que de se compromettre au service de l’institution, nous serions sans aucun doute aujourd’hui, encore là, soit à copier des formules indéchiffrables dans des monastères humides, soit à gratter la terre comme des animaux pour en récolter quelques fruits.
En effet ni le progrès technique, ni le progrès de l’intelligence ne peuvent se produire dans la structure métaphysique. Toute l’énergie cérébrale de l’homme s’y consacre à l’étude et l’élaboration de formule vide de sens. Rien alors ne peut être donné, ni comme énergie, ni comme connaissance, à la production d’un savoir visant la transformation technique de notre monde : la métaphysique sacralise un monde posé-là comme objectal, indépendant de l’homme et de son action, interrompant de façon paradigmatique la possibilité pour le sujet de s’engager dans la production d’un monde selon ses propres besoins. C’est donc bien la Modernité qui s’inaugure dans la rupture de l’édifice métaphysique de la scolastique. Et cette Modernité s’annonce comme le triomphe du sujet face à l’objet, après le millénaire de subordination de la subjectalité à l’objectivation.
Nous définissons la Modernité comme le triomphe du sujet face à l’objet, c’est-à-dire le triomphe des concepts posant le sujet comme référence, comme centre, plutôt que de faire de l’objet le centre et du sujet la périphérie qui doit s’y conformer. Il va sans dire, cependant, que la Modernité n’est pas aboutie avec l’éclatement du nominalisme et l’effondrement de la scolastique. Elle n’apparaît à ce moment que comme lueur, comme éclair. Elle est un foudre qui vient soudain allumer le sombre abysse de l’Europe chrétienne, mais elle n’est pas encore achevée. L’éclairage nominaliste annonce en ce sens le choc des Lumières. La mission n’est pas terminée. Les Lumières poursuivront, évidemment, l’oeuvre de Guillaume d’Ockham qui les préfigure en de nombreux sens. Le nominalisme entraînera la création d’un courant dit « sensualiste », et lui-même se prolongera dans l’empirisme des Lumières anglaises et écossaises. Mais le nominalisme entraînera aussi la création d’un courant dit « conceptualiste », que certains voient comme l’origine de l’idéalisme critique des Lumières allemandes.
« En effet, le sensualisme, comme on le définit, consiste à établir que toute notion vient des sens, et les conceptualistes, pour le plus grand nombre, acceptent les idées générales sans trop rechercher d’où elles viennent. Le conceptualisme, comme l’a déjà fait remarquer M. de Rémusat, a de plus intimes rapports avec l’idéalisme critique ; il est même facile de prouver qu’entre le conceptualisme d’Abélard et l’idéalisme de Kant, il y a, sur beaucoup de points, un parfait accord. »
Ibid.
Comme les nominalistes, les Lumières cherchent à s’en prendre à la métaphysique pour replacer le sujet au centre du monde. On ne saurait prendre meilleur exemple de ce souci du sujet que la fameuse « révolution copernicienne » de Kant. Ce n’est plus l’homme qui se conforme aux objets, mais c’est l’objet qui se conforme aux catégories mentales de l’homme. Kant laisse en suspend la question de l’être fondamental de la métaphysique, qu’il ne parvient pas encore à identifier comme la source véritable de toutes les confusions, pour mieux affirmer l’importance du sujet dans la relation sujet-monde. Il y a encore chez Kant la dualité des mondes qu’on admettait déjà chez Platon. D’un côté se posent les noumènes, les « choses en soi », que Kant annonce directement comme inconnaissables. De l’autre côté se posent les phénomènes, les « choses pour soi », qui sont les choses se réglant sur les catégories mentales du sujet. Ainsi chez Kant le monde apparaît toujours pour un sujet, et n’apparaît jamais dans son objectivité universelle. Le sujet redevient le centre de la faculté de connaître, car se sont ses catégories qui produisent l’objet observé tel qu’il est observé.
Avec l’exemple de Kant, on peut admettre que le sujet progresse encore dans son émancipation du Gestell métaphysique. La Modernité kantienne est donc plus moderne que la Modernité nominaliste. Nous essayons de dégager ici l’idée d’une Modernité non pas comme temps, ou comme mode historique, mais plutôt comme un processus qu’on appellerait la modernisation. En effet, à chaque étape de la critique de la métaphysique, celle-ci se ré-insert, se maintient ou se reproduit dans les constructions philosophiques que chaque Modernes élabore : Kant, s’il reste métaphysicien à un certain degré, avance tout de même dans la critique de la métaphysique. La modernisation serait donc le processus cumulatif ou plutôt soustractif par lequel, d’étape en étape, la métaphysique tend à disparaître du monde occidental. Comme il existait encore une métaphysique chez les nominalistes, il existe une métaphysique résiduelle chez Kant. Et à mesure que la métaphysique diminue son emprise sur notre temps, à mesure qu’elle devient plus rare, elle devient aussi plus scandaleuse, plus dérangeante, et les critiques à son égard s’aiguisent et se durcissent.
C’est donc dans la période où la métaphysique semblait être la plus réduite et la plus affaiblie, qu’elle fut identifiée comme le plus grand danger. On doit a Nietzsche un premier véritable diagnostique radical et performant de la métaphysique occidentale en tant que problème structurel de l’Occident. Il va organiser une série d’assauts véritablement intentionnels contre la métaphysique en tant que système d’affaiblissement de l’homme occidental. Diagnostiquant la « mort de Dieu », qu’il regrette peut-être, mais dont il se console par une volonté d’accélérer la construction d’un avenir libérer de la métaphysique, Nietzsche va interroger les catégories fondamentales de ce système mortifère : les arrières-mondes, le transcendantal, l’Un, l’Être, la cause première, et tous ce dispositif que nous avons décrit plus haut.
La grande offensive nietzschéenne sera contre les arrières-mondes, ces mondes que le métaphysicien prend pour les lieux du vrai et de l’Être, alors mêmes qu’ils sont les mondes avec lesquels le sujet en tant que sujet vivant, singulier, ne peut pas relationner : les mondes des idées de Platon, le Paradis contemplatif chrétien, mais aussi le monde nouménal de Kant. Mais la critique nietzschéenne ne sera pas une critique métaphysique de la métaphysique, au sens où elle partira bien du sujet, du type d’homme, plutôt que de l’objet, du concept ou de l’εἶδος. Malades et moribonds furent ceux qui méprisèrent le corps et la terre et qui inventèrent les choses célestes nous dit-il dans son Zarathoustra. En ce sens, Nietzsche va produire un renversement de la métaphysique, qui sera pour nous salutaire. Au lieu qu’elles soient l’Être idéel dont les représentations subjectives sont le reflet, les Idées deviennent chez Nietzsche le reflet du sujet qui les porte. Le sujet devient véritablement la mesure du monde.
« Ce n’est que l’homme qui a donné une valeur aux choses, afin de se conserver, – c’est lui qui a donné aux choses leur sens, un sens d’humain. C’est pourquoi il se nomme « l’humain », c’est-à-dire celui qui évalue. Évaluer, c’est créer : écoutez-vous les créateurs ? L’évaluation, c’est le trésor et le joyau de toutes les choses évaluées. Ce n’est que par l’évaluation que se fixe la valeur : et sans évaluation l’existence serait une noix creuse. Écoutez-le, vous, les créateurs. Le Changement des valeurs, – c’est le changement d es créateurs. Celui qui doit être un créateur, celui-là détruit toujours. »
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Des milles et un buts, Classique, 1983, page 78.
L’humain, le sujet, redevient chez Nietzsche le créateur du monde. Non pas au sens où il fabrique le monde comme il le souhaite à partir de rien, ou à partir de lui-même, mais au sens où le monde objectif devient un monde auquel le sujet seul doit donner un sens. S’il n’abolit pas encore l’objectalité, il abolit bien l’objectivité. Nietzsche renverse le platonisme et la métaphysique en posant le sujet comme premier dans la relation sujet-monde. Les choses demandent une évaluation qui est toujours l’évaluation d’un sujet. Aucune chose, nous apprend Nietzsche, ne peut être évaluée comme bonne ou mauvaise, haute ou basse, ici ou là, utile ou inutile, sans l’homme qui produit son évaluation. La vérité redevient le produit du sujet, et non sa conformation avec l’objet.
On doit donc à Nietzsche un saut significatif dans la déconstruction de la métaphysique occidentale. C’est lui, véritablement, qui va réaffirmer l’étude du sujet en tant que sujet singularisé, dont la perspective sur le monde ne doit plus tendre à la déclamation d’une vérité universelle abstraite. Nietzsche nous dit en substance ceci : ce n’est plus l’homme qui doit se conformer au monde, mais le monde qui doit se conformer à l’homme. On y retrouve certes une forme de kantisme, mais l’abolition du monde nouménal y est plus absolue, plus radicale. Là où Kant le laissait en suspend, Nietzsche en organise la destruction méthodique : le monde des idées, des abstractions, devient simplement l’une des modalités par lesquelles un type de sujet (le sujet faible) pense le monde réel, ou plutôt le nie. À ce titre, Nietzsche pousse encore plus loin que Kant le processus de modernisation. NIMH a donc parfaitement raison, lorsqu’il dit : « Nietzsche, tout antimoderne et farouchement anti-démocrate qu’il soit, incarne néanmoins par sa vision du monde l’accomplissement de la Modernité sur ce point. La Modernité a réalisé, lentement mais sûrement, la volonté nietzschéenne de relativiser l’absolu de la vérité et la destruction des catégories de cause finale, d’unité et d’être. Un stade qu’on nommera post-modernité, mais qui n’est que l’aboutissement du tournant qu’elle a emprunté à partir de Kant. »66
Nous ne pouvons que tomber d’accord avec NIMH sur ce point : Nietzsche est un Moderne, ou plutôt, selon notre propre terminologie, un modernisateur. Il ajoute également que la modernité est nietzschéenne, ce qui, à notre sens, n’est qu’à demi-vrai : la modernisation est un combat, une tension entre deux pôles qu’on appelle la Métaphysique et la Modernité, et encore aujourd’hui, malgré les acquis nietzschéens, ce combat n’est toujours pas terminé. Il existe dans notre contemporanéité du nietzschéisme autant que de la métaphysique, et il faut encore lutter.
La métaphysique a, en effet, survécu à Nietzsche. Elle lui a survécu parce qu’il n’a su qu’égratigner son fondement le plus lointain, sa prémisse qui pose l’existence du monde objectif comme monde indépendant du sujet. Nietzsche a bien replacer ce monde dans une dépendance au sujet, mais il n’a pas su l’abolir. Nous sommes en droit de nous demander jusqu’où sa critique est vraiment allée. Est-elle réellement allée si loin que ça ? Et si Nietzsche n’était pas venu abolir la métaphysique, mais plutôt l’accomplir en la renversant ?
C’est en tout cas cette thèse que défendra Heidegger. Modernisateur lui aussi, à son corps défendant, Heidegger fut bien le plus éclairé des Modernes sur les dangers de la métaphysique qui survivaient dans la modernité. Heidegger prend la suite de Nietzsche dans la déconstruction de la métaphysique occidentale. C’est lui qui a véritablement défini la notion de monde objectif comme point de départ de toutes métaphysiques. Pour Heidegger en effet, la métaphysique se nourrit essentiellement d’une séparation, d’une dualisation du monde entre un pole sujet et un pole objet. Cette séparation qui pose d’un coté le sujet et de l’autre coté le monde objectal, est à la source du Gestell métaphysique. Pour aller au-delà de Nietzsche, et poursuivre la critique de la métaphysique, il faut à présent s’attaquer à son fondement : la dualité sujet-objet est une invention.
« La question de savoir s’il est en général un monde et si son être peut être prouvé est, en tant que question que le Dasein comme être-au-monde pose – et qui d’autre irait la poser ? – dénuée de sens. De plus elle souffre toujours d’une ambiguïté. Monde au sens de ce à quoi réfère l’être-au et « monde » au sens d’étant intérieur au monde, celui avec qui la préoccupation ne fait qu’un, sont confondus ou, plus exactement, n’ont même pas été d’abord distingués […]. On pose la question de la « réalité » du « monde extérieur » sans avoir auparavant tiré au clair le phénomène du monde comme tel. Factivement, le « problème du monde extérieur » s’oriente constamment sur l’étant intérieur au monde (les choses et les objets). De ce fait ces discussions aboutissent à une problématique ontologique presque inextricable. »
Heidegger, Être et Temps, §43, Gallimard, Paris, 1986, page 203.
Chez Heidegger il n’existe pas un sujet d’un coté et un « monde » de l’autre coté. Il existe l’existant, le Dasein, qui est un moi en tant que signifiant un monde. L’existence du monde ne peut être saisie qu’à travers le Dasein, qui le fait donc exister à travers lui. Tout monde devient un surgissement que le Dasein occasionne dans son activité d’existence. La mondanité n’apparaît enfin plus comme une entité statique, mais comme un phénomène dynamique lié à l’être du Dasein. Cet être est d’ailleurs co-constitué par le monde, puisque la mondanité devient l’être-au du Dasein (qui est toujours l’être en tant qu’être-au-monde).
Après que Nietzsche ait abolit l’objectivité, c’est bien Heidegger qui abolit l’objectalité. Il nous indique que le monde comme « posé-là » est une fiction. Heidegger réussi à condenser en une même notion ce qui était séparé par la métaphysique : l’objet et le sujet ne doivent plus être distincts ; ils doivent se penser dans leur relation co-constituante. Le monde est ce qui apparaît par l’Être du Dasein. Ainsi l’Être que la métaphysique avait vulgairement réduite à un « quoi » redevient enfin un « comment ». Être, chez Heidegger, ne désigne rien d’autre que « être » dans le langage courant : c’est n’est pas une chose, mais un verbe qui désigne le mode évènementiel par lequel le Dasein fait apparaître la chose. Il n’y a donc plus, chez Heidegger, un sujet perdu au milieu du monde posé-là, qui chercherait à connaître ce monde en se conformant à son objectalité. Il n’y a qu’un Dasein qui est la façon dont l’être-au-monde se résout singulièrement. Cette résolution est dynamique : le Dasein est ce qui signifie le monde ; le monde est le signifié singulier de l’être-au de l’existant.
On reconnaît volontiers que la philosophie heideggerienne peut paraître difficile d’accès – et son vocabulaire spécifique joue pour beaucoup dans cette pénibilité que le lecteur rencontre. Pour toute technique et complexe qu’elle soit, elle reste pourtant plus évidente que la métaphysique : ce qu’Heidegger décrit n’est rien d’autre que la vie du moi, l’homme, tel qu’il est au monde. Dans mon quotidien en effet, dans ma vie comme vie humaine, je ne me réfère jamais au monde comme un monde objectal posé-là auquel je devrais conformer mes catégories. La « réalité » qui m’entoure n’est jamais une réalité parfaite, objective, universelle, « vraie » et ontologiquement distante. Elle est une « réalité » en relation avec moi, ou plutôt, ce que j’appelle « réalité » est cette relation entre le moi et un monde que je fais apparaître. La « réalité » est toujours ce qui prend sens à travers moi. Ce qu’Heidegger est parvenu à atteindre dans sa critique de la métaphysique, c’est la liquidation de l’objectalité du monde. C’est à travers l’homme que se donne un monde dévoilé. L’homme est extrait du monde objectif qui disparaît enfin, non pas au sens où le monde n’existerait que mentalement à l’intérieur du sujet, mais au sens ou l’homme est ce qui donne sens au monde. Nous ne sommes pas, avec Heidegger, si loin de Nietzsche et de son « perspectivisme ». Mais la plus-value heideggerienne est précieuse : Là où Nietzsche voyait dans les perspectives de la volonté de puissance le critère évaluant l’objet, Heidegger abolit la relation sujet-objet pour penser une relation de signifiance, où l’homme est ce par quoi un monde tel que vécu trouve son sens. On retrouve donc chez Heidegger la matrice théorique qui permet bien de structurer la doctrine identitaire, lui fournissant les assises conceptuelles grâce auxquelles elle affirme la non-universalité du monde pour lui préférer les spécificités des mondes comme mondes vécus et signifiés singulièrement.
On pourrait peut-être s’amuser à considérer que la métaphysique n’est pas encore aboli parfaitement avec Heidegger. Nous laissons volontiers, d’ailleurs, le soin aux philosophes de poursuivre ces questions et d’achever toujours plus loin la modernisation dont nous parlions, car, il est vrai, la philosophie n’est jamais terminée. Cependant, le matériau critique de la métaphysique que nous fournissent conjointement Nietzsche et Heidegger suffit essentiellement à jeter les bases de la structure théorique de l’identitarisme. En effet, l’identitaire cherche à définir le sujet – entendu cette fois comme sujet politique et non plus philosophique – comme ce part quoi le monde se vit singulièrement. Nous le disions, l’identitaire admet que chaque sujet, selon son identité, donne un sens et une signifiance singulière et spécifique au « monde » ou à la « réalité ». L’identitarisme est bien, au fond, un perspectivisme appliqué aux sciences politiques.
L’identitarisme est une doctrine philosophiquement moderne, ou moderniste. Cette modernité est posée dans l’inconciliabilité des fondements théoriques de notre doctrine et des dispositifs notionnels de la métaphysique. En effet, c’est bien la critique de la métaphysique, dans la forme qu’elle a pris dans l’histoire récente de l’Occident, qui est à la source des concepts identitaires. Si aujourd’hui nous sommes en mesure de concevoir la non-universalité des intérêts politiques, si nous sommes en mesure de penser que tous les êtres humains n’ont pas entre eux, ontologiquement, des intérêts convergents, mais se distinguent par les singularités qui leur sont propres, c’est parce que nous sommes capables de penser que quelque chose comme le « monde objectif » n’existe pas : c’est bien parce que chacun donne une signifiance différente au monde, que tous n’en font pas la même expérience, et que des expériences contradictoires, conflictuelles, différenciatrices peuvent surgir et structurer un « réel » d’opposition et de distinction. L’identitaire rejette nécessairement la métaphysique, parce qu’il rejette l’universalité du monde ainsi que son objectivité : c’est le sujet, par son existence, par sa perspective singulière, qui va donner au monde sa couleur, sa signifiance, son sens. En ce sens l’identitarisme est bien ennemi de la métaphysique. Il nie l’universalité des règles, des lois, des institutions, des propositions, des connaissances, des expériences, des vécus, etc., et les replace systématiquement dans les catégories qui singularisent le sujet et donc l’affecte à un monde-vécu singulier.
Si l’objectalité doit réapparaître comme mode principal de la relation sujet-monde, ou, autrement dit, si une doctrine vient refaire éclater le dualisme sujet-objet au lieu de penser le monde comme le signifié d’un moi existant singulier, alors l’universalisme va mécaniquement dominer le différentialisme. En effet, nous l’avons vu, la métaphysique se défini par sa quête de l’objectivité qui induit systématiquement une quête de la neutralité du sujet afin qu’il puisse se conformer aux vérités objectives. Si le monde se pense non plus comme ce qu’un moi singulier vient signifier, mais comme un champs d’étants objectifs posés-là, alors le sujet, pour atteindre une vérité, pour formuler des lois justes, pour penser des institutions fonctionnelles, pour réfléchir les phénomènes mondains, doit se neutraliser afin de se conformer à ce champs d’étants, à ces règles qui le sur-déterminent et qui sont les règles objectives. Il devient ce sujet universel abstrait, le « non-racisé », le non singulier, le non-spécifique. Il devient l’être-général en général. Il devient l’être métaphysique. Quel péril pourrait être tenu par l’identitaire comme plus grand qu’une résurgence de la métaphysique ? Aucun. Pour l’identitaire les mots « péril » et « métaphysique » se confondent parfaitement : la quête de l’universel objectif est la quête du gauchisme.
Ne croirait-on pas, pourtant, que le gauchiste, ce « post-moderne », ce foucaldien, manipule les mêmes notions que l’identitaire ? Il les manipule, certes, mais dans leur acception critique. Si le gauchiste parle d’identité, de blanchité, de rôles sexués, etc., c’est pour mieux les abolir. Le gauchisme contemporain est une absorption du perspectivisme nietzschéo-heideggerien sur un mode purement critique, qui vise le dépassement des perspectives, donc la négation des identités. Le gauchisme propose que la structure paternaliste, l’État, prenne conscience de la différence des vécus et des mondes signifiés, non pas pour les affirmer dans leur irréductibilité et les protéger, mais pour que cette structure surplombante possède les outils nécessaire à l’abolition de ceux-ci au sein des rapports sociaux. Le gauchisme vise bien l’effacement de l’identité, mais le vise par le processus de son affirmation critique. Il dit simplement que l’identité existe comme phénomène occasionnant de l’in-universalité , et vise la résolution de celle-ci par un dépassement universaliste des identités. Le gauchisme ne dit pas, par exemple, que l’homme et la femme sont différents parce qu’ils ont des identités différentes. Il dit qu’ils sont semblables, mais que l’identisation les rends différents, et que cette identisation doit être abolie ; c’est bien l’universel abstrait et indifférencié, l’objectivité, que le gauchisme vise toujours. L’erreur d’une certaine droite est d’avoir cru que le perspectivisme était au cœur de cette matrice critique, au lieu qu’il n’en était que la périphérie, pendant que son cœur restait évidemment le souci métaphysique de l’universel. Cette droite là a cru pertinent d’affronter la gauche en désactivant son modernisme critique par une critique métaphysique de ses concepts, au lieu de désactiver sa critique de la modernité par une critique de sa métaphysique.
NIMH au secours de la Métaphysique ?
Après ce long voyage à travers l’histoire de la philosophie occidentale, nous espérons ne pas avoir trop égaré notre lecteur. « Mais quel rapport avec NIMH ? » Voilà l’interrogation qui l’agasse depuis maintenant plusieurs pages. Pourtant ce détour était nécessaire. En fait, ce détour n’en était pas un : nous n’avons fait que justifier jusqu’ici notre rejet de la métaphysique. Ce rejet vient bien du fait que cette construction théorique lugubre est cause de la difficulté du sujet occidental à se penser dans la singularité politique de son occidentalité. La métaphysique est la structure morale et mentale historiquement responsable de l’universalisme et de l’égalitarisme qui se retraduisent eux mêmes politiquement comme causes d’un certain nombre de phénomènes que nous vivons, en tant qu’européens occidentaux, comme des phénomènes de violence, de paupérisation, de brutalisation, de soumission, d’aliénation, bref, des phénomènes allant à l’encontre de nos intérêts politiques premiers.
Il apparaît en outre que NIMH est, comme nous, opposé politiquement aux structures qui produisent ces phénomènes dont le sujet occidental peut pâtir. Nous sommes bien des alliés, au moins sur les grandes lignes, et nos projets politiques respectifs ne divergent qu’assez peu. Si nos projets politiques peuvent se confondre, il semble pourtant que nos soubassements théoriques soient fort différents, et pour le moins opposés. Le Traité Néo-Réactionnaire est un ouvrage conceptuellement riche. C’est un livre d’ailleurs plus philosophique que politique, un livre que je sais reconnaître bien construit, autant par sa forme que par son fond, et je félicite volontiers NIMH pour le travail impressionnant qu’il propose à son lectorat. L’auteur y présente une synthèse de la structure conceptuelle du mouvement « NRx », mouvement auquel je n’étais d’ailleurs que peu familiarisé.
Ma formation théorique m’a toujours poussé vers une préférence pour la philosophie dite « continentale », et les approches anglo-saxonnes me sont longtemps restées étrangères. Je ne suis pas porté à quelque intérêt pour le libertarianisme, et la « néo-réaction » encore moins. Mon parcours intellectuel me fait trouver chez les penseurs continentaux, chez Heidegger et chez les post-modernes des outils théoriques que je trouves plus satisfaisants, dans l’ensemble, que les procédés analytiques qui caractérisent souvent les doctrines américaines ou britanniques. En un sens d’ailleurs, mon opposition aux thèses de cet ouvrage pourrait se réduire à cette vieille querelle entre les philosophies continentales et analytiques. C’est donc avec une forme de curiosité exotique que j’ai parcouru son livre. J’y ai trouvé un nouveau continent théorique, pour moi comme inconnu et sauvage, et j’ai pris plaisir à l’arpenter et à le découvrir. J’y ai rencontrer une topographie étrange, une géologie, un climat, une faune conceptuelle qui m’ont dépaysé. D’abord enthousiasmé par cette rencontre, j’ai eu bientôt le mal du pays : je me trouvais dérouté par ces configurations étonnantes qui me semblaient faire entorse aux assises conceptuelles qui sont les miennes. Il me fallait vite rentrer chez moi, ne souhaitant pas supporter encore un instant cette liquidation des fondements théoriques qui me paraissent être les colonnes les plus solides sur lesquelles l’identitaire doit s’accouder. Il est donc temps désormais d’entamer notre voyage de retour, et d’emmener NIMH avec nous, chez nous.
L’Entropie comme « Grand Récit »
Le système NRx tel que NIMH le présente est d’abord un système narratif. C’est un ensemble de propositions qui se structurent en discours dont le but est de fournir une assise narrative à une doctrine politique. Avant d’interroger les catégories philosophiques que NIMH déploie dans sa narration, il est nécessaire de questionner le dispositif méta-narratif sur lequel il s’appuie. En effet, un discours s’étudie toujours au moins sous deux angles : d’une part, sa fonction performative, c’est-à-dire la manière dont il agit sur ses destinataires pour façonner une vision du monde ou mobiliser une action ; d’autre part, sa structure interne, soit l’organisation logique et symbolique qui lui donne sa cohérence. Avant donc de questionner la pertinence des propositions philosophiques du discours néo-réactionnaire, il faut s’interroger sur la façon dont il se déploie comme discours à proprement parler.
L’auteur s’engage dans la description de ce qu’on appelle depuis Lyotard un grand récit. Les grands récits sont des mises en narration du « réel », des discours qui viendraient, depuis la déchristianisation de l’Occident, satisfaire les besoins d’espérances, de spiritualités et de croyances de l’homme occidental moderne. On pourrait compter parmi les grands récits ceux du Progrès Technique, au dix-neuvième siècle, qui annonçait avec urgence l’apparition d’un monde merveilleux où la machine remplacerait l’homme dans toutes les tâches misérables de sa vie (travail, mobilité, tâches domestiques, enfantement), et du marxisme, qui annonçait au vingtième siècle la venue prochaine du Paradis sur Terre par la révolution prolétarienne et l’avènement d’une égalité matérielle. Les grands récits s’appuient toujours sur une forme d’historicisme, qui entend déceler le mouvement de l’Histoire et annoncer sa conclusion imminente par une résolution magique de tous les maux de l’humanité.
Le grand récit est d’abord un conte, une fable historique, ou plutôt historiciste : il raconte que l’Histoire suit un plan, un mouvement précis et défini, qui doit aboutir à une fin (heureuse les
plus souvent mais parfois malheureuse). Il se compose donc sous la forme d’une téléologie : il existe une fin dernière au mouvement de l’histoire, de sorte que cette fin procède d’une visée intentionnelle ou intentionnaliste. L’Histoire devient le lieu de résolution de forces, à caractère mécanique, qui peuvent d’ailleurs ou non phénoménaliser la volonté d’une conscience qui serait alors de nature divine ou apparentée. Le grand récit admet ainsi quelques critères qui permettent de le définir :
- 1. une loi mécanique engloberait et résoudrait l’ensemble des phénomènes mondains.
- 2. cette loi s’appliquerait également aux phénomènes sociaux de sorte que l’évolution des sociétés la suivrait et s’y soumettrait.
- 3. cette loi serait porteuse d’un sens moral qui permettrait au sujet qui la croit d’avoir confiance dans le fait qu’au terme du processus d’évolution des sociétés celles-ci atteindraient un état béatifique quelconque (égalité, bonheur matériel, abondance, ordre etc.)
NIMH admet l’existence de lois physiques, les lois de l’entropie, telles qu’elles sembleraient s’appliquer à l’ensemble des phénomènes de l’univers. L’entropie est décrite comme une mesure du désordre dans un système. En physique, et plus précisément en thermodynamique, elle désigne la tendance du système à tendre vers le désordre : tout système thermodynamique augmente naturellement son entropie, l’énergie qui est concentrée passant d’un état ordonné à un état désordonné par dissipation. Pour que le système se maintienne à un niveau d’ordre satisfaisant, il faut qu’il dissipe de l’énergie afin de l’employer au maintient de son extropie – créant ainsi de l’entropie autour de lui.
Dans l’approche NRx, cette loi de l’entropie n’est pas limitée à son cadre strictement thermodynamique. L’histoire se résoudrait tout entière par un processus de sélection qui reconduirait les catégories de la loi de l’entropie : plus un système est en mesure de dissiper de l’énergie pour maintenir son extropie, plus il est en mesure de se retrouver en situation de domination face à d’autres systèmes moins capables que lui. Cela est par exemple vrai pour un corps biologique, un vivant : la lionne dissipant plus d’énergie que la gazelle parviendra à l’attraper et l’avaler tout crue. Ou, comme le dit NIMH, « Si le but de la vie est lié à la production d’entropie passant par la dissipation d’énergie, alors l’évolution va nécessairement favoriser les organismes qui dissipent le plus efficacement l’énergie. Les gènes codant pour des traits phénotypiques permettant de mieux dissiper l’énergie seront sélectionnés. Les gènes sont alors un moyen de mémoriser de l’information sur l’environnement par un jeu d’essai-erreur maximisant la dissipation d’énergie. Les organismes disposant des meilleurs gènes sont ceux disposant de l’information la plus précise sur l’environnement au sein duquel ils doivent dissiper l’énergie. L’évolution va sélectionner des organismes de plus en plus complexes afin de maximiser la capacité à mémoriser et traiter l’information en suivant des principes propres à un système cybernétique ». La connaissance humaine, et finalement l’évolution des sociétés seront amenées à suivre peu ou prou le même processus : « Il est donc clair que, du point de vue thermodynamique, le processus de sélection naturelle, s’il s’applique aux structures, peut être réduit en dernière instance à la sélection de l’information qu’elles mémorisent. Dans le cas des plantes ou des animaux, elle s’applique donc aux gènes, mais dans le cas des sociétés humaines, elle s’appliquerait aussi sur la capacité à mémoriser et utiliser de l’information afin de produire de l’énergie libre convertie en travail mécanique. Le gène n’est pas le moyen le plus efficace de mémoriser l’information. Depuis la révolution cognitive ayant eu lieu autour de -70,000, le cerveau de l’homme s’est hypertrophié, lui conférant des capacités supérieures dans ce domaine. Ses fonctions cognitives se sont grandement améliorées et avec elles, le langage et plus globalement la communication. Du gène, nous sommes passés à ce que Dawkins appelle le mème. Plus un organisme, une espèce et une civilisation mémorisent d’information, plus elles dissipent d’énergie ». La sélection naturelle fondée dans l’entropie et les lois de la thermodynamique est ainsi transférée dans le domaine de la connaissance et du savoir : une connaissance pertinente serait une connaissance capable de produire une structure « mémétique » telle que le groupe qui la partage se retrouve en adéquation plus haute avec les lois de l’univers, parvenant à dissiper plus d’énergie. Ainsi s’opère un transfert de la thermodynamique à la biologie, puis aux interactions des vivants entre eux, et finalement aux structures sociales humaines et donc à l’histoire des sociétés. Nous nous trouvons devant ce nouvel historicisme qui entend réduire l’histoire à un processus sélectif des groupes selon le degré de leur adéquation aux lois de l’entropie. Pour être précis, d’ailleurs, ce processus sélectif est, pour NIMH, non intentionnel du point de vue humain, car l’homme ne serait pas en mesure de connaître a priori les modèles adéquats à la loi de l’entropie, et l’histoire avancerait ainsi à tâtons, au fur et à mesure que l’homme essaierait des modèles, échouerait, apprenant étape par étape au cours d’un processus sélectif analogue à celui de la sélection darwinienne.
L’entropie est réputée se trouver au fondement de tout phénomène physique, et, par un jeu de causalité ou de transfert, se répercuterait dans la biologie, puis dans l’organisation des vivants entre eux, et finalement dans les organisations sociales humaines. Les néo-réactionnaires posent ainsi que l’entropie est une loi déterminant le mouvement de l’Histoire, car les jeux d’ordre et de désordre, la capacité d’une société à dissiper de l’énergie, permettraient d’établir des rapports de forces matériels et même des mécanismes de sélections selon lesquels plus un système humain dissipe de l’énergie, plus il est capable de se structurer de façon complexe, plus il est capable de dominer les autres. L’Histoire suivrait donc un sens, une direction faisant signe vers un état de complexité formidable ou la société deviendrait une structure parfaitement ordonnée. Cet état de complexité terminal, cet horizon de l’Histoire, c’est la « singularité », le moment ou la technologie fini par avoir raison de l’humanité, et où nos structures entre dans un stade « post-humain » gouverné par la machine ou l’IA – car elles sont plus aptes que nous à dissiper de l’énergie efficacement.
La description que fait NIMH du processus historique reprend bien les points que nous avions présentés : 1. l’entropie est une loi qui englobe et résout l’ensemble des phénomènes mondains ; 2. la société n’échappe pas à cette loi, et son mouvement historique se voit conditionner par celle-ci ; 3. cette loi est bien vectrice d’un sens de l’Histoire et admet un état de résolution terminal qui apparaît dans la néo-réaction comme l’état post-humain. En ce sens, on peut évidemment parler de l’entropie comme d’un grand récit. Son rôle premier, comme discours, est bien de structurer une croyance plutôt que de décrire une « réalité ». Le discours NRx sur l’entropie, tel que le propose l’auteur, frappe d’abord par sa dimension performative plutôt que descriptive : il s’agit d’un réseau de propositions qu’il ne faut pas prendre comme une description objectivement vraie de la Vérité, mais comme une mise en narration de l’Histoire, du sens et du rôle de l’homme et de ses sociétés.
À ce titre, le discours néo-réactionnaire ne peut pas échapper à la critique lyotardienne des grands récits. L’évacuation de la métaphysique dans nos sociétés contemporaines a eu pour conséquence l’émergence d’un état ou d’une attitude, que Lyotard appelle la « condition post moderne » – on peut considérer qu’il s’agit en fait d’une condition bien moderne. Cette condition de l’homme occidental est caractérisée par un renoncement aux grands récits. Ce renoncement n’est pas à questionner. C’est un état de fait, qu’il s’agit d’accepter sans réserve, au risque de parler dans le vide, sans jamais parvenir à atteindre ou toucher l’oreille du sujet contemporain. En effet, si, à la marge, des individus peuvent avoir l’envie d’y croire, il faut reconnaître que la majorité de nos contemporains ne sera jamais réceptive à ce genre de fable. Cela est dû à l’état moral dans lequel la société moderne plonge l’homme : elle le rend responsable de son devenir. La modernité a abolie les états de tutelle, et à fait surgir, déjà depuis longtemps, un type d’homme mature qui n’admet pas que son être se résolve sur un plan plus fondamental que celui de son existence. Le moderne ne nie pas que sa vie puisse être influencée par des jeux de déterminations locales, mais il rejette l’idée que l’Histoire suive un cursus méta-narratif, une trame ou un plan dont il ne serait qu’un rouage. Et s’il le refuse, ce n’est pas par pur orgueil, ce n’est pas en vertu de cette caricature du moderne qui serait auto-centré, perdu dans l’hubris et le vertige de son égo. C’est simplement parce qu’il a la connaissance que le « monde » est toujours l’horizon d’un moi existant. Le moderne sera toujours capable d’effectuer ce recul critique qui permet de replacer le grand récit dans son lieu propre, à savoir le lieu de la narration et non pas le lieu de la vérité-vraie-objective. Il sera toujours en capacité d’écouter au-delà du récit pour y percevoir le sujet qui le porte. Contrairement à l’Ancien, le moderne n’est plus dupe. Il est ontologiquement incrédule.
Cet état d’incrédulité qui défini l’homme moderne est sans aucun doute un frein à la faculté du discours néo-réactionnaire à se structurer comme phénomène politique de masse. Au mieux, le moderne restera sceptique ou indifférent devant ce discours qui réactive une croyance spéculative. Mais le plus souvent, il adoptera une attitude matérialiste critique : il cherchera à identifier, à l’intérieur des jeux de déterminations matériels qui structurent le « réel », ce qui fait dire aux néo réactionnaires le discours qu’ils formulent, ou ce qui fait croire que ce discours est « vrai ». Cette démarche ne vise d’ailleurs pas tant à réfuter le contenu du récit NRx qu’à le « déconstruire » en tant que produit des déterminations d’un moi existant : derrière l’entropie comme loi universelle ou la singularité comme horizon, il décèle les intérêts, les angoisses ou les fantasmes d’individus existants, de sujets en quête d’un discours pour légitimer leurs désirs politiques, désirs que nous acceptons par ailleurs comme éminemment légitimes en soi indépendamment du type de discours qui les mets en narration. Loin de s’en remettre à la vérité proclamée du discours, le moderne le ramènera à sa condition de narration, le dissolvant dans le flux des intérêts ou des déterminations locales qui structurent la réalité politique du sujet qui le porte.
En tant qu’identitaire et en tant que moderne, c’est donc dans les déterminations politiques et sociales que véhiculent notre identité que nous descellons le « vrai » du discours néo réactionnaire : c’est parce que le sujet européen occidental est pris au sein de tel et tel conflits politiques (décrochage économique, instabilité internationale, insécurité, chute démographique, dévalorisation symbolique etc.) et parce que ses désirs politiques sont systémiquement refoulés par un pouvoir engagé contre ses intérêts, qu’il en vient à inventer des mises en narration de ce genre. Le récit NRx, avec son entropie et sa singularité, n’est pas une vérité-vraie-objective jaillissant de la pure description objective d’une loi universelle, mais une construction narrative qui traduit surtout l’ampleur de la crise du sujet occidental. Nous y voyons donc moins la révélation d’une « vérité » qu’un pur symptôme, celui d’une crise profonde de l’être-occidental, que la néo-réaction renonce à diagnostiquer pour préférer la recouvrir sous le voile d’une narration qui va redevenir métaphysique et qui, donc, en reconduira finalement les conditions et les catégories.
Le grand récit NRx cache quelque chose. Ce qu’il cache, c’est un sujet, un individu qui ne veut pas être démasqué, qui ne veut pas assumer qui il est. Afin de situer ce discours dans la seule réalité à laquelle il est lié, la réalité du sujet politique qui la porte, nous allons donc dévoiler à présent le sujet qui s’est lâchement maquillé derrière une prétendue objectivité : la doctrine NRx est née des thèses d’un blogueur américain nommé Curtis Yarvin. Yarvin est blanc, chevelu, binoclard, c’est un informaticien et un geek. Également connu sous le pseudonyme de Mencius Moldbug, c’est une sorte de « techbro » marginal un peu nerd. Ses idées, pour le moins hétérodoxes, vont trouver un certain écho dans les milieux de la « tech », dans la Silicon Valley, et au près de milliardaires comme Peter Thiel. Elles vont aussi trouver une caisse de résonance chez un penseur lui aussi anglo-saxon, Nick Land. Ce philosophe contemporain semble avoir un parcours étonnant : d’abord plutôt deleuzien, ayant fait une thèse sur Heidegger, il va rompre avec ses premières intuitions philosophiques pour rejoindre le courant Dark Enlightment et la néo-réaction. Ce courant se structure alors autour de quelques références théoriques, souvent très anglo-saxonnes et peu étudiées en Europe : Thomas Carlyle, Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe. Il est marqué par un imaginaire et un univers « pop » particulier, à mi-chemin entre Matrix, le cyberpunk et l’ésotérisme lovecraftien.
Les néo-réactionnaires sont des individus formés aux sciences dures, de geeks blancs occidentaux qui pensent leur environnement à partir de certains tropismes. Ils ne viennent généralement pas des sciences sociales ni des sciences politiques. Ils ne viennent pas non plus des humanités, de la littérature classique, etc. Leur réalité est structurée par une façon particulière de signifier le monde. « Boucle de rétroaction », « Singularité », « phénomènes exponentiels », « implémentation », « information », « hyperstition », « patchwork », « red pill », « cybernétique », voilà le vocabulaire avec lequel ils pensent le monde. S’ils ont construit un narratif dans lequel la réalité découle entièrement de lois physiques, cela tient sans aucun doute au fait que dans leur réalité un tel vocabulaire est largement structurant. Loin de décoder l’ensemble de la réalité objective, loin de décrire les lois fondamentales de l’univers, ils font exactement l’inverse : ils réduisent la réalité entière à leur réalité à eux – nous ne le leur reprochons pas, d’ailleurs, puisque nous affirmons qu’il n’est pas possible de faire autrement. Pour eux, par exemple, les structures sociales et les appareils de production se pensent et se formulent en terme de « dissipation d’énergie ». Ils ne savent pas les formuler autrement. Ils ne sont pas pour eux des lieux sociaux, des lieux d’échanges et d’interactions où se nouent des jeux de pouvoirs, de normes, de comportementalités, des conventions morales, des arbitrages symboliques etc. Notre souci n’est d’ailleurs pas de dire qu’une entreprise doit se penser en tant que lieux d’interactions sociales plutôt que comme mécanisme de dissipation d’énergie, ou inversement. Notre souci est de rappeler que la façon de percevoir tel phénomène comme ceci plutôt que comme cela nous en dit plus sur l’individu qui opère cette perception que sur l’hypothétique réalité en soi dudit phénomène. Et, cela est aussi important, l’identité de l’individu nous rend raison de la façon dont il perçoit les réalités : le grand récit NRx ne vaut finalement que pour un sujet particulier qui ne sait pas formuler sa réalité autrement qu’avec son vocabulaire de techbro.
Par notre condition moderne, nous savons tenir le discours néo-réactionnaire pour ce qu’il est, c’est-à-dire justement un discours et non pas la description objective d’une Vérité de nature transcendantale. Nous avons senti très vite que ce discours cachait quelque chose. Nous avons pu identifier ce discours comme un « grand récit » au sens lyotardien, une méta-narration des désirs et des perspectives politiques du sujet qui le porte. Ce qu’il cachait, donc, c’est un sujet. Un sujet cherchant à décrire le monde qu’il perçoit à l’aide de signifiants spécifiques. Un sujet identisé, affecté à certaines déterminations qui le définissent à l’intérieur des rapports sociaux.
NIMH est un européen occidental du vingt-et-unième siècle. Comme tout européen occidental de notre temps, il est confronté à certaines problématiques sociales et politiques qui lui sont propres. Ces diverses problématiques appellent des solutions politiques. Pourtant, dans le monde qu’il expérimente, NIMH, comme moi-même, ne trouve pas les outils politiques nécessaire pour les solutionner. Au contraire, il fait fasse à un système, un pouvoir qui assume le refoulement permanent de ses désirs. Ce pouvoir se construit essentiellement comme un système d’aliénation et de répression : les structures institutionnelles occidentales œuvrent largement contre l’intérêt spécifique des occidentaux. Il est clair que l’aliénation occidentale entretient des liens étroit avec les valeurs morales que véhicule la métaphysique comme nous la définissions plus haut : la neutralisation du sujet qui empêche de penser ses spécificités identitaires, l’universalisme, ou encore l’égalitarisme qui est en un pendant matériel. Certes ces phénomènes sont des phénomènes politiques produits par des individus, des institutions, des normes, et ne sont pas directement des décrets issus de la métaphysique, du platonisme ou de la scolastique. Cependant, ces phénomènes se fondent dans la façon dont l’homme occidental qui produit son monde politique se perçoit lui même. Or, il est évident qu’à ce niveau là, la métaphysique qui a marqué plus d’un millénaire de notre civilisation agit encore et structure nos représentations du monde, nos valeurs, nos réflexes psycho-affectifs. La sécularisation du christianisme, cette opération de transfert des normes religieuses aux normes morales, politiques et institutionnelles, est bien au cœur des structures de pouvoir en Occident.
Intellectuellement, nous nous opposons bien à ce substrat métaphysique qui survit encore aujourd’hui comme système d’aliénation dans les normes morales, les structures institutionnelles et les lieux de pouvoir. Aucune critique de la métaphysique sous sa forme politique et sociale ne peut se passer d’une critique de la métaphysique sous sa forme philosophique et conceptuelle. En effet, le socio-politique est un champs traversé par des idées, des représentations, des imaginaires que la philosophie contribue à produire. Une « déconstruction de la métaphysique occidentale » comme le souhaitait Heidegger doit aujourd’hui passer par une déconstruction du sujet politique comme sujet métaphysique, c’est-à-dire ce sujet abstrait, universel, légaliste, égalitaire ou égalisé, qui n’existe pas comme être-au-monde du sujet politique réel – qui est, lui, toujours un sujet identisé. Or, une telle déconstruction doit bien passer par un renoncement aux grands récits qui posent le sujet dans un rapport métaphysique à la réalité, au lieu de se demander comment le sujet produit son monde, et comment il déploie des discours en lien avec son identité pour mettre en narration le monde qu’il vit singulièrement.
Ainsi, pour nous, il est clair que le dénouement de la crise occidentale doit passer non pas par l’élaboration d’un nouveau grand récit qui reconduirait des catégories métaphysiques, mais bien par la reconnaissance de l’ontologie du sujet situé, c’est-à-dire par la reconnaissance du sujet identisé pris dans ses rapports au monde politique. À ce titre, toute doctrine philosophique qui entend formuler des vérités objectives et universelles de nature transcendantale (néo-thomisme, objectivisme, etc.) travaillent finalement contre l’identitarisme, et donc contre le dénouement de la crise qui ébranle l’Occident, et qui l’ébranle non pas depuis le wokisme, non pas depuis le traité de Maastricht, mais au moins depuis Constantin et l’avènement du césaropapisme romain. Or, il nous semble que la doctrine néo-réactionnaire, à de nombreux égards, est à mettre au compte de ces doctrines métaphysiques contemporaines.
Comment une physique métaphysique est-elle possible ?
Nous reprochons donc à NIMH d’annoncer une nouvelle métaphysique. La néo-réaction est bien, avant tout, de la néo-métaphysique. À ce titre, il faut dire qu’elle porte bien son nom, les « réactionnaires » s’étant toujours réfugiés dans la métaphysique pour maquiller leurs angoisses et leurs fantasmes politiques. Jusqu’ici, d’ailleurs, ce refuge dans la métaphysique ne leur a jamais permis de remporter aucune victoire dans l’Occident Moderne. Mais à la différence des vieux réactionnaires, des royalistes providentialistes qui prient et attendent patiemment que le Saint-Esprit remette un roi sur le trône de France, le courant NRx part d’abord de considération physiques, donc bien matérielles. Comment ce discours pourrait-il être « métaphysique », alors même qu’il part de données physiques, scientifiques, pour formuler ses propositions ? Comment, donc, une physique métaphysique pourrait-elle être possible ?
La réponse à cette question n’est en fait pas compliquée. La néo-réaction formule une métaphysique à partir des mêmes éléments qui permettent de formuler toute autre métaphysique : l’organisation d’une dualité sujet-monde, la proclamation de l’objectalité des phénomènes mondains, et finalement l’affirmation de l’indépendance de l’objet à l’égard du sujet. Encore une fois, l’esprit étroit croirait que l’on peut s’arrêter là sans que ne s’engage forcément une spirale inflationniste dans laquelle la valeur de la réalité sensible s’effondre jusqu’à ce qu’émerge un monde des idées, une cause première, un Être eidétique etc. Il se dit : « après tout je peux bien affirmer que le monde est fait d’objets indépendants du sujet qui les observe sans qu’on ne vienne m’embêter avec des conceptions métaphysique ! » Celui qui croit ça manque pourtant le mécanisme fondamental qui engage, de façon immédiate, toute objectivation du monde sensible dans le processus métaphysique : nous l’avons dit, aucune connaissance objective de l’objet (vraie et valable en tout temps, en tous lieux et pour tous sujets) ne peut émerger de l’appréhension sensible du monde. Le sujet doit appréhender le monde de façon non-sensible pour connaître objectivement l’Être objectal. Il doit donc nécessairement l’appréhender métaphysiquement. Nous allons voir à présent que le discours NRx n’échappe pas à cette loi d’airain.
Il nous faut donc chercher dans l’ouvrage de NIMH les prémisses qui permettraient d’abord d’affirmer qu’il conçoit bien le monde comme un monde objectal indépendant du sujet. L’auteur nous dit, au début de l’ouvrage : « La réalité existe de manière objective, et nous ne pouvons jamais que tenter de l’appréhender par la médiatisation de nos représentations qui seront plus ou moins efficaces, plus ou moins vraies. La connaissance est subjective, la réalité est objective et la vérité est à la frontière entre notre subjectivité et la réalité objective. La réalité existe indépendamment de nous, mais la vérité est intimement liée à notre cadre épistémologique ». Il ajoute également « Ce que nous nommons vérité est en fait le degré d’adéquation de notre cadre conceptuel nous permettant d’appréhender la réalité ». Quel dispositif NIMH est-il donc en train de fabriquer ici ? Il nous dit que la réalité existe de manière objective, et surtout indépendamment des sujets. Cette réalité, on le comprend, c’est le monde dans son objectalité, tel qu’il est posé-là réellement en soi. Reste la question de savoir si le sujet peut accéder à cette réalité. Sans surprise, il ne peut pas, ou il ne peut y accéder que partiellement, jamais de façon pleinement satisfaisante. La « vérité » devient ce que le sujet subjectivise de l’objet. Il faut évidemment que cette « vérité » puisse être évaluée, graduée, hiérarchisée, sinon le relativisme risquerait de l’emporter et toute subjectivité vaudrait une « vérité » par soi. Ainsi, pour l’auteur, la « vérité » n’est pas seulement ce que le sujet perçoit subjectivement de l’objet, mais c’est plus que ça, sa capacité à se conformer à l’objectalité pour construire une connaissance objective, c’est le degré d’adéquation d’une proposition subjective avec la réalité objectale qu’elle vise. Le dispositif métaphysique commence tranquillement à s’installer.
NIMH refait éclater la dualité sujet-monde, passant outre tous les efforts des modernes depuis plusieurs siècles pour unifier la relation sujet-monde dans l’unité de l’être-au-monde comme existant. Il se trouve alors aussitôt aspiré dans le vortex métaphysique : la petite « vérité » du sujet qui n’est jamais pleinement en adéquation avec l’objectalité du monde laisse perplexe. On voit qu’il la tolère, dans une certaine mesure, conscient qu’on ne peut pas simplement réclamer du sujet qu’il produise hic et nunc une Vérité absolue. Mais tout de même, cette Vérité absolue hante la petite « vérité » du sujet semi-adéquat : si la « vérité » avec un petit « v » est une proposition subjective qu’on tient pour suffisamment alignée avec la réalité objectale, on ne peut s’empêcher de penser qu’il existe, au moins théoriquement, une Vérité avec un grand « V » qui correspondrait à l’état d’adéquation parfaite entre la proposition subjective du sujet et la réalité objectale qu’elle vise. Le but du jeu serait donc, a minima, de tendre à cette Vérité absolue, même si on peut l’admettre comme fondamentalement inaccessible.
Le dispositif que propose NIMH rappelle bien le dispositif kantien : d’un côté le monde idéel, pur, l’Être en soi, c’est-à-dire le monde nouménal, qui nous est fondamentalement inaccessible. De l’autre côté un monde tel que connu ou tel que vécu par le sujet, un monde phénoménal, qui lui apparaît de façon imprécise ou inadéquate. Mais NIMH ajoute à ce kantisme une sorte d’heideggerisme étonnant. Nous l’avons vu, il existe un certain processus de sélection qui permet aux hommes de tendre vers une connaissance toujours plus précise de l’entropie, et donc de diminuer l’incertitude, parce qu’une société capable de mieux dissiper l’énergie passe le filtre sélectif et donc ses catégories deviennent des catégories « dévoilant » un peu plus l’être nouménal, la loi fondamentale, à chaque étape du processus sélectif. Chaque fois qu’une structure ou qu’un système s’impose au cours du processus sélectif, c’est bien qu’il dissipe plus d’énergie, et donc que ses catégories nous délivrent un enseignement augmentant notre maîtrise et notre compréhension de la loi universelle. Le rôle de l’homme est d’essayer, en dépit de quelque certitude sur ce qu’il doit faire pour se conformer à l’être objectif du monde. Essayer et passer devant le couperet de la loi fondamentale de l’entropie. Essayer, et tirer de ses échecs ou de ses réussites des enseignements sur le monde objectal. Essayer, et observer ce qui fonctionne, ce qui permet de traverser le filtre sélectif, améliorant notre connaissance de la loi fondamentale. L’homme et son évolution tendraient ainsi à « dévoiler » l’Être, faisant écho à l’aletheia7 heideggerienne, et NIMH croit ainsi travailler de concert avec le déconstructeur de toutes métaphysiques.
L’auteur présente l’homme et ses activités comme autant d’étapes du dévoilement de l’Être fondamental. Il est celui qui essaye, qui échoue, apprend, réussi et réessaye. À travers sa conscience, qui agit ici comme une caisse de résonance permettant la rétrospection de l’Être fondamental sur lui-même, l’homme parvient petit à petit à dégager de l’information sur la loi de l’entropie qui règle et défini cet Être fondamental. Il dit à propos de l’évolution des espèces, et cela vaut aussi pour l’évolution des sociétés : « Imaginez-la comme une série d’expériences menées par la nature elle-même, testant différentes formes de vie pour voir lesquelles réussissent le mieux. C’est comme si la nature était un scientifique, apprenant de ses essais et erreurs pour créer des formes de vie de plus en plus adaptées et efficaces. Elle teste et sélectionne, explore et exploite ». Il ne faudrait pas réinterpréter ce que dit ici l’auteur, en pensant que l’homme fabrique la loi universelle à mesure que ses sociétés se sélectionnent par leur confrontation. L’homme ne fait que « dévoiler » un Être total qui est posé-là, et qui trouvera sa forme terminale lorsque le processus de dévoilement sera hypothétiquement achevé. En ce sens, l’homme est lui-même une partie de cet Être qui prend donc un attribue mystique rappelant un peu le vieil holisme oriental schopenhauerien : « Loin d’être une force centralisée ou un phénomène exclusif à certaines formes de vie, l’intelligence, en tant qu’augmentation de l’extropie, se manifeste à travers la multitude et la diversité de la vie sur Terre. Chaque organisme, des plus simples bactéries aux êtres humains complexes, contribue à ce processus. Ils agissent non pas comme des agents isolés, mais comme des parties intégrantes d’un système global, chacun jouant un rôle unique dans l’augmentation de l’ordre et de l’information dans la biosphère ».
L’homme participe donc d’un tout métaphysique qui prend la forme d’un Être fondamental total, englobant chaque entité, chaque étant qui compose le monde et l’univers. Ce tout, cet Être fondamental, c’est l’Univers pris comme une unité ontologique. L’homme n’est plus qu’une partie, un moment, une composante de ce grand Tout cosmique qu’il participe à « dévoiler » : « L’univers serait un tout, faisant l’acquisition d’information sur lui-même par l’intermédiaire de fragmentations décentralisées. Ces entités fragmentaires de l’univers auraient alors un point de vue parcellaire sur ce dernier. Elles n’auraient pas accès à la réalité entière, et il existerait alors une différence entre leur expérience subjective du monde et la réalité. Cette dernière ne se livrerait pas à nous telle qu’elle est en soi. »
La métaphysique néo-réactionnaire est une métaphysique paradoxalement kantienne dans sa structure (dichotomie noumène-phénomène) et holiste dans son caractère (tout étant participe du grand Tout cosmique8). L’homme, pris au milieu d’un monde dont les règles ne dépendent pas de lui, participe au dévoilement de ces règles à mesure que ses systèmes, ses paradigmes, ses organisations et ses structures passent des examens sélectifs. Ces séries d’examens, c’est le mouvement de l’histoire, la guerre, les batailles, les conflits commerciaux, les révolutions, etc. Chaque étape historique est l’occasion de « tester » un dispositif normatif, qui sera évalué dans la confrontation avec un autre dispositif par la loi de l’entropie. Le cas d’école de ce mouvement pourrait être la guerre froide (ou mieux encore, la comparaison des évolutions respectives des sociétés nord et sud coréennes) : le capitalisme triomphe du communisme, donc il dissipe mieux l’énergie, donc il est plus en adéquation avec la loi de l’entropie, il est plus « vrai », il est une vérité plus haute que ne l’est le communisme. Le triomphe capitaliste nous éclairerait donc sur ce qu’arbitre l’Univers en matière socio-économique : le grand Tout cosmique semblerait « préférer » le capitalisme au communisme, car celui-ci s’accorderait mieux que celui-là avec ses règles fondamentales. Le néo-réactionnaire est donc capitaliste. Du moins il préfère le capitalisme au communisme mais n’exclue pas qu’un système tiers, pas encore expérimenté, puisse dépasser le capitalisme – mais en attendant ce système tiers, il est bien capitaliste. N’allez pas croire qu’il est capitaliste parce qu’il aurait quelque intérêt politique à l’être, au regard de la façon dont il vit les rapports sociaux ! S’il est capitaliste, cela n’a rien à voir avec lui, ni avec son identité de sujet occidental du vingt-et-unième siècle, ni avec la place qu’il occupe dans les rapports sociaux. Cela lui est simplement prescrit, en tant que sujet neutre et abstrait, par la Vérité révélée issue des lois fondamentales de l’Univers…
D’ailleurs, le grand Tout cosmique ne permet pas simplement d’arbitrer en faveur d’un système socio-économique. Le néo-réactionnaire en tire tout une série de principes sociaux et politiques. En fait il en tire des lois et une orthopraxie qui lui sont descendus de l’Univers un peu comme le Coran est descendu sur Mahomet : « Carlyle9 sait que l’univers a sa propre loi. Son œuvre pourrait en fait se résumer à ces quelques lignes : L’univers a une loi, quelles que soient nos paroles, nos actions ne pourront s’en émanciper et le vote démocratique est non seulement une façon défectueuse de la découvrir, mais en plus, il ne pourra instituer des lois s’y opposant. Les lois découlent donc pour lui de la Loi de l’univers et de la religion. Comment lui donner tort ? Nous avons vu qu’une société humaine est une structure dissipative, donc un système cybernétique suivant les règles de l’univers. Les lois représentent les conditions d’auto-organisation de la société et il n’y a aucune raison de penser qu’elles puissent s’émanciper des lois de l’univers. Elles peuvent être instituées pour devenir des lois officielles ou non instituées pour faire partie des mœurs, découlant de la morale. Carlyle nous dit qu’il nous faut diriger nos actions vers le Bien et jamais dans l’histoire, nous avons pensé que ceci pouvait passer par le rejet de la vérité » et d’ajouter « En partant de lʼuniversalité de lʼextropie, on peut alors identifier ce qui constitue le Bien de façon absolue et retomber sur des conceptions traditionnelles de la vie sans effectuer de retour en arrière ». Nous naviguons finalement bien dans les eaux troubles du pire platonisme. Voilà le Bien universel, voilà les règles universelles que tout homme doit suivre universellement, car elles sont des vérités valables pour tous. Tâchez de vous oublier un peu, vous individus. Tâchez de vous mettre en retrait, de vous neutraliser et de vous universaliser. Tâchez de subordonner vos actions à ce Bien que le néo-réactionnaire à pris soin de définir pour vous, car c’est lui votre nouveau pasteur.
NIMH ne doit pas être satisfait de cette présentation. Je l’entend d’ici : « Mais non ! me dit il, l’homme est libre de ses actions, car il doit justement tester, ouvrir des chemins, pour dévoiler la Vérité ! » Il y a là, en fait, un véritable paradoxe philosophique. Dans le système NRx, l’homme est certes celui qui essaie, nous l’avons dit. C’est même justement lui qui « «dévoile » les principes qui gouvernent l’univers à mesure qu’il essaie. L’enfermer dans une « vérité révélée » qu’il devrait suivre pour l’éternité semble venir contredire ce rôle de l’homme comme testeur de la vérité. Mais, dans le même temps, le discours néo-réactionnaire porte bien un programme, un projet, qui ne se limite pas seulement à donner les meilleures conditions à l’homme pour faire ses essaies et dévoiler la Vérité (car c’est simplement l’absence de structure qui permettrait cet état de liberté radicale), mais qui consiste aussi à lui donner une ligne de conduite, des normes, des principes, une morale tirés des enseignements et des vérités qu’il aurait déjà acquis sur l’Univers. Il faut qu’il soit libre d’essayer, mais tout de même pas trop : « Une société a besoin de malléabilité pour permettre la croissance, car un ordre trop strict conduirait à sa nécrose, mais trop de malléabilité conduira nécessairement au chaos. » Loin de laisser l’homme libre de goûter à ce chaos, le néo-réactionnaire entend bien le limiter en s’appuyant sur les vérités révélées qu’il dit déjà posséder entre ses mains. Il propose en ce sens un programme politique clair : abolition de la démocratie, instauration d’une autorité monarchique souveraines, créations d’une diversités de petits États concurrents, défense du libre marché, etc. Et tout ce programme, il prétend bien l’avoir tiré de ses vérités révélées universelles.
Nous nous trouvons en face d’une véritable tension, pour ne pas dire une contradiction dans la métaphysique NRx. Si l’homme est vraiment pleinement libre de tester, d’essayer, alors il faut encourager le fait qu’il reste toujours à distance des enseignements qu’il acquerrait. Mais dans ce cas, l’ensemble de ce système métaphysique devient une aporie inutile : il existerait une loi fondamentale de l’univers qui gouverne tout, mais l’homme devrait se tenir à son égard dans un état de parfaite indifférence, de sorte que son action ne se trouve jamais déterminée a priori par la connaissance de celle-ci ? Évidemment, ce n’est pas là le but que se donnent les néo-réactionnaires, et NIMH n’a pas écrit tout un ouvrage pour nous dire d’agir comme si on ne l’avait pas lu. À un certain degré, le rôle de l’homme comme testeur de la vérité doit être limité, et même aboli. Dans la tension entre ce rôle de l’homme et les vérités révélées issues des lois de la nature, le néo réactionnaire privilégie toujours ces dernières. Il dit bien : Les lois représentent les conditions d’auto-organisation de la société et il n’y a aucune raison de penser qu’elles puissent s’émanciper des lois de l’univers. Tout semble donc indiquer que la liberté créative de l’homme ne reste que très secondaire dans le dispositif métaphysique néo-réactionnaire. Celui-ci sert bien d’abord à dénoncer les tentatives contrevenant aux prétendues « lois de la nature », et finalement, malgré ce que dit cette doctrine, l’homme n’est libre d’essayer que les choses qui ont déjà marché. Je sais que NIMH peut personnellement regretter cette tendance, mais son discours produit, paradoxalement à ses dépends, un type d’homme opiniâtrement conservateur, qui attend de recevoir clef-en-main une vérité révélée, et verra toujours comme « contre-nature » tout ce qui n’est pas déjà passé par ce qu’il tient pour le filtre de la « sélection ».
Cette suspension de la liberté créative de l’homme transpire à travers tout le discours NRx : respect d’une morale de bien-commun, rejet des libertés civiques comme vecteur de désordre, affirmation d’une forme de traditionalisme, etc. En ce sens, la néo-réaction est absolument anti-moderne, et même anti-moderniste. Elle n’a en fait de « néo » que son cursus narratif, qui part de la thermodynamique au lieu de partir d’une lecture puritaine de l’Évangile – encore que. Si l’on prend ce cursus narratif pour ce qu’il est, c’est-à-dire une métaphysique, alors le néo-réactionnaire n’est qu’un réactionnaire parmi tant d’autres. Ce que le (néo) réactionnaire défend, c’est un monde régulé par le moralisme universaliste : « De la même façon qu’un système de croyances ne doit pas avoir un écart trop important avec ce qui est vrai, son système moral ne peut pas dévier complètement de ce qui est vrai afin de définir ce qui est bon. Alors qu’est-ce qui est bon ? […] Ce qui est moralement bon découle naturellement de ce qui est vrai. D’où l’importance d’avoir la meilleure interface sur le monde possible, car elle va impacter notre système de croyances mémétiques et notre moral. » Il y a un « vrai », qui est l’adéquation de l’homme aux lois de la nature. Ce « vrai » engendre un « bon », qui donne l’évaluation morale que l’homme doit faire de sa comportementalité en conformité avec le « vrai ». Ce « bon » engendre à son tour un « Bien » qui est l’ordre social et politique se conformant au « bon ». Nous connaissons déjà tout le mal que ce type de discours à fait à l’Occident, en affirmant le Bien suprême comme un bien universel, au lieu de favoriser les biens locaux qui valent pour un type d’individu spécifique selon ses spécificités. La néo-réaction s’est donnée beaucoup de peine pour ne rien dire de plus que ce que n’avait déjà dit Platon. Nous n’aurons donc rien à dire de plus que ce que n’avait déjà dit Heidegger contre la métaphysique.
L’usurpation d’Heidegger
NIMH propose une pensée ambitieuse – trop ambitieuse peut-être : il prétend réconcilier ce que nous avons ici dégagé comme la Métaphysique d’un coté, et la Modernité de l’autre. Il cherche à conjuguer la possibilité d’un retour à l’objectalité métaphysique et à la conception de la Vérité comme vérité-vraie-objective, avec une sorte de perspectivisme moderne. Pour ce faire, il tente de s’appuyer sur des données de nature scientifique, qui sembleraient faire signe vers des règles objectives universelles lesquelles permettraient de réinterpréter la notion d’« évaluation » de la philosophie nietzschéenne : la puissance deviendrait une détermination objective qui permettrait d’évaluer le monde de façon également objective. NIMH conserve de Nietzsche le rôle de l’homme comme évaluateur du monde (c’est lui qui perçoit et comprend, voire défini, l’ordre et le désordre), mais entend fonder les modalités de son évaluation – sa puissance – dans un donné objectif qui se conformerait aux catégories des lois physiques. Dans ce nouveau dispositif, la connaissance objective passe par l’aletheia. Toute cette métaphysique néo-réactionnaire est traversée par cette tension entre le sujet « dévoilant » le monde, et l’opération rétroactive de détermination objective des phénomènes par les lois universelles qui le structurent objectivement.
« Nous allons tenter de réconcilier une nouvelle fois Athènes et Jérusalem comme Thomas d’Aquin avait pu le faire en son temps, ou plutôt, nous allons tenter de réconcilier la Modernité avec les conceptions prémodernes de la vie […] Nous allons démontrer qu’il est possible de réhabiliter les catégories de cause finale, unité et être et que l’être est intimement lié à la vérité. Une fois cet absolu que représente l’Être affirmé, nous pourrons réévaluer la pertinence des concepts de Bien et de Mal et finalement nous pencher de nouveau sur la question de Dieu et voir si Nietzsche ne l’aurait pas enterré vivant. Comment allons-nous procéder ? En nous offrant un nouveau cadre de pensée accélérationniste. »
NIMH tente donc d’harmoniser ou d’accorder Heidegger et Nietzsche avec une structure narrative métaphysique. Il s’agit de les rendre les moins corrosifs possible, afin que le Dasein puisse redevenir un « sujet » métaphysique, retombant dans l’oublie de l’Être mais cherchant à se le rappeler par le dévoilement ou l’enseignement qu’il retient de ses essais dans le monde. L’auteur est en effet conscient qu’on ne peut pas asseoir une politique de la différence sur des vérités révélées de nature universelle. Mais il va quand même essayer de conjuguer les deux, en affirmant qu’en tant qu’observateur-participant, l’homme dévoile certes une vérité universelle, mais il la dévoile depuis un point de vue toujours singulier. L’Univers étant un grand Tout cosmique qui se subdivise pour acquérir de l’information sur lui-même, chaque point de vue local vient enrichir cette compréhension globale de l’Être fondamental. Dans ce dispositif, l’homme a pour mission de dégager « l’information manquante », la loi de l’entropie. Si l’entropie augmente dans l’univers, cela tiendrait presque finalement à un jeu de perception selon lequel, en fait, l’Univers est « subjectivement » de plus en plus conscient de son entropie à mesure que le sujet humain la dévoile.
« La vie pourrait alors bien servir une forme d’unité informationnelle et un but. Si l’idée d’entropie ne peut pas être dissociée de l’observateur participant, et si l’intelligence permet de mieux identifier l’information manquante, alors l’entropie de l’univers augmenterait pour la simple et bonne raison que l’univers engendre des entités de plus en plus intelligentes, qui identifient de mieux en mieux l’information manquante […]. On ne peut alors pas faire l’économie de nous pencher sur la métaphysique et plus particulièrement, la question ontologique, l’être. L’information étant intimement liée à la vérité, l’univers dévoilerait-il la vérité comme l’imagine Heidegger ? »
Nous nous retrouvons avec Heidegger, perdus au milieu de ces formules métaphysiques, sans savoir ce qu’il vient faire là. NIMH à choisi d’utiliser le mot « dévoilement » pour rendre raison du processus d’accès à l’information objective. Nous estimons que ce mot est ici largement usurpé, et ne rend pas raison de ce qu’il vise dans le vocabulaire heideggerien. Heidegger reproche à la métaphysique de produire un oubli de l’Être (parfois laissé en allemand Seinsvergessenheit). Cet oubli causé par la métaphysique vient du fait qu’elle pose la question de l’étant, le posé-là, au lieu de se demander ce qui permet à ce posé-là de surgir comme tel. L’oubli de l’Être vient de la façon dont la métaphysique dualise la relation sujet-monde en affirmant l’objectalité des phénomènes mondains, au lieu de partir d’un existant pour penser sa constitution dans son être-au-monde. Pour NIMH, cette question se résout dans la métaphysique NRx car le sujet doit « dévoiler » l’Être au cours de son existence par la connaissance qu’il acquiert sur les lois structurant l’étant.
Cependant, ce que décrit l’auteur n’est rien de plus qu’un processus cognitif. Chez Socrate, il existait déjà un tel processus par lequel l’« Être » (métaphysique) se « dévoile » au sujet : la maïeutique (ou « l’accouchement »). La maïeutique n’a rien à voir avec l’aletheia. La différence entre ces deux « méthodes » tient justement à la séparation ou à la distance ontologique que pose la métaphysique entre le sujet et l’Être. Chez Heidegger le dévoilement n’est pas un processus cognitif par lequel l’homme tend à connaître une vérité objective. C’est un évènement ontologique caractérisant l’unité du monde et de mon être au sein de mon être-au-monde. L’aletheia, contrairement à la maïeutique, ne vise pas du tout une quête de savoir, encore moins une quête d’information dans le but de dé-couvrir des vérités encore couvertes. C’est au contraire un mode qui prend en compte l’irréductible dé-couvrement du monde car le Dasein est-au-monde, le Dasein est toujours déjà de l’Être. Si Heidegger parle de dévoilement, ce n’est en rien quelque chose comme un processus qui supputerait un voilement originel, une distance ontologique entre le sujet et l’Être. Au contraire, le dévoilement est le mode ontologique du Dasein. Le monde est toujours le déjà dévoilé de l’Être. Heidegger nous dit bien : « Le Dasein en tant que constitué par l’ouvertude (Ershclossenheit) est essentiellement dans la vérité. L’ouvertude est un genre d’être essentiel du Dasein »10.
Il ne faut donc pas confondre la maïeutique, qui désigne le processus par lequel le sujet métaphysique augmente peu à peu sa compréhension de l’Être dont il est fondamentalement distant, et l’aletheia qui pose une ontologie du dévoilé, c’est-à-dire exactement le contraire de la maïeutique. NIMH fait plutôt la présentation d’une nouvelle maïeutique, s’adjoignant d’un mouvement holiste où « l’Univers acquiert de l’information sur lui-même ». Il est parfaitement en droit d’appeler cette maïeutique un « dévoilement ». Mais il semble que cette appellation devient trompeuse dès lors qu’elle prétend réintégrer le Dasein dans un système métaphysique. Cette confusion propre au discours métaphysique néo-réactionnaire découle d’une mécompréhension de l’Être. Les néo-réactionnaires le conçoivent dans une acception métaphysique traditionnelle, rejetant la Destruktion heideggerienne. Or, comme nous l’avons vu, l’Être chez Heidegger n’est pas un quoi, mais un comment : l’événement par lequel le Dasein ouvre le monde à la manifestation. Ce monde n’est jamais l’ensemble objectal du posé-là, mais un horizon de sens constitué par le Dasein. Il n’existe donc pas, chez Heidegger, d’Être fondamental préexistant, extérieur au Dasein, auquel il s’agirait de donner sens. La néo-réaction semble admettre que l’homme donne sens à un tel Être fondamental, mais elle échoue à saisir que la notion même d’Être en tant que substance s’efface dans la pensée heideggerienne.
Nous pourrions diminuer le niveau d’abstraction de notre propos, pour mieux saisir la différence qui sépare ces deux approches. Prenons un objet du quotidien, comme le livre de NIMH. Celui-ci, pour Heidegger, est au sens d’étant parce que je suis moi-même, qui le tient dans mes mains, en train d’être-au-monde. Ce livre n’est pas indépendant de moi comme un posé-là, un objet physique défini par ses propriétés objectives – papier, encre, poids –, mais un étant qui obtient signifiance à travers le contexte de mon existence : il prend sens comme outil de lecture, comme source de réflexion ou comme présence dans mon environnement familier. Chez Heidegger, l’Être de cet étant ne réside pas dans une essence abstraite ou un quoi indépendant de moi, mais dans le comment de son surgissement au sein de l’ouverture que constitue le Dasein, mon être-au-monde. À l’inverse, une perspective métaphysique, comme celle que propose jusqu’ici l’auteur, verrait dans ce livre un objet soumis à des lois ou à des coordonnées fondamentales préexistantes, un Être fondamental que je viendrais seulement reconnaître ou interpréter, sans que mon existence ne le co constitue. Chez NIMH, le livre est un posé-là dont les catégories objectives constituent une réalité qui m’est étrangère, et on attend de moi que je me conforme à celles-ci – plus j’y serai conformé, plus je « dévoilerai » de l’Être fondamental.
« L’Être désigne alors une réalité fondamentale, universelle, ou transcendante, en contraste avec les étants individuels, qui sont les manifestations multiples et diverses de cette réalité dans le monde sensible. Cette distinction reflète une hiérarchie ontologique entre le fondamental et le contingent, l’universel et le particulier. En connectant cette idée avec la théorie de l’information, nous obtenons une vision du monde où l’information est la substance à partir de laquelle la réalité phénoménale se déploie. L’être de l’étant devient alors pour nous la partie informationnelle liée à un étant matériel. »
Nous arrivons à ce point où se joue le drame d’une usurpation d’Heidegger qui aura une conséquence sinistre. L’être de l’étant devient alors pour nous la partie informationnelle liée à un étant matériel, dit NIMH. Il occulte brutalement le fait que l’être de l’étant, c’est moi. Il réduit l’être de l’étant à une information d’ordre fondamental que j’acquerrais au cours d’un processus cognitif. Il occulte cet enseignement d’Heidegger selon lequel l’étant n’est pas un posé-là, mais qu’il est parce que je le constitue comme sens à travers mon être-au-monde.
Le dispositif métaphysique de NIMH prend en compte le « point de vue » du sujet – mais dans un sens très restreint : il s’agit non pas d’un réseau de signifiance propre à un moi qui donne sens à son monde, mais seulement d’un degré d’adéquation de la connaissance subjective avec l’objet qu’elle vise. Le « point de vue » devient non pas la perspective qui pro-jette l’homme dans son monde, et qui admet donc que l’homme est ce à travers quoi un monde est signifié, mais il se réduit au fait de ne pas connaître objectivement le monde en soi. Autrement dit le « point de vue » devient chez lui une limite épistémologique, en tant que ce que je connais de la réalité, au lieu d’être un caractère ontologique, en tant que cette réalité que je signifie. NIMH nous dit que le sujet est un « observateur-participant », mais à quoi participe-t-il finalement ? Il participe à un processus maïeutique universel et cosmique qui l’englobe. Il n’est pas là comme une source de signifiance singulière à travers laquelle un monde local prend son sens, mais il est là comme un observateur abstrait qui « dévoile » petit à petit l’Être fondamental qui lui est inaccessible car ontologiquement distant. Cet Être se donne alors comme une substance universelle à laquelle tous les hommes participent. À l’intérieur de ce dispositif, l’étude de la façon dont l’homme rend une signifiance propre à son monde perd tout son sens – cela serait une négation la « vérité » en tant que connaissance objective de l’Être fondamental. En conséquence, la connaissance doit s’orienter non plus vers le différencié concret, comme l’avait obtenu la révolution moderniste, mais vers l’universel abstrait. C’est là la conséquence sinistre de sa philosophie, qui nous interdit d’entrer en questionnement sur le fait que le moi vit toujours un monde qui lui est propre. NIMH a liquidé Heidegger. Il a ainsi liquidé la possibilité de s’intéresser à l’irréductibilité des mondes entre eux tels qu’ils sont des mondes-vécus. Il a liquidé chez l’homme son rôle de significateur d’un monde qui lui est propre, le transformant en significateur du monde qui lui est indépendant. Il a liquidé l’identité comme mode ontologique d’une signifiance différenciée.
L’usurpation de l’identitarisme
Voilà enfin formulée notre critique. NIMH se livre à une reconstruction de la métaphysique qui a pour conséquence une liquidation des assises théoriques sur lesquelles se fondent la doctrine identitaire. Évacuons tout de suite les inclinaisons conciliatrices qui diraient : « ne peut-on pas admettre tout ce que dit NIMH tout en maintenant une approche perspectiviste ? » Non, on ne peut pas, et la doctrine que présente l’auteur est le témoin de cet inconciliable conflit. N’a-t-il pas justement essayé de réconcilier Heidegger avec la métaphysique ? Et pour quel résultat ? Une usurpation du vocabulaire heideggerien au service d’une métaphysique bien platonicienne qui ne peut mécaniquement pas fonctionner avec une compréhension de l’Être comme celle que propose Heidegger.
Voilà le dispositif de NIMH : nous sommes universellement déterminés par des lois naturelles. Ces lois naturelles doivent être répliquées dans les lois humaines et les organisations sociales que nous construisons. Nous devons donc partir de l’universel pour penser nos structures sociales et politiques, au lieu de partir du singulier différencié et du monde spécifique qu’il projette. Le risque est donc grand. NIMH a aboli la radicalité théorique du perspectivisme ontologique sur lequel se constitue l’identitarisme. Dès lors que nous vivons tous le même monde, et que nous sommes tous soumis à ses lois universelles, et ceci de telle sorte que ces lois soient aussi des lois politiques, alors il n’y a plus aucune raison de ne pas défendre un universalisme pan-anthropique.
Cependant l’auteur reste fondamentalement de droite. Il ne veut pas admettre que les lois soient universelles pour tous, et ce malgré qu’il ait lui-même soutenu une telle proposition. Dans son discours, il doit donc chercher à réintégrer la fracture différentielle qui justifiera que les occidentaux préservent leurs nations et évoluent dans des sociétés homogènes. Pour ce faire, il va chercher à dégager un différentialisme dans les lois physiques qui fondent son universalisme.
« Le corollaire de ce constat, cʼest que ces principes communs au vivant que sont la thermodynamique et lʼévolution sont aussi les phénomènes qui génèrent les identités particulières. On observe aujourdʼhui des groupes humains communément appelés populations que lʼon peut différencier aisément dʼun point de vue génétique, car elles sont le fruit de cette sélection. Ajoutez à cela le principe de cet entremêlement entre lʼaction de lʼHomme et la génétique, qui vont mutuellement se renforcer, et vous obtenez des groupes ethnoculturels disposant dʼune génétique particulière et dʼune culture particulière qui ont coévolué. En dʼautres termes, leur identité. Aussi, si la vision du monde accélérationniste est bien universaliste, elle est dans le même temps nécessairement identitaire […]. Cet universalisme est alors conscient des différences génétiques et culturelles entre les individus et les groupes dʼindividus puisque ces derniers sont des conséquences mêmes de ce principe évolutionnaire et ne sont que la spéciation en devenir. »
Entre les diverses populations humaines il existe des différences bio-génétiques. Il existe aussi des variations culturelles locales, des coutumes, des traditions, des plats nationaux, des tenues typiques, etc. Mis ensembles ces éléments constituent des différences ethnoculturelles entre les différents groupes humains. Il reste toujours que ces différentes populations vivent le même monde dans le système NRx. Elles voient la même chose, vivent la même réalité, sont prises dans le même Être fondamental et subissent les mêmes lois universelles. Sur le plan ontologique (qui est le seul qui compte vraiment) l’auteur nie que chacun vive une réalité différente de celle de son « voisin ». La réalité est objective et indépendante du sujet, disait-il, avant d’ajouter que la vérité est le degré d’adéquation du sujet à cette réalité objective, et qu’enfin cette vérité dicte des lois universelles qui président aussi aux lois humaines. À ce titre, les différentes populations sont bien différenciées par leur caractères ethnoculturels, mais ne sont pas différenciées par leurs intérêts politiques. Au contraire, l’intérêt politique de tout individu étant devenu la conformité aux lois universelles, alors nous avons tous bien un même intérêt unique : celui de nous conformer à ces lois. Le Bien d’un européen occidental du vingt-et-unième siècle serait le même que celui d’un malgache ou d’un russe, qui serait en substance le même que celui de Jules César ou de Moctezuma II : tendre à la connaissance de l’Être fondamental. La vision des néo-réactionnaires n’est donc pas identitaire. Certes ils admettent que les différences ethnoculturelles existent, mais qui ne l’admet pas ? Personne n’est « color-blind » au point de nier qu’un homme subsaharien soit différent ethniquement et culturellement d’une femme thaïlandaise, ou d’un homme japonais etc. En revanche le néo-réactionnaire estime que le Bien est identique chez chacun de ces différents sujets, qu’ils aspirent donc à la même chose. Il n’y aurait pas, dans la réalité, de facteurs déterminants des intérêts politiques différents aux différents groupent qui composent les sociétés humaines.
À la rigueur, le néo-réactionnaire pourrait considérer qu’une société ethniquement et culturellement homogène est définie comme meilleure par les lois universelles de la nature, et qu’il faudrait donc s’en tenir à cette vérité révélée. On relèverait dans ce cas cette contradiction dans l’abolition du rôle de l’homme comme testeur de possibilité, ainsi que nous le formulions plus haut. Mais tout de même, poursuivons cette hypothèse : il faut une société homogène, car elle est comme ça plus en adéquation avec l’Être fondamental. Pourquoi cette société homogène ne pourrait-elle pas être à cent pourcent de souche subsaharienne, ou extrême-orientale, etc. ? Pourquoi l’Europe devrait-elle être peuplée d’individus de souche ethnique et culturelle spécifiquement européenne ? Dans la froide machination de la doctrine néo-réactionnaire, qui se veut bien entendue neutre et objective, il n’est pas question de défendre l’un des intérêts particuliers de tel groupe plutôt que de tel autre pour des raisons qui seraient purement relatives au sujet qui la porte ! D’ailleurs, nous connaissons tous bien cette « Sainte-Carte » qui pose le quotient intellectuel moyen des asiatiques d’extrême orient comme supérieur à celui de tous les autres. Si l’intelligence que cette donnée mesure est vraiment ce qui doit transporter l’homme vers le souverain Bien et la connaissance de l’Être fondamental, ne devrions-nous pas souhaiter que la société soit certes homogène, mais d’une homogénéité chinoise ou coréenne ?
Qu’on la tourne dans un sens ou dans un autre, en vérité, cette doctrine ne permet pas de structurer quelque identitarisme que ce soit. La raison en est simple : au lieu de partir de l’identité comme d’une expérience d’un monde socio-politique vécu, pour penser cette identité dans les spécificités politiques et les signifiances singulières qu’elle affecte aux sujets qui la partagent, elle part de l’universel abstrait et défini un « Bien » auquel le sujet politique devrait subsumer ses singularité. L’intérêt politique de l’individu n’est plus ce par quoi il se singularise, mais ce à quoi il doit se conformer. Cette doctrine sert alors, comme toute doctrine réactionnaire, à maquiller les différences socio-politique qui traversent le monde social : elle est négatrice des identités communautaires, historiques, culturelles, normatives, mais aussi sociales, etc. Elle retrouve cette caractéristique de toute pensée réactionnaire, à savoir la négation anxieuse du conflit socio politique. Elle veut décrire un monde harmonisé où les divergences culturelles, ethniques, sociales, économiques, etc., ne fracturent pas le corps politique. Le néo-réactionnaire, au lieu d’admettre la singularité de sa perspective dans ce monde socio-politique en tension, au lieu de prendre sa part de cette tension et de défendre son intérêt singulier, sans nier la diversité des autres points de vue qui sont alors autant de fractures, préfère oblitérer ces divisions en les recouvrant sous le voile d’une unité transcendantale qui annulerait tout conflit. Il entend par là, sous l’effet de l’angoisse conservatrice et de la pulsion du statu quo, désactiver les revendications politiques singulières des autres, quitte à renoncer à toute faculté de penser ses revendications politiques singulières à lui.
Cet « accélérationnisme » est finalement mal nommé : il entend beaucoup plus figer la société sous l’unité transcendantale du souverain Bien, qu’encourager sa mise en mouvement par l’éclatement des contradictions qui se logent dans les spécificités de chacun de nos mondes vécus lorsqu’ils se confrontent. Pourtant, accepter l’irréductibilité des mondes vécus entre eux, c’est bien sûr reconnaître la singularité (inatteignable pour moi) des intérêts politiques de l’autre, mais c’est aussi la seule condition qui permette de reconnaître la singularité de mes intérêts politiques à moi. Cette co-reconnaissance de la différence identitaire est la condition de l’affirmation de mon identité singulière. Je dois accepter que le monde que je vis et que je veux vaut pour moi, mais ne vaut pas nécessairement pour l’autre. Je dois accepter que ce que j’estime être le Bien, est en fait mon bien, mais n’a rien d’universel, rien d’objectif, rien de transcendantal. Je dois finalement accepter que ma vérité est toujours pour l’autre un mensonge odieux, et inversement. À cette condition seulement je peux affirmer que je suis un sujet identisé, que je suis quelqu’un, un être concret et singulier et non pas un être abstrait et général. À cette condition seulement, donc, je peux affirmer légitimement que ceci est bon ou mauvais pour moi.
Cette capacité d’affirmation de soi comme un singulier concret est aujourd’hui ce qui semble faire défaut à la situation particulière du sujet occidental dans le monde. Bloqué dans une métaphysique dont il n’est jamais vraiment sorti, il se tient toujours dans l’espace paradoxale de cette négation de lui-même, qui lui donne l’impudence de parler en croyant parler pour le monde entier, et la bêtise mortifère de se maquiller, de se masquer et de cacher sa singularité qu’il perçoit toujours comme ontologiquement honteuse. Nous gagnerions tant à ne plus avoir honte d’être des gens concrets et réels qui ont une identité, et à parler depuis notre nom propre et nos vérités locales, relatives. Cessons donc de parler depuis le nom commun de la Vérité universelle. Cessons notre quête de l’objectivité qui efface la perspective singulière de notre identité. Nous devrions témoigner de nos vécus singuliers, plutôt que de chercher à les maquiller encore derrière le voile de quelque « objectivité » métaphysique. L’homme occidental, s’il veut sauver son monde, ne doit se poser que cette unique question : qu’est-ce qu’être moi ?
- Nous nous permettons ce néologisme afin d’exprimer le participe d’une fonction verbale que ne délivrait pas assez précisément le verbe « identifier ». Si ce dernier désigne le sujet tel que compris à partir d’une identité, nous souhaitions plutôt exprimer ici la façon dont le sujet devient un sujet ayant une identité, c’est-à-dire la façon dont son identité le construit, la façon dont il est donc identisé. ↩︎
- Ces déterminants sont divers. Ils ont des sources biologiques, mais aussi ethniques, culturelles, anthropologiques, historiques, sociales, etc. En réalité il est difficile de présenter l’ensemble du système de détermination d’un individu, tant celui-ci est complexe. Ce qui importe d’ailleurs n’est pas l’identité de l’individu en soi, prise de façon abstraite. C’est seulement lorsque le sujet est pris à l’intérieur des rapports sociaux, mis en relation avec d’autres sujets, que l’on peut définir ce qui, dans ses déterminants identitaires, le spécifie plus particulièrement. Être blanc en soi, par exemple, ne signifie pas grand-chose. En revanche, être blanc en société, mettons en France en 2025, est alors porteur d’un sens précis, parce que cette identité devient une catégorie politique : en France, en 2025, la blanchité implique de vivre certaines expériences sociales précises, et assigne donc au sujet des intérêts politiques propres qui en découlent. C’est là, seulement, que cet élément de mon identité trouve son sens politique, c’est-à dire son seul véritable sens. ↩︎
- ngularité comme sujet d’une identité spécifique. Ceci d’ailleurs n’implique pas du tout qu’aucune de ses spécificités ne viennent de la nature, de la physique, mais seulement que c’est au sein de l’espace social qu’il va pouvoir les
3 Nous disons des propositions « d’apparence » plus universelles seulement, et non pas des propositions plus universelles en soi, parce qu’en réalité la production des savoirs et des connaissances, l’étude scientifique, reste en dernière analyse un phénomène social qui reconduit certains cadres anthropologiques, sociaux et culturels précis, si bien qu’une universalité et une neutralité absolue, même en science dure, reste parfois difficile à atteindre. En ce sens, on sait depuis Kuhn l’importance du paradigme du sujet dans la constitution et l’élaboration des vérités scientifiques. ↩︎ - Nous laissons pour l’instant la notion d’être entre guillemets. Nous verrons par ce qui suit que la métaphysique produit justement, par son Gestell, une entorse à la notion d’être qui est à l’origine d’une dégradation considérable de notre capacité à énoncer l’identité comme nous la définissions plus haut. ↩︎
- Ici la Raison n’a pas grand-chose à voir avec la rationalité moderne. Il faut bien l’entendre au sens scolastique : une faculté qui permet à l’Homme de connaître l’Être métaphysique par représentation abstraite. ↩︎
- Toutes les citations de NIMH sont ici issues du Traité Néo-réactionnaire. Nous avons cependant pris le parti de ne jamais joindre la pagination des citations extraites de l’ouvrage. Ce choix nous est en fait imposé par le contexte : nous travaillons sur une version non-éditée du livre, et notre pagination ne correspond donc pas à celle que doit avoir lecteur, qui possède vraisemblablement la version produite par les éditions Hétairie. Les numéros de page desquels nous tirons les citations ne correspondraient donc jamais aux pages du livre édité que le lecteur aurait entre les mains. Afin de ne pas alimenter de confusion, nous préférons ne pas joindre de pagination. ↩︎
- Pour Heidegger, l’aletheia désigne le dévoilement de l’étant, qui se manifeste dans l’ouverture de l’être-au-monde du Dasein, non pas comme un simple mode de connaissance, mais comme l’événement fondamental par lequel l’être se donne à rencontrer. Nous discuterons plus tard de la pertinence de cette référence heideggerienne dans le système que propose l’auteur. ↩︎
- Nous n’avons pas l’espace d’élargir ce point ici, mais il serait intéressant à l’avenir de questionner la façon dont le discours NRx reconduit une forme de narration post-lapsaire, ou cette division entre la dualité phénomène-noumène et l’holisme fondamental rappelle le storytelling de la chute du Jardin d’Eden, la fracture qui empêche l’homme d’accéder à l’Être fondamental, et l’épreuve morale qu’il doit traverser ici bas comme processus historique avant de renouer avec celui-ci. ↩︎
- Thomas Carlyle est un calviniste du XIXe siècle, qui compte parmi les influences du mouvement NRx. ↩︎
- Être et Temps, §44. Nous ne souhaitons pas assommer le lecteur avec une citation trop lourde de ce passage complexe d’Heidegger. Ce qu’il signifie ici, brièvement, c’est que l’être-dévoilé est le mode ontologique que donne le Dasein à son monde. Ainsi il est toujours déjà dans sa vérité. Néanmoins, nous invitons le lecteur, s’il s’en sent l’envie, à lire entièrement le paragraphe 44 de Être et Temps (dans la traduction de François Vezin si possible). En effet, c’est dans ce paragraphe que ce joue toute l’erreur d’interprétation de NIMH qui, pensons-nous, est à l’origine de sa confusion entre maïeutique et aletheia. ↩︎
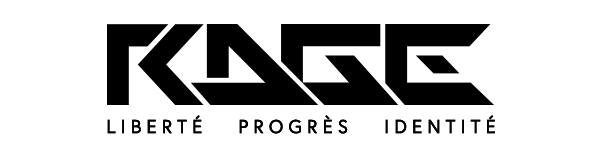







Excellent et bravo. Ma paresse m’a toujours interdit d’élaborer une critique aussi longue que la vôtre, avec laquelle beaucoup se sentiront en raccord.
La néoréaction m’a toujours apparu comme un fatalisme un peu passif – qui voit dans l’accélération son seul moyen d’influencer le monde, qui avancerait de toute manière avec ou sans lui. Le néoréactionnaire feint d’effacer sa volonté propre (ou au minima de l’aligner) au profit du déploiement d’un système plus efficace que lui, mais ne fait au fond que se rassurer que le monde ira mieux *avec ou sans lui*, qu’il n’est qu’un catalyste, pas fondamentalement un créateur par le biais de sa communauté. Peut-être qu’il est fondamentalement effrayé par les relations humaines, a besoin de se rassurer en extériorisant la notion de Vérité hors de son groupe, donc de son identité… La neoreaction serait dès l’origine typiquement masculine, vaguement autiste eheh…
Malheureusement le sens du monde dépend de l’identité de ceux qui l’orientent, et si nous disparaissons, le futur ressemblera à nos ennemis, surtout s’il a la force du collectif et que la nôtre est complètement éclatée.
En tout cas, félicitation pour ce pavé (lol), et bon courage à NIMH s’il veut y répondre.
Je n’ai pas encore fini de lire l’article, mais la première partie est une introduction très claire à Heidegger. Rien que pour cela, il mérite d’être lu.