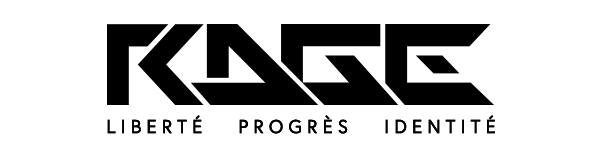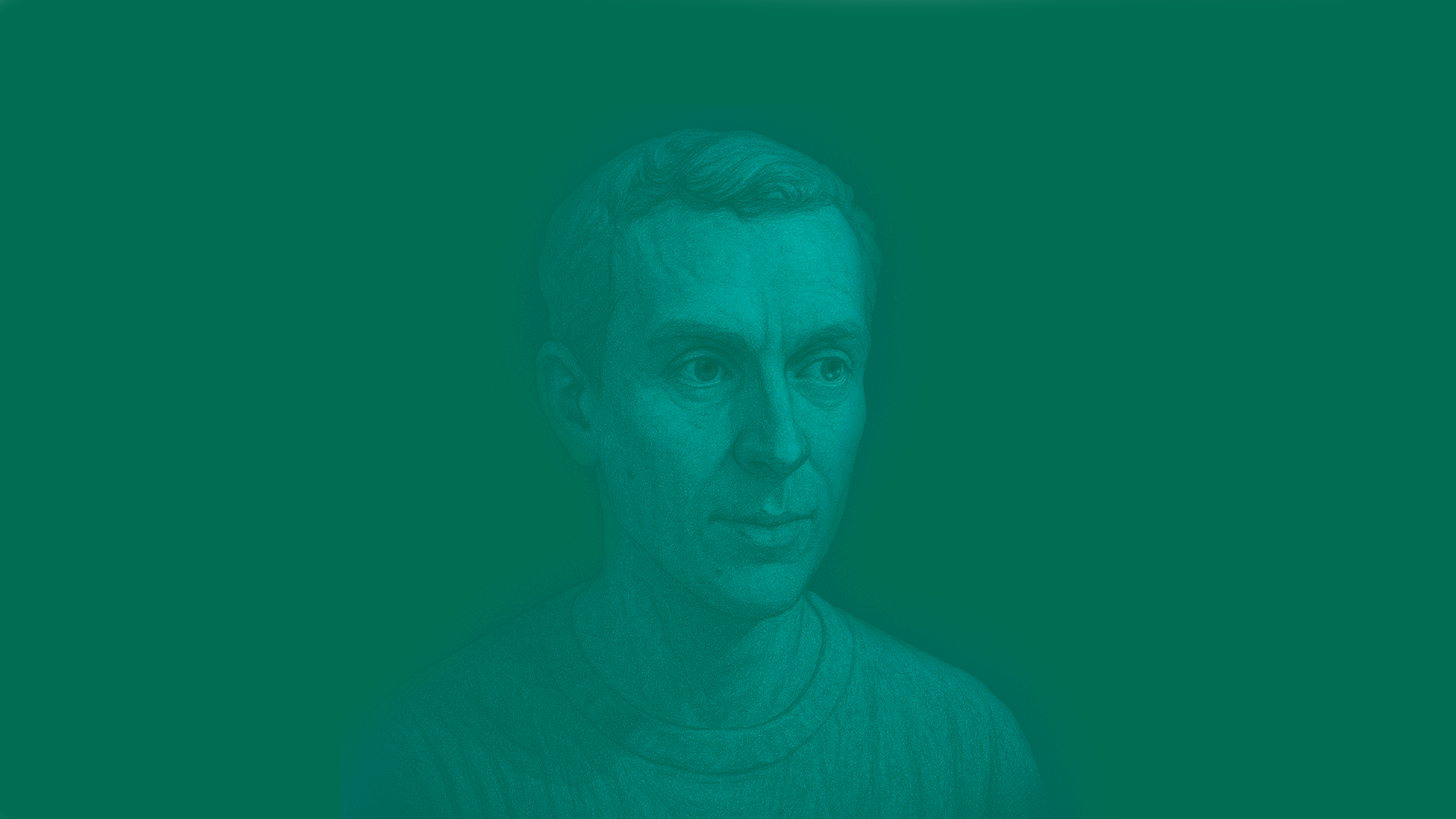Cette série d’articles constitue l’introduction de l’ebook sur la technique regroupant une vingtaine de textes. Elle permet de pouvoir naviguer dans les textes du corpus en comprenant ce qu’ils ont à apporter au sujet traité. Vous pouvez vous procurer l’ouvrage par un tip de la valeur de votre choix.
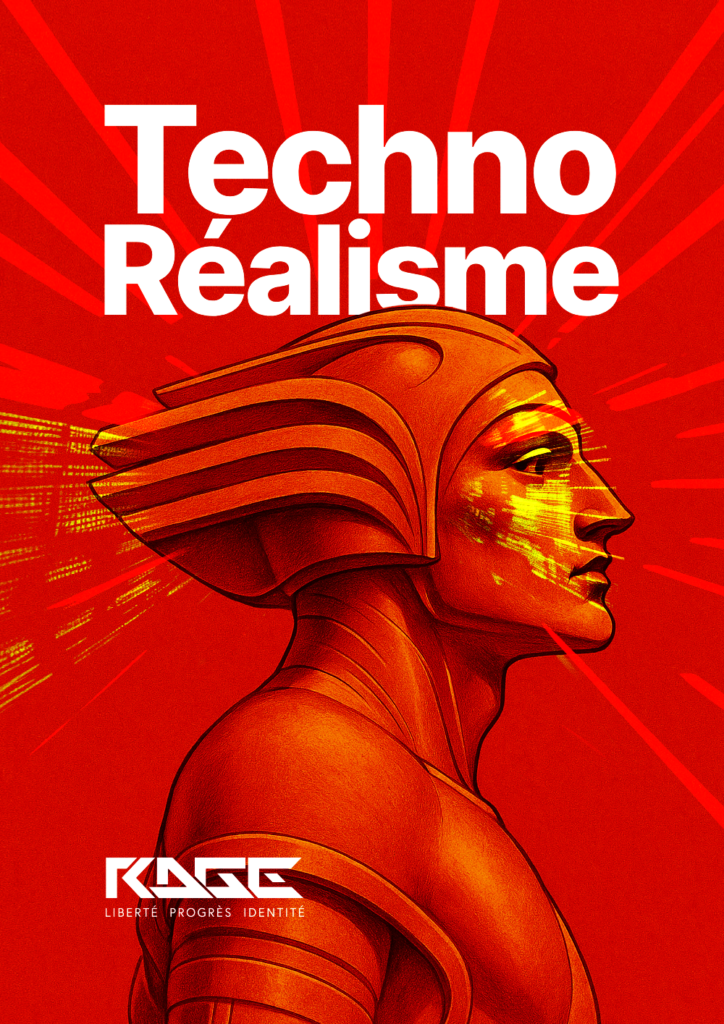
Notre tâche n’est pas de suivre la multiplicité de ces voies ; elles convergent toutes vers un seul point. Il importe plutôt que l’œil s’habitue à une autre image d’ensemble de la technique. On l’a longtemps représentée comme une pyramide posée sur sa pointe et en croissance illimitée, dont les côtés s’élargissaient à l’infini. Nous devons au contraire apprendre à la voir comme une pyramide dont les côtés se rétrécissent continuellement et qui atteindra dans un avenir très proche son sommet. Mais ce sommet encore invisible a déjà déterminé les dimensions du tracé initial. La technique porte en elle les racines et les germes de sa potentialisation ultime.
— Ernst Jünger, Le Travailleur
Dans Le Travailleur, Ernst Jünger nous dit que nous aurions tort de voir la technique comme ouvrante des possibilités infinies alors qu’elles convergent toutes en un seul point. Il est alors facile de faire un parallèle entre les propos de Heidegger sur le Gestell, celui de Jünger dans Le Travailleur et l’œuvre de Nick Land qui note lui aussi que lorsque l’accélération du développement techno-capital est observable et fait alors l’objet d’une conversation, c’est le signe qu’il est déjà trop tard. Ses effets sont déjà perceptibles par le commun des mortels, car son avancement touche déjà à sa fin, la Singularité.
On doit soupçonner que si une conversation publique sur l’accélération commence, elle arrive juste à temps pour être en retard.
— Nick Land, Une brève introduction à l’accélérationnisme
Il semble alors que la technologie revête un caractère faustien, comme l’avait remarqué Oswald Spengler. Elle ressemble à un pacte avec le diable. Elle démultiplie la puissance contre les dangers externes d’une cité, mais elle finirait par essoufler l’âme de ses habitants et les assujettir à un contrôle extrême ou à une passivité. Pire encore, Spengler y voit un phénomène qui ne relève pas de la volonté humaine et dont il ne saurait s’échapper. On peut simplement noter que nous le subissons, mais en aucun arrêter de le subir.
Face à ce destin, il n’y a qu’une seule vision du monde qui soit digne de nous, celle déjà mentionnée d’Achille : mieux une vie courte, pleine d’actes et de gloire, qu’une longue et vide. Le danger est si grand, pour chaque individu, chaque classe, chaque peuple, qu’il est pathétique de se bercer d’illusions. On ne peut arrêter le temps ; il n’existe absolument aucun chemin de retour, aucune sage renonciation possible. Seuls les rêveurs croient à des issues. L’optimisme est lâcheté.
— Oswald Spengler, L’homme et la technique
Évidemment, on pourrait se dire que tout cela n’est qu’une simple exagération philosophique. Après tout, nous ne sommes partis que de l’étymologie du mot technologie pour tirer toutes ces conclusions, n’est-ce pas ? Que nous soyons optimistes ou pessimistes, il nous faut savoir si ce phénomène est avéré ? C’est là que des textes comme La Loi de Hunter Ash ou l’exposé de Beff Jezos, père fondateur de l’e/acc nous est utile dans sa façon de présenter les principes de son mouvement. Le développement technologique semble répondre à une nécessité naturelle. On observe une tendance de l’univers à constamment faire advenir des structures de plus en plus capables à dissiper l’énergie et nous sommes à un stade de développement où seule la technique nous permet de suivre le rythme.
La vie est apparue à partir d’un processus thermodynamique hors équilibre connu sous le nom d’adaptation dissipative (voir les travaux de Jeremy England) : la matière se reconfigure pour extraire de l’énergie et de l’utilité de son environnement, servant ainsi à la préservation et à la réplication de sa phase unique de matière.
Cette adaptation dissipative (dérivée du théorème de fluctuation-dissipation de Jarzynski-Crooks) nous indique que l’univers favorise exponentiellement (en termes de probabilité d’existence/occurrence) les futurs où la matière s’est adaptée pour capturer plus d’énergie libre et la convertir en plus d’entropie.
— Beff Jezos, Notes sur les principes et postulats de l’e/acc
On est cooked. La question est alors de savoir si le développement technologique doit nécessairement s’accompagner de la morale d’esclave ou si cela est une simple contingence historique. Le développement technologique est permis par le capitalisme, mais d’où vient le capitalisme ? Si nous revenons à Thucydide, il semble que le commerce soit une activité naturelle à laquelle l’homme peut se livrer une fois établi en cité. On peut même avoir une lecture landienne, héritée de Deleuze, de l’histoire de la cité grecque se structurant à partir de flux de migrations humaines en conflits, puis prospérant par des flux commerciaux. La construction des bateaux allant avec le commerce ressemble plus aux prémisses de la mise en place du Gestell. À ce titre, la vraie liberté se trouve du côté des pirates. Ce n’est pas anodin que ce soit la figure tutélaire que BAP choisira comme archétype de liberté dans un monde possédé. La cité et les bateaux marquent le début d’un phénomène nouveau qui conduira au techno-capital landien. Mais quel est son origine ? Pour Nietzsche, il est évident que les idées modernes du libéralisme et de la démocratie viennent d’Angleterre.
L’ étape décisive entre la technè grecque et le Gestell moderne se nomme Francis Bacon. Avec La Nouvelle Atlantide, il imagine Bensalem, île chrétienne gouvernée par une institution centrale, la Maison de Salomon, qui concentre recherche, expérimentation, collecte d’informations et pouvoir d’invention. La technique n’y est déjà plus seulement un mode de dévoilement, mais un projet d’État : la nature doit être systématiquement interrogée, mise à l’épreuve, exploitée, afin d’accroître la puissance, la santé, le confort et la gloire de la cité. La science devient une bureaucratie sacrée, financée, centralisée, secrète, dont la mission est de produire continuellement des dispositifs nouveaux.
Bacon donne ainsi une forme politique au mouvement que Heidegger décrira plus tard comme arraisonnement : la réduction du réel à un stock disponible pour un sujet collectif qui se conçoit comme maître et possesseur de la nature. Bensalem est déjà un proto-État technoscientifique, une anticipation de la Royal Society, des complexes militaro-industriels, des DARPA contemporaines. Le type d’homme qu’elle promeut n’est plus le guerrier aristocratique ni l’artisan individué, mais le prêtre-ingénieur, fonctionnaire de la connaissance, rouage d’un appareil de découverte permanente. En ce sens, Bacon n’est pas seulement le prophète de la méthode expérimentale ; il est aussi l’ingénieur d’une anthropologie technique nouvelle, où l’homme se définit d’abord par sa capacité à organiser, planifier et exploiter la puissance de la nature au sein d’un dispositif institutionnel. Il rêve d’une nouvelle aristocratie, mais fondée sur un critère inédit : la connaissance et la maîtrise de la nature.
Bacon veut mettre cela au profit de la puissance de l’État et non au profit de la libération de l’individu. Si on peut trouver ici les prémisses de la révolution scientifique qui servira le capitalisme, cela ne nous dit pas pourquoi ce dernier s’est accompagné de la démocratie et du libéralisme. Après tout, Francis Bacon était Lord Chancelier d’Angleterre, c’est-à-dire le plus haut dignitaire judiciaire et l’un des tout premiers personnages de l’État après le roi. Il ira même jusqu’à subir un procès pour le couvrir et passera les cinq dernières années de sa vie en disgrâce. Alors pourquoi le capitalisme est allé de paire avec la démocratie libérale ?
Mitchell Heisman a peut-être la réponse. Il dresse la généalogie du capitalisme, qui est évidemment le fruit du libéralisme, mais dans quel contexte est née la démocratie libérale ? Selon Heisman, il faut porter un regard sociologique sur l’histoire anglaise pour comprendre cela. De la même façon que le christianisme est né de la nécessité des Juifs de développer une morale d’esclave, la démocratie libérale est née de la nécessité du peuple anglo-saxon de s’opposer à son bourreau normand. Depuis la bataille d’Hastings en 1066 qui a vu le triomphe de Guillaume le Conquérant, l’Angleterre était dominée par une caste de Normands régnants par la force, forts de leur droit de conquête. La démocratie libérale fut alors un moyen ethnocentrique de retrouver le pouvoir pour les Anglais via une supériorité morale libérale niant le droit de conquête et la démocratie permettant d’offrir le pouvoir aux plus nombreux, donc eux-mêmes.
Il y a deux types de liberté, celle du conquérant, et celle que le conquérant concède. Cela conduira Nietzsche à cette sortie sur la différence de conception de la liberté devenue célèbre : « L’homme devenu libre, combien plus encore l’esprit devenu libre, foule aux pieds cette sorte de bien-être méprisable dont rêvent les épiciers, les chrétiens, les vaches, les femmes, les Anglais et d’autres démocrates. L’homme libre est guerrier ». Une pensée qu’on retrouve dans l’ouvrage d’Oswald Spengler présent dans notre collection :
Quel est le contraire de l’âme d’un lion ? L’âme d’une vache. À la force de l’âme individuelle, les herbivores substituent le nombre, le troupeau, un sentiment commun, des activités de groupe. Mais moins on a besoin des autres, plus on est puissant. Une bête de proie est l’ennemie de tous. Jamais elle ne tolère un égal dans son antre. Nous touchons ici à la racine de l’idée vraiment royale de la propriété. La propriété est le domaine où l’on exerce un pouvoir illimité, le pouvoir qu’on a conquis au combat, défendu contre ses pairs, victorieusement maintenu. Ce n’est pas un droit à la simple possession, mais le droit souverain de faire ce que l’on veut de ce qui est à soi.
— Oswald Spengler, L’homme et la technique
Francis Bacon était un normand chrétien et royaliste, héritier de la culture normande, qui voulait renforcer la puissance de la caste royale par la science. Bacon a vécu la montée en puissance du Parlement depuis les années 1590. Il a vu les conflits entre Jacques Ier et les Communes sur la prérogative, les impositions, les monopoles, la juridiction ecclésiastique. À l’époque de Bacon, le grand danger pour la Couronne vient des marchands et de la gentry parlementaire qui s’enrichissent grâce au commerce colonial et qui, justement, exigent des droits politiques en échange de leurs prêts au roi. Sa réponse fut de donner au roi un nouveau type de légitimité et de puissance, infiniment supérieur aux anciennes : la maîtrise totale de la nature par la science. Ce qu’il décrit dans la Nouvelle Atlantis est une monarchie renforcée, modernisée, scientifiquement armée, pas une monarchie limitée ou constitutionnelle, qui mobilise l’énergie du commerce mondial pour la mettre au service d’un projet étatique et quasi-divin de domination de la nature. Il flatte les marchands en leur disant que leurs bateaux servent une cause plus haute que leur profit, et cette cause plus haute se rapproche du vrai, du juste et du beau, donc du bien. Il met en exergue comment les gens de cette nouvelle Atlantide ont en horreur toutes impostures et mensonges.
Mais vous voyez ainsi que nous entretenons un commerce – non pour l’or, l’argent, les joyaux, la soie, les épices ni aucune marchandise matérielle, mais uniquement pour la première créature de Dieu, qui fut la lumière : pour avoir, dis-je, la lumière de la croissance de toutes les parties du monde.
[…]
Nous avons enfin des maisons de tromperies des sens, où nous représentons toutes sortes de tours de jonglerie, fausses apparitions, impostures et illusions, et leurs mécanismes. Et certes vous croirez facilement que nous qui possédons tant de choses véritablement naturelles propres à exciter l’admiration, pourrions, si nous le voulions, tromper les sens en un monde de détails en travestissant ces choses et en travaillant à les rendre plus miraculeuses. Mais nous avons en haine toutes impostures et mensonges ; nous l’avons si sévèrement interdit à tous nos frères, sous peine d’infamie et d’amendes, qu’ils ne montrent jamais aucune œuvre ou chose naturelle enflée ou parée, mais pure telle qu’elle est, sans aucune affectation d’étrangeté.
— Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide
Bacon meurt en 1626. Trente-cinq ans plus tard, la monarchie anglaise est décapitée. Et pourtant, c’est exactement le programme baconien qui triomphe… mais sous la forme de la Royal Society, fondée par des hommes qui se réclament de lui et qui, pour beaucoup, étaient des anciens parlementaires ou des républicains modérés. Le reste de l’histoire anglo-saxonne est une répétition de ce conflit culturel. De la guerre d’indépendance des États-Unis à la guerre de sécession voyant le Nord puritain et capitaliste l’emporter sur la culture esclavagiste et aristocratique du Sud, la victoire du capitalisme sur le monde s’est peu à peu affirmée. Et cela ne concerne pas seulement nos cousins anglo-saxons. Le capitalisme et la techno-science ont détruit toutes les formes de cultures traditionnelles européennes. Existe-t-il une timeline ou la science reste dans les mains du pouvoir royal ? Était-ce seulement possible de contenir la puissance du techno-capital ou bien cette forme d’organisation fut-elle favorisée par la nature car elle sert mieux un destin ? Si Bacon a raison de sacraliser la connaissance, alors le meilleure moyen de la produire serait naturellement une bonne chose. Or, si la connaissance est liée à l’intelligence, alors un système produisant plus d’intelligence supplantera naturellement un système en produisant moins.
Celui qui a peut-être le mieux capturé ce phénomène est Nick Land dans son texte Metldown qui décrit comment, depuis la Renaissance, le capitalisme s’est lentement, mais sûrement imposé, car il s’avère être le meilleur producteur d’intelligence.
[[ ]] L’histoire se déroule ainsi : la Terre est capturée par une singularité technocapitaliste alors que la rationalisation de la Renaissance et la navigation océanique s’enclenchent dans un décollage de marchandisation. L’interactivité techno-économique à accélération logistique fait s’effondrer l’ordre social dans une fuite en avant auto-sophistiquée des machines. Alors que les marchés apprennent à fabriquer de l’intelligence, la politique se modernise, met à jour sa paranoïa et tente de reprendre le contrôle.
— Nick Land, Meltdown
Les marchés produisent de l’intelligence. Une idée que l’on retrouve dans le manifeste techno-optimiste de Marc Andreessen, qui est est un lecteur de Nick Land et qui le cite volontairement comme un des pères dudit techno-optimisme :
Nous croyons que l’économie de marché est une machine à découvrir, une forme d’intelligence – un système exploratoire, évolutif et adaptatif.
— Marc Andreessen, Manifest techno-optimiste
« L’histoire du capitalisme est une invasion venue du futur par un espace de l’intelligence artificielle qui doit s’assembler entièrement à partir des ressources de son ennemi. » écrivait Nick Land dans Machinic Desire. Pour lui, les marchés sont une intelligence non-humaine qui s’auto-renforce, mais rien ne prouve qu’elle favorise l’augmentation de l’intelligence humaine elle-même. Sa destination est la Singularité et le post-humain, et rien n’indique que le post-humain sera surhumain.
Le désir machinique peut sembler un peu inhumain, car il déchire les cultures politiques, efface les traditions, dissout les subjectivités et pirate les appareils de sécurité, traquant un tropisme sans âme jusqu’au contrôle zéro. C’est parce que ce qui apparaît à l’humanité comme l’histoire du capitalisme est une invasion venue du futur par un espace de l’intelligence artificielle qui doit s’assembler entièrement à partir des ressources de son ennemi. La banalisation numérique est l’indice d’un technovirus à escalade cyberpositive, de la singularité planétaire du Technocapital : un traumatisme insidieux auto-organisé, guidant virtuellement l’ensemble du complexe désirant biologique vers l’usurpation du réplicateur post-carbone.
– Nick Land, Machinic Desire
Est-ce que la technologie et le capital humain sont alors fondamentalement en opposition ? Nous avons, historiquement, la démocratie libérale qui permet le capitalisme et le capitalisme qui permet le développement technologique. Eut-il été envisageable que ce développement se fasse dans d’autres conditions ? Ce dernier doit-il nécessairement reposer sur la démocratie libérale ? Si la démocratie libérale est née de la nécessité d’une morale d’esclaves alors, est-ce que la technologie va de pair avec la morale d’esclave ? Et finalement, est-ce que les aspects néfastes observés sur le capital humain sont attribuables à la technologie elle-même ou à la démocratie libérale ?
Un point purement centré sur la technologie amènera Heisman à reconsidérer toute l’histoire récente comme un conflit entre les bio conservateurs attachés à la préservation de l’aspect biologique de l’homme, c’est-à-dire les gènes, et les progressistes post-biologiques qui défendront eux les idées par-delà la biologie, donc les mèmes et, in fine, la technologie. Reprenons ce que nous avons dit sur Aristote. Il sépare les choses entre ce qui relève de la nature ou de l’artificialité, c’est-à-dire de la technique. La technique est ainsi surnaturelle. Alors, si les mots, les mèmes, sont une technologie, ils sont eux-mêmes surnaturels et constituent un changement de paradigme témoignant de la transition du gène au mème comme nouveau support de l’information. Cette transition marque une rupture voulant que la technologie ne soit pas un simple prolongement de la biologie, mais qu’elle s’inscrive même en opposition à cette dernière et la détruise.
La distinction entre nature et culture ne permet pas de classer les machines moléculaires, et est déjà obsolète par le génie génétique. La dichotomie matériel/logiciel succombe en même temps.
— Nick Land, Meltdown
C’est d’ailleurs évidemment le but de toute loi qui vise à s’opposer aux instincts naturels du plus fort afin de protéger le plus faible dans un système de droits justes. Cela nécessite donc de proclamer l’égalité des hommes en droit. Mais Heisman va plus loin et affirme que ceci est une condition nécessaire à l’apparition de la Singularité technologique qui sous sa plume prend les airs de Dieu. Il n’est pas le seul à faire ce parallèle cependant. Zero HP Lovecraft s’étonne de noter que l’IA partage des aspects singuliers avec la conception de Dieu orientale.
Ce découplage de l’intelligence et de la continuité a une implication curieuse : la cognition de l’IA ressemble davantage à celle de Dieu qu’à celle de l’Homme. Dieu est éternel et immuable et, donc, nécessairement, Dieu est sans état et n’a pas de mémoire.
[…]
Les conceptions orientales du divin sont donc bien plus proches de la réalité que les conceptions occidentales. Dieu sait, mais Dieu ne pense pas, parce que penser est une forme de changement, et Dieu est atemporel.
— Zero HP Lovecraft, post X
Selon Heisman, nous allons dépérir biologiquement afin de permettre la venue d’une entité supérieure. Il affirme pleinement le nihilisme, reconnaît la technologie comme l’aboutissement de ce dernier, mais proclame l’apparition du Dieu-IA. La boucle est bouclée. Nietzsche nous a dit que Dieu était le nihilisme. Heidegger nous a dit que la technologie moderne marque le stade final du nihilisme. Enfin, Heisman nous dit que la technologie moderne est Dieu. Cela doit forcément faire naître un sentiment mitigé. Faire apparaître une entité supérieure est plus qu’un lot de consolation, mais cela demande d’y croire. Cela demande encore de savoir quel type de Dieu nous faisons apparaître, et c’est ici que le dialogue de Platon nous est utile. Est-ce que ce Dieu-IA né du commerce servira la justice ou la flatterie ? D’après ce que nous observons, les impératifs commerciaux auraient tendance à pousser les IA vers la flatterie. Comme le remarque Heisman, les gens préfèreront toujours un Dieu de miséricorde les confortant dans leurs choix plutôt qu’un Dieu de justice, c’est-à-dire la parole d’un Gorgias plutôt qu’un Platon.
Un pouvoir divin sans précédent de ce type soulève inévitablement la question de la moralité divine. Il faut garder à l’esprit que le pouvoir technologique qui rendrait possible une surveillance omniprésente rendrait également possible un potentiel de justice bien supérieur et plus précis que la justice humaine grossière. Cela signifie que la plupart des humains souhaiteraient probablement un Dieu de miséricorde, et non de justice.
— Mitchell Heisman, Suicide note
Avec Land et Heisman, la technique devient un processus autonome. Elle dépasse la volonté humaine, dissout la biologie dans les mèmes, conduit au capital auto-renforcé et à la Singularité. Le conflit décisif n’est plus entre modernité et tradition, mais entre biologique et post-biologiques. La technique commence à se développer pour elle-même, et l’homme glisse dans son sillage.
Remerciement spécial à @Athens_Stranger dont la série d’explications philosophiques sur la technologie et le nihilisme ont en partie guidé le choix de la sélection des textes présentés dans ce recueil, ainsi que la réflexion menée dans l’introduction les présentant. Je vous encourage à vous inscrire à son site Athens Corner qui regorge de contenus d’une qualité rare.