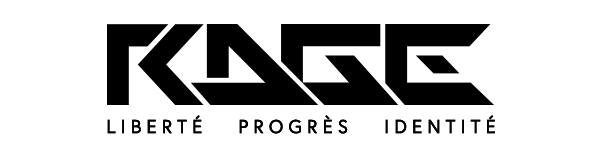Cette série d’articles constitue l’introduction de l’ebook sur la technique regroupant une vingtaine de textes. Elle permet de pouvoir naviguer dans les textes du corpus en comprenant ce qu’ils ont à apporter au sujet traité. Vous pouvez vous procurer l’ouvrage par un tip de la valeur de votre choix.
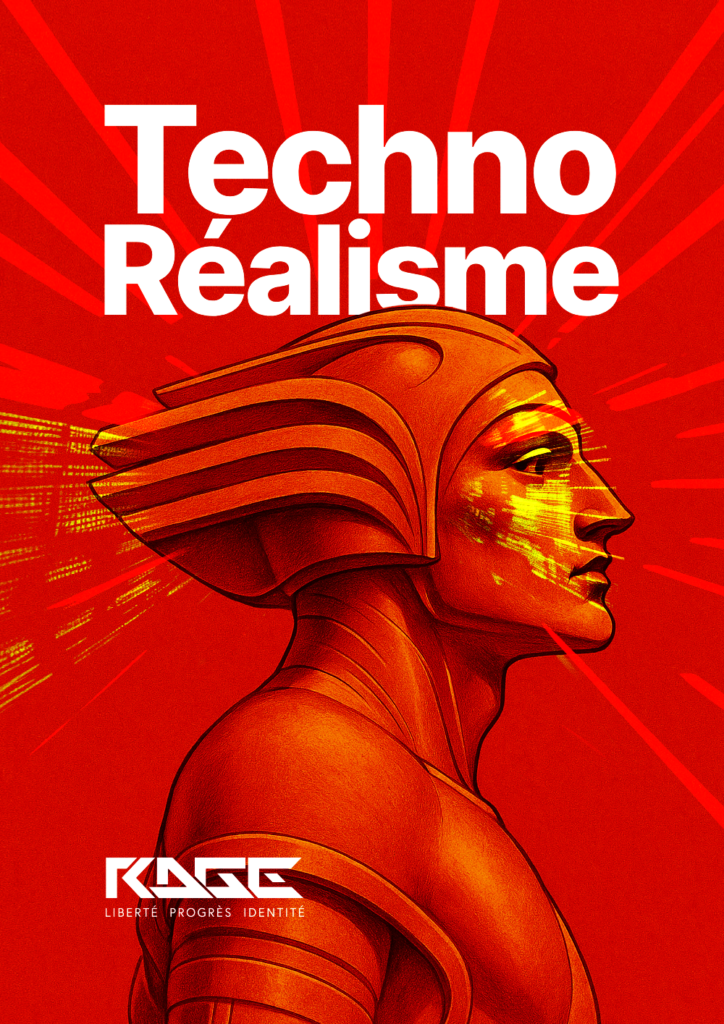
Suite à l’article précédent, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi j’ai choisi d’inclure Platon dans un recueil sur la Technologie. Je n’ai pas choisi n’importe quel dialogue, mais celui qui l’oppose aux sophistes dont Nietzsche prend fait et cause. Je vous encourage à dépasser la simple volonté de choisir un camp cependant, mais de lire avec toute l’attention nécessaire leur échange, car il peut nous renseigner sur la conception grecque de la technique. Les Grecs parlaient de Technè, c’est-à-dire l’art ou la technique, et de Logos renvoyant à la raison ou au langage. Jamais ils n’auraient mélangé ces mots, à l’exception des sophistes qui parlent de la technè du logos. La technè était pour les Grecs archaïques une application du logos. Nous, modernes, comprenons la technologie comme une science appliquée. Or, si la technè est l’application de l’esprit, alors parler de technologie serait l’application de l’esprit à l’esprit. En d’autres termes, c’est l’art du discours ou, plus simplement, la manipulation et cela ne mérite même pas le nom d’art pour Platon, car cette fonction s’éloigne du bien par nature. C’est la croyance se faisant passer pour savoir via la flatterie, le bavardage prenant l’apparence de la vérité. Le langage est une technologie, mais plus généralement, la technologie est un langage. Une telle conception étymologique sera un élément clef pour comprendre des penseurs comme Heidegger ou Ernst Jünger.
La technique, en ce sens, est la maîtrise de la langue qui a cours dans l’espace du travail. Cette langue n’est pas moins significative ni moins profonde que toute autre, car elle ne possède pas seulement une grammaire mais une métaphysique. Dans ce contexte, la machine joue un rôle aussi secondaire que l’homme, elle est seulement l’un des organes qui permettent de parler cette langue.
— Ernst Jünger, Le Travailleur
Il est ainsi beaucoup plus facile de comprendre pourquoi il me semblait opportun d’intégrer le Gorgias de Platon où il met en avant une différence de conception de finalité du discours qui oppose Socrate aux sophistes. Alors que Gorgias affirme que son enseignement est neutre et qu’il peut être appliqué en vue du bien comme du mal, le simple fait d’utiliser des moyens de manipulation ne peut être dirigé vers le bien pour Platon. Prétendre à la neutralité est une ruse de sophiste pour Platon. Que reproche Nietzsche à Platon alors ? Alors que Platon reproche à Gorgias de ne pas se préoccuper du bien, mais seulement de l’efficacité et de la puissance qu’elle procure, Nietzsche croit voir clair au travers du manège de Platon. En réalité, tout le monde recherche la puissance et Platon ne ferait qu’inventer un code moral lui permettant de s’en servir comme un outil de contrôle. Ainsi, Platon ne chercherait lui aussi jamais que sa puissance, mais par la morale. Plus encore, ceci serait la marque des faibles pour Nietzsche. Tout le monde peut user de la sophistique de Gorgias, mais seuls les faibles l’utiliseront à des buts de manipulation, car les forts n’en ont pas besoin. Nietzsche voit chez Socrate le faible qui use du langage pour établir un ordre moral. Il voit beaucoup plus de sincérité chez Gorgias qui avoue le plus simplement du monde qu’il enseigne le souverain bien, c’est-à-dire « la liberté pour lui-même et la domination sur les autres ». Il questionne l’attitude d’un tel personnage qui se promène en ville pour venir discuter des idées. Ce ne sont pas ici des manières d’aristocrate et Nietzsche s’identifie en réalité beaucoup plus à Calliclès, qui fera remarquer à Socrate que, passé un certain âge, il vaut mieux ne plus philosopher.
CALLICLÈS — Car, Socrate, sous prétexte de chercher la vérité, tu nous fatigues avec des artifices oratoires sur ce qui est honteux selon la nature et selon la loi. Le plus souvent, la nature et la loi se contredisent. Il est donc impossible, si l’on a honte de dire ce qu’on pense, de ne pas tomber dans la contradiction. Tu as très bien compris ce mécanisme, et tu t’en sers pour discuter de façon captieuse : si l’on te parle suivant la loi, tu interroges suivant la nature ; si l’on te parle suivant la nature, tu reviens à la loi.
[…]
Subir l’injustice n’est même pas chose d’homme : cela convient aux esclaves, pour qui la mort est plus avantageuse que la vie, eux qui, contre l’injustice et les mauvais traitements, sont sans défense pour eux-mêmes et pour ceux qu’ils aiment. La loi, au contraire, est œuvre des faibles et du grand nombre.
— Platon, Gorgias
Le problème de Nietzsche avec cet art du discours n’est pas alors qu’il manquerait à se diriger vers le bien, mais au contraire qu’il est une arme des faibles. Il a un pouvoir égalisateur qui permet aux faibles de se hisser au niveau des forts. C’est toute l’idée sur laquelle repose sa généalogie de la morale, voulant que les Juifs, puis les chrétiens aient inventé leurs principes moraux en tant que faibles. Les lois mosaïques, comme toute loi, sont une technologie. Elles visent en premier lieu à contrôler le comportement des membres du groupes, et elles ont besoin de reposer sur un absolu pour être une bonne technologie. Il existe un biais à l’optimisme chez les humains. Si vous dîtes aux gens que dans 90% des cas, l’infidélité finit par causer la destruction du mariage, ils auront une tendance naturelle à s’imaginer qu’il font parti des 10% d’exception. Alors, affirmer que l’on a reçu une loi de Dieu valable pour tous sous peine de sanction divine qui dit « Tu ne commettras pas d’adultère » sera une meilleure technologie favorisant une meilleure organisation du groupe. Tout le monde est égal devant la loi, devant Dieu. Dieu est une technologie.
C’est dans un sens restreint que l’homme ne veut maintenant rien d’autre que la vérité : il désire les conséquences agréables, préservant la vie, de la vérité. Il est indifférent à la connaissance pure qui n’a pas de conséquences ; envers ces vérités qui sont potentiellement nocives et destructives, il adopte même une attitude hostile. Et d’ailleurs, que dire de ces conventions linguistiques elles-mêmes ? Sont-elles peut-être des produits de la connaissance, c’est-à-dire du sens de la vérité ? Les désignations sont-elles congruentes avec les choses ? La langue est-elle l’expression adéquate de toutes les réalités ?
Seul à travers l’oubli, l’homme peut parvenir à croire qu’il détient une ‘vérité’ d’un tel calibre.
[…]
Nous ne savons toujours pas d’où vient le désir de vérité. Car jusqu’à présent, nous avons seulement entendu parler du devoir que la société impose pour exister : être véridique signifie employer les métaphores habituelles. Ainsi, pour l’exprimer moralement, c’est le devoir de mentir selon une convention fixe, de mentir avec le troupeau et de manière contraignante pour tous. Maintenant, l’homme oublie bien sûr que les choses se passent ainsi pour lui. Ainsi, il ment de la manière indiquée, inconsciemment et conformément à des habitudes vieilles de plusieurs siècles ;
— Nietzsche, Crépuscule des idoles
C’est précisément pourquoi Nietzsche verra dans le Bien, ou Dieu, des outils de contrôle des faibles sur les forts qu’ils utilisent via le langage. D’où sa critique sévère du langage et des normes qu’il impose prétendant à la vérité. Il n’y voit que mensonge des faibles l’utilisant comme une technologie à leur profit. Une idée qu’on retrouve avec la technique dans la phrase célèbre de Samuel Colt, l’inventeur du revolver du même nom : « Dieu a fait des hommes grands et d’autres petits, je les ai rendus égaux ». Les armes ne seraient cependant qu’une étape déjà dépassée depuis longtemps dans un processus d’égalisation bien avancé qui aboutira à Andy Warhol affirmant « Ce qui est génial dans ce pays, c’est que l’Amérique a instauré la tradition où les consommateurs les plus riches achètent essentiellement les mêmes choses que les plus pauvres. Vous pouvez regarder la télé et voir une publicité pour Coca-Cola, et savoir que le président boit du Coca, Liz Taylor boit du Coca, et juste penser que vous aussi, vous pouvez boire du Coca ». Or, est-ce « génial » en soi que tout le monde boive du Coca ? N’est-ce pas ici exactement à quoi on s’attendrait si le monde moderne tendait à produire un seul type d’homme, le dernier homme ? Voilà la préoccupation de Nietzsche et il se pourrait que la morale d’esclave et la technologie aillent de pair pour produire le dernier homme. Cependant, ce que Nietzsche ne voit peut-être pas, c’est que le discours de Gorgias est précisément celui du commerce. Celui de la lessive qui lave plus blanc que blanc, c’est-à-dire celui de la flatterie et de l’appel aux émotions plutôt qu’à la raison. Il accompagne l’essor du nouveau type d’homme que Thucydide observait. Il ne me semble pas alors si facile de se prononcer de manière définitive sur lequel a raison entre Platon et Gorgias.
Eh bien, Gorgias, la rhétorique, à ce qu’il me semble, est une pratique qui n’a rien d’un art véritable, mais qui exige une âme douée d’imagination, d’audace, et naturellement portée au commerce avec les hommes.
Je donne à ce genre de pratique un nom général : la flatterie.
— Platon, Gorgias
Avec Platon, Gorgias et Calliclès, la technique devient langage, donc pouvoir. Pour Platon, la technè du logos est une flatterie qui s’éloigne du Bien ; pour Calliclès, c’est une arme des faibles qui égalise les forces. Le langage est une technologie qui façonne les rapports de domination. La question devient : la technique élève-t-elle l’homme ou le normalise-t-elle ?
Remerciement spécial à @Athens_Stranger dont la série d’explications philosophiques sur la technologie et le nihilisme ont en partie guidé le choix de la sélection des textes présentés dans ce recueil, ainsi que la réflexion menée dans l’introduction les présentant. Je vous encourage à vous inscrire à son site Athens Corner qui regorge de contenus d’une qualité rare.