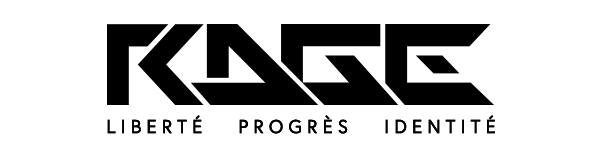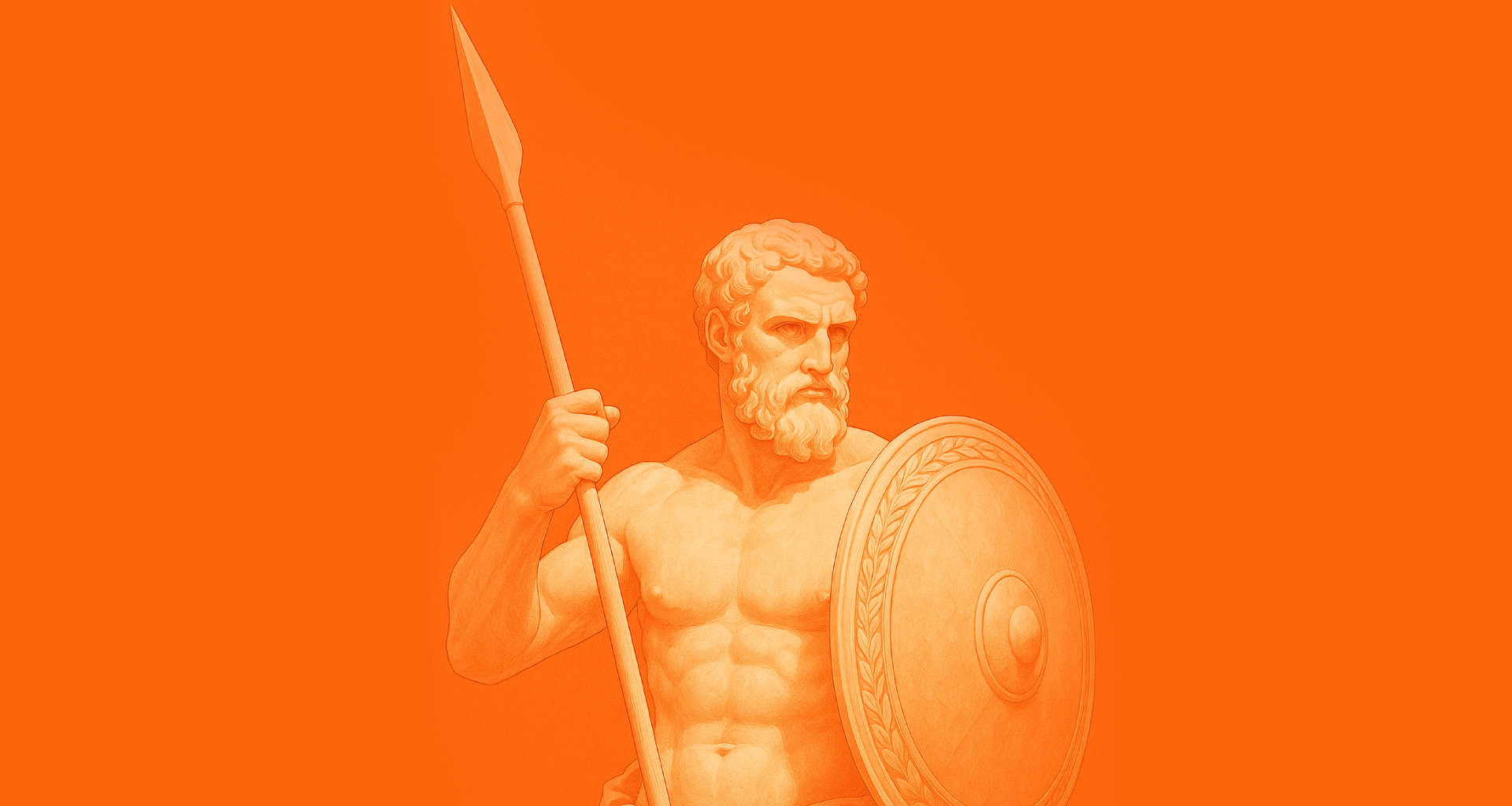Cette série d’articles constitue l’introduction de l’ebook sur la technique regroupant une vingtaine de textes. Elle permet de pouvoir naviguer dans les textes du corpus en comprenant ce qu’ils ont à apporter au sujet traité. Vous pouvez vous procurer l’ouvrage par un tip de la valeur de votre choix.
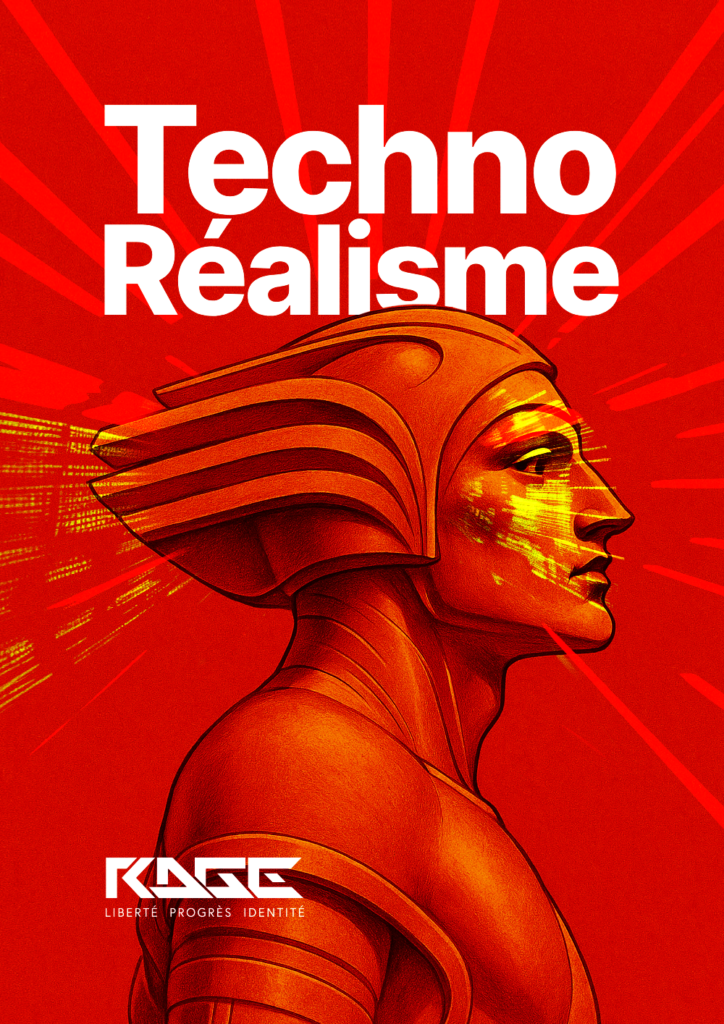
Je ne peux décemment vous soumettre cette sélection de textes sans un minimum d’explication. Pourquoi ai-je procédé à un tel tri et pourquoi n’ai-je pas inclus d’autres auteurs ? Cette introduction sera autant pour moi l’occasion de clarifier mon intention que de justifier la présence des textes et auteurs mis en avant dans la suite se l’ouvrage. Au travers de ces lectures, je veux dessiner les contours de l’évolution technologique. Tenter de la comprendre pour ce qu’elle est, froidement, de façon réaliste. Cette introduction défend une thèse simple : la technologie n’est ni un outil neutre ni un destin heureux. Elle façonne le type d’homme qui l’utilise, et c’est à cette anthropologie technique que nous devons nous confronter. Ce volume rassemble les auteurs qui permettent de comprendre le chemin qui mène de la technè grecque à la Singularité, et d’y situer une position lucide : le techno-réalisme.
Lorsqu’on parle de réalisme, le premier nom qui nous vient à l’esprit est celui de Machiavel. Certains mieux avisés remonteront jusqu’à Thucydide. Je pense pour ma part qu’il ne serait pas idiot d’attribuer le titre de premier réaliste à Archiloque qui, tout poète fut-il, proposa un type de poésie bien différente de celle d’Homère. Alors que Homère peint un tableau de l’idéal guerrier, Archiloque chante la réalité des affects du combat loin de tous idéaux. Archiloque était avant tout un soldat et il peut sembler étrange de voir Adimante le qualifier de « très sage » dans sa discussion avec Socrate dans le Livre II de La République. Archiloque est rustre, vulgaire, cru, sarcastique, féroce, impulsif, sanguin, cynique et beaucoup de choses encore, mais il n’est pas sage et il n’était pas tenu pour sage par les Grecs.
« Ma lance est ma boisson, ma lance est ma moisson,
— Archiloque, Fragment 2, L’homme de guerre (7), La couronne et la lyre, Marguerite Yourcenar
Je festoie au banquet appuyé sur ma lance. »
Archiloque est un guerrier poète. Il use de la poésie pour mettre en scène ses qualitéa militaires et explore sans détours toutes les vicissitudes de l’âme de l’homme d’action sans se soucier particulièrement de savoir si cela est juste et bon. Il met en exergue comment un outil technique comme sa lance semble être un prolongement de son corps biologique qui ne le quitte jamais et devient comme une seconde nature. Toutefois, il narre aussi comment il s’est débarassé de son bouclier pour fuir une mort certaine, ce qui était considéré comme un sacrilège, un manque d’honneur, dans des villes comme Sparte. En cela, chez lui, la nature est plus importante que la technique, la biologie, plus importante que les idées. Alors pourquoi Adimante dit de lui qu’il est sage dans le passage suivant ?
— ADIMANTE : D’après ce qu’on rapporte, si je suis juste sans le paraître je n’en tirerai aucun profit, mais des ennuis et des dommages évidents ; injuste, mais pourvu d’une réputation de justice, on dit que je mènerai une vie divine. Donc puisque l’apparence, ainsi que me le montrent les sages, fait violence à la vérité, et qu’elle est maîtresse du bonheur, vers elle je dois tendre tout entier. Comme façade et décor je dois tracer autour de moi une vaine image de vertu, et tirer derrière le renard du très sage Archiloque, animal subtil et fertile en ruses.
— Platon, La République
Archiloque serait donc sage de se comporter d’une façon que personne ne qualifierait de sage. Adimante l’utilise pour justifier la supériorité de vivre une vie se donnant les traits du respect de la justice, alors même qu’on utilise l’injustice à notre profit. Alors, pourquoi Platon utilise ce personnage à cette fin ?
Dans cet ouvrage, les protagonistes discutent de ce sur quoi repose la naissance de la cité. Adimante prolonge l’idée de Thrasymaque voulant que l’injustice vaut mieux que la justice si on est celui qui profite de l’injustice et que la force fait le droit. L’idée de Socrate est, au contraire, que la cité, née d’abord du besoin et de la division des tâches, sera ensuite comprise comme ne pouvant reposer que sur la justice : celle-ci sera définie comme le principe qui ordonne la séparation des fonctions et permet à des individus de se coaliser par des échanges équilibrés. C’est donc ici une interprétation de sa part sur la façon par laquelle une cité vient à la naissance, mais aussi sur le type d’homme qui la compose, c’est-à-dire des individus incapables de se suffire à eux-mêmes et comptant sur les autres pour leur survie. Chez Platon, la cité naît du besoin, et donc indirectement du commerce qui se perfectionne peu à peu techniquement, puis, seulement lorsqu’elle devient luxueuse, elle entre en conflit pour des ressources, ce qui rend nécessaire une armée spécialisée pour la défendre. Finalement, cette armée sera utilisée pour son expansion.
— SOCRATE : Alors poursuivons. Ce qui fonde une cité, c’est l’incapacité de chacun à se suffire à lui-même. Ainsi naissent échanges, métiers, puis la cité. […] ils passeront ainsi agréablement leur vie ensemble, et régleront le nombre de leurs enfants sur leurs ressources, dans la crainte de la pauvreté ou de la guerre.
— Platon, La République
En qualifiant Archiloque de sage, Adimante, jouant le rôle de l’avocat du diable permettant à Socrate d’affirmer le bienfait de la justice, signifie qu’il incarne au contraire l’opposé de ce que Socrate voit comme la justice. Archiloque choque, car il se moque des idéaux et des conventions. Il est l’anti-Socrate. Pourtant il a contribué à bâtir des cités en participant à des expéditions de colonisation. Alors est-ce qu’Archiloque incarne simplement l’aspect militaire par lequel une cité trouvera son expansion ou est-ce qu’il révèle que les cités ne sont pas fondées par le commerce et le droit ?
Thucydide nous offre un point de vue différent de Platon et peut-être plus précieux sur la façon par laquelle une cité vient à la vie. Chez Thucydide, l’ordre politique se cristallise dans un environnement de guerre et de razzias, puis se déploie grâce au commerce et à la maîtrise technique, notamment navale. Je vous encourage à lire La guerre du Péloponnèse en entier, mais il n’était évidemment pas raisonnable de reproduire l’intégralité des 8 livres, ni même le premier livre dans son entièreté. Vous trouverez donc les 22 premiers paragraphes du premier livre, qui sont déjà riches d’enseignement. Prenez le temps de bien les lire ligne par ligne selon les conseils de Nietzsche lui-même.
Rien ne guérit plus radicalement que Thucydide du lamentable enjolivement, sous couleur d’idéal, que le jeune homme à « éducation classique » emporte dans la vie en récompense de l’application au lycée. Il faut le suivre ligne par ligne et lire ses arrière-pensées avec autant d’attention que ses phrases : il y a peu de penseurs si riches en arrière-pensées. En lui la culture des Sophistes, je veux dire la culture des réalistes, atteint son expression la plus complète : un mouvement inappréciable, au milieu de la charlatanerie morale et idéale de l’école socratique qui se déchaînait alors de tous les côtés.
— Nietzsche, Crépuscule des idoles
Si je devais résumer le propos de Thucydide en quelques lignes, je dirais qu’il nous dit ceci : Il est un Athénien. La cité d’Athènes a émergé dans un espace qui était dominé par des flux de nomades en guerre constante. Elle y est parvenue grâce à sa supériorité technique et la maîtrise technique est précisément ce qui constitue la différence entre un Athénien et un barbare. L’avance technique d’Athènes valait à ses citoyens d’être les premiers à pouvoir se promener dans la ville sans porter d’armes. Une chose qui était inconcevable auparavant tant le danger régnait partout. Ce danger empêchait l’établissement de tout commerce. Maintenant florissante, le commerce fut un moteur de développement technologique qui conduisit à l’apparition d’une flotte considérable.
On voit, en effet, que la Grèce actuelle n’était pas anciennement habitée de façon stable ; on émigrait, dans les premiers temps, et tous quittaient facilement leurs résidences, sous la pression, chaque fois, d’éléments plus nombreux.
Le commerce n’existait pas, et il n’y avait pas de relations sûres entre peuples, par terre ou par mer ; de plus, ils tiraient chacun de leur pays juste de quoi vivre : ils n’avaient pas de réserves d’argent et ne faisaient pas de plantations (car on ne savait jamais, le manque de remparts aidant, quand un autre viendrait pour les dépouiller) ;
[…]
À mesure que la Grèce gagnait en puissance et se préoccupait davantage d’acquérir des richesses, on vit se former, dans la plupart des cités, des tyrannies rendues possibles par l’augmentation des revenus en argent. Auparavant, il n’existait que des royautés héréditaires aux prérogatives bien définies.
[…]
— Thucydide, La guerre du Péloponnèse
Si le nom d’Athènes est célèbre chez tous les hommes, sachez que c’est parce qu’elle ne cède point â l’adversité; qu’elle a fait à la guerre de grands frais d’hommes et de travaux; mais qu’elle a possédé, jusqu’à ce jour, la plus respectable puissance, et que s’il faut que nous dégénérions un jour, car tout est destiné à décroître, il en restera du moins un éternel souvenir.
Il décrit Athènes comme un sommet de perfectionnement artistique grâce à sa technique et il nous présente alors un portrait de la guerre du Péloponnèse opposant une Athènes progressiste à une Sparte traditionaliste. Pourtant, c’est bien Sparte qui l’a emporté. Alors que manquait-il à Athènes ? Peut-être que la réponse est à chercher entre les lignes de Thucydide afin d’y trouver ses arrières-pensées.
Il est dans le caractère que vous ont transmis vos ancêtres d’acquérir des vertus au milieu des fatigues : ne changez point de mœurs, quoique vous jouissiez aujourd’hui d’un peu plus de fortune et de puissance. Il n’est pas juste de perdre par la richesse ce qu’on a gagné par la pauvreté.
— Thucydide, La guerre du Péloponnèse
Est-ce que les Athéniens s’étaient ramollis ? Est-ce que la technique les avait ramollis ? On est face à l’impression que le commerce a favorisé l’essor d’un nouveau type d’homme. Du soldat Archiloque, on est passé au philosophe Socrate. Or, Socrate est né à l’apogée d’Athènes. Autrement dit, elle s’est construite sans les enseignements socratiques et, au contraire, elle a entamé son déclin au moment où Socrate pouvait déambuler dans une ville désarmée pour y discuter des idées. Il semblerait que, si la technique est indéniablement une source de puissance militaire, elle est aussi un moyen de favoriser le confort et un outil de contrôle à l’intérieur de la cité.
La technique apparaît dès l’origine comme ce qui produit un type d’homme. Alors que la lance d’Archiloque prolonge le corps ; la flotte d’Athènes prolonge la cité. Elle permet le commerce, mais amollit peut-être ceux qu’elle sécurise. Déjà se dessine le paradoxe central : la technique accroît la puissance extérieure tout en risquant d’affaiblir la vitalité intérieure.
Remerciement spécial à @Athens_Stranger dont la série d’explications philosophiques sur la technologie et le nihilisme ont en partie guidé le choix de la sélection des textes présentés dans ce recueil, ainsi que la réflexion menée dans l’introduction les présentant. Je vous encourage à vous inscrire à son site Athens Corner qui regorge de contenus d’une qualité rare.