Cet article est une réponse à la critique émise par Europagande sur l’ouvrage Traité Néoréactionnaire. Il est conseillé de la lire en premier.
Bonjour Europagande, avant toute chose, j’aimerais commencer par te remercier d’avoir pris le temps de produire cette critique étayée permettant de mettre en avant ce que tu vois comme des dissensions entre ta vision du monde et celle que je propose dans mon ouvrage. Je ne saurai témoigner combien je suis en attente de ce genre de discussions. C’est l’occasion pour moi de clarifier ma pensée. Malheureusement, pour les avoir, il faut trouver une personne capable de pleinement comprendre le fond du propos de mon livre. Nous sommes tous coincés dans nos propres perspectives. Lorsque nous lisons un auteur, nous ne pouvons jamais pleinement le comprendre, car nous ne pouvons jamais sortir de notre subjectivité. Nous projetons nos propres connaissances sur les propos de l’auteur. Mon but via cette réponse est alors d’engager un dialogue avec toi, dont cette première partie tendra à expliciter mon point de vue là où je pense que tu as une compréhension partielle de mon propos. J’ai bon espoir que tu trouveras dans ces explications de quoi voir que nos points de vue ne sont pas aussi différents que tu as l’air de l’imaginer a priori. Je suis en réalité souvent d’accord avec le point de vue que tu exposes dans ta critique, pour la simple et bonne raison que tu entends l’opposer à un propos que tu crois être le mien, mais qui n’est pas le mien. Je ne doute pas qu’il restera à la fin des dissensions, mais j’espère qu’à la fin de ce premier message, ces différences relèveront de réelles oppositions et non de simples malentendus.
Je dois dire en premier lieu que je fus surpris de voir que tu entends formuler une critique, non pas seulement de mon livre, mais de la néoréaction en général, à partir de la lecture de mon livre. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que tu n’as pas lu les auteurs phare de la néoréaction et que bon nombre de critiques que tu leur adresses dans ton article initial ne devraient viser que mon livre. Tu dis que mon livre « présente une synthèse de la structure conceptuelle du mouvement “NRx” ». Toutefois, ce n’est pas le cas. C’est une vision très personnelle que je livre ici qui ne saurait représenter un canon de la néoréaction. Il n’y a pas en fait de canons de la néoréaction, qui fut un mouvement regroupant des auteurs qui étaient tous en désaccord, qu’on pourrait séparer en trois branches : Les techno-commercialistes, les ethno-nationalistes et les traditionalistes. Le seul projet de critiquer la néoréaction en tant que mouvement unifié est déjà voué à l’échec. Les critiques que tu formules de la néoréaction sont donc seulement valables pour mon ouvrage et il me semble crucial de l’indiquer.
Tu parais cependant avoir globalement cerné ce qui m’occupe au fil de la première partie qui vise à poser une nouvelle perspective me permettant de réévaluer des concepts que Nietzsche a délibérément mis de côté. Je n’ai pas pour but de réconcilier la métaphysique occidentale avec ces idées cependant. Je crois que cela t’amène à voir ceci de ton côté et choisit de formuler ta critique autour de cela, mais ce n’était pas mon but. Je crois que cela t’amène parfois à me prêter des façons de penser qui me sont étrangères. Toutefois, je comprends pourquoi tu formules cette critique. Je pense qu’elle est justifiée. On pourrait dire que là où Heidegger se content de parler d’être-au-monde, je déploie une vision du monde qui met en avant un être-pour-le-monde. Le point de départ de ma pensée a débuté par la science, et en particulier la thermodynamique et la théorie de l’information qui sont deux domaines ayant en leur cœur l’idée d’entropie. Ce n’est que par la suite que j’ai remarqué comment mes réflexions partant de cette origine tendaient à se croiser avec ces différentes traditions philosophiques. Certains y verront un apport pluridisciplinaire, quand d’autre y verront la source du problème qui t’occupe. La science prétend à l’objectivité quand Nietzsche, et encore plus Heidegger, détruisent toute possibilité d’envisager une vérité objective sur laquelle repose non seulement la science, mais aussi la métaphysique traditionnelle.
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Vérité et antiréalisme sémantique
Cette discussion ayant pour but d’être accessible publiquement, j’aimerais faire un rappel rapide de l’évolution de ce point de vue. À la suite de Kant établissant une inversion de la relation subjet-objet, Nietzsche nous enseigne que toute connaissance n’est que perspective produite par un sujet sur un objet et qu’il est impossible de prétendre à une quelconque objectivité, mais Heidegger va encore plus loin en nous révélant que le simple fait de penser cette relation sous le prisme dualiste sujet-objet est déjà fallacieux. Cette relation ne formerait qu’un tout dynamique constituant une façon d’être-au-monde pour un Dasein dont le rapport au monde est conditionné par le temps. Le sens émergerait de la relation dynamique entre le Dasein et l’Être. Il serait alors futile de tenter de dire quoi que ce soit ayant une portée objective. Je crois que c’est la critique principale que tu formules à l’idée d’entropie qui, par sa valeur universelle, serait une tentative de réintroduire une réalité objective découlant de lois universelles qui détermineraient un Bien universel auquel les sociétés devraient se conformer.
Je vais tenter d’expliciter mon propos afin de mettre en avant là où je crois qu’il pourrait être mal compris de ta part. Tout d’abord, je dois reconnaître que je suis d’accord avec Nietzsche sur les limites du langage. Je suis ce qu’on pourrait appeler un antiréaliste sémantique. Je crois que les énoncés sur la réalité n’ont pas de vérité objective, mais dépendent de cadres conceptuels ou linguistiques. Mon but est plus d’affirmer que la vérité est toujours subjective et découverte a posteriori de l’action. Tu fais souvent allusion à la Vérité dans ta critique, et imagine que les néoréactionnaires affectionneraient l’idée d’une « Vérité de nature transcendantale ». La Vérité, ne recouvre pas chez moi l’idée d’une chose fixe à découvrir. Tout ce qu’on nomme vérité a priori ne peut être que tautologie respectant la simple validité des termes du langage employé. La vérité n’est pas chez moi quelque chose qui existe a priori et à laquelle on se conforme. Nous créons la vérité, en cela qu’il est possible de formuler des énoncés qui ont du sens, et ce sens se trouve dans son rapport avec l’environnement. Les mots permettent d’encoder des faits passés qui sont le résultat d’une expérience au sein d’un environnement. La vérité ne peut absolument rien dire du futur ou de quoi que ce soit de transcendantal au sens métaphysique ou au sens kantien. De la même façon qu’il y a des gènes bénéfiques ou délétères, il y a des vérités et des faussetés qui encodent convenablement ou pas, le résultat d’une expérience du monde réel. Dire cela, c’est admettre que tout est toujours subjectif et local, car des gènes peuvent être considérés délétères dans un environnement, mais présenter un aspect bénéfique dans un autre. Je prends l’exemple de la drépanocytose qui est une maladie génétique qui, dans un certain environnement et à un certain moment donné, est bénéfique, mais pas dans un autre. J’en viens à parler de façon plus générale de l’information pour faire le lien entre les gènes et les mèmes qui sont des supports pour l’information et j’en arrive ainsi à faire le lien entre vérité, information et être. Ce que tu es est le résultat d’une lente construction et sélection d’information atomique, génétique et mémétique. Cette sélection fut établie à chaque étape en relation avec la valeur qu’elle représente au sein d’un environnement donné. Il n’y a pas de Vérité, mais je crois qu’il existe des vérités qui sont subjectives et ont du sens localement dès lors qu’on partage un environnement et un langage commun. Si nous ne vivions pas au sein d’un environnement partagé, il n’y aurait tout simplement aucune possibilité de se comprendre, car aucune possibilité d’avoir des référents communs. Or, je crois que dès que nous choisissons d’user du langage, nous choisissons de communiquer un message à d’autres personnes exprimant notre subjectivité sur une chose que nous partageons. Tout message revêt alors une certaine forme de prétention à l’objectivité par la nature de cette volonté de se faire comprendre par un extérieur à soi et, au sein de ces cadres conceptuels et linguistiques, nous pouvons avoir une conception commune de ce qui est vrai ou non. Même si nous disons « Il est impossible d’être objectif », ce message prend une tournure d’objectivité. Même quand Nietzsche affirme qu’il ne peut y avoir de vérité objective, mais imagine dans le même temps que le monde dans son essence est Volonté de puissance, son propos prend de facto une tournure de vérité à vocation universelle. Heidegger lui reprochera d’ailleurs de tomber dans une métaphysique subjective avec la Volonté de puissance, comme tu l’as remarqué, mais même quand Heidegger choisi d’utiliser le mot Dasein, afin de désigner non pas l’humain, mais l’entité qui a la particularité de se poser la question de son propre être, il ne peut échapper à la production d’une convention langagière devenant une catégorie généralisante. Cette désignation a tout de même une particularité, elle désigne une chose qui est par nature unique et singulière. Chacun aurait son propre Dasein, mais Heidegger effectue déjà ici une généralisation. Dire « Chaque Dasein a son propre Dasein » revient déjà à énoncer une phrase qui est censée avoir une valeur objective. Si tu penses qu’Heidegger a raison et que tu souhaites que j’adopte ce point de vue, c’est parce que tu penses qu’Heidegger a plus raison que moi et qu’il existe une façon d’évaluer la valeur d’un énoncé qui nous est commune. Il en va de même avec l’idée d’entropie. Mais ce qui dérange encore plus dans l’idée d’entropie, c’est qu’au contraire de termes comme la Volonté de puissance ou le Dasein, elle a vocation à être une propriété de l’univers, lui conférant effectivement une prétention encore plus forte à l’objectivité, et elle se dote de mesures quantifiables pour le faire. Ceci peut être vu comme une qualité, ou comme un défaut. Cela effraie beaucoup de gens, surtout les amoureux de la liberté et ceux qui ont tendance à se méfier du langage et encore plus des chiffres, car il y a un aspect tyrannique à proposer une conception du monde qui peut être quantifiée. Cette particularité pourrait conduire à voir l’entropie comme un critère objectif attribuant une valeur à toutes les choses du monde et à aspirer à le diriger de façon autoritaire, mais c’est ici mal comprendre ce qui se cache derrière l’idée d’entropie.
Je voudrais partager ce texte de Nick Land, qui résume très bien ; 1) Pourquoi il est fallacieux de prétendre qu’un énoncé critiquant l’universalisme prouverait l’universalisme, 2) Pourquoi l’idée d’entropie détruit la possibilité de l’universalisme.
“Contre l’universalisme
Il existe une objection philosophique à tout refus de l’universalisme qui est bien connue pour ses autres utilisations (la dénonciation du relativisme, le plus typiquement). Elle ne nécessite qu’une seule étape : La négation de l’universel n’est-elle pas elle-même une revendication
universaliste ? Il s’agit d’une dialectique malveillante parce qu’elle exige que nous soyons d’accord. Nous ne sommes pas et ne serons jamais d’accord. L’accord est la pire chose qui puisse arriver. Il suffit d’admettre sa nécessité pour que le communisme mondial, ou quelque chose d’approchant, en soit la conclusion implicite.
S’il existe une vérité universelle, elle n’appartient qu’à Gnon, et Gnon est un Dieu occulte. Les théistes traditionnels seront au moins fortement enclins à ne pas être d’accord – et c’est une excellente chose. Nous sommes déjà en désaccord, et nous venons à peine de commencer.
Il n’y a pas de « bonne vie pour l’homme » (en général) – ou s’il y en a une, nous n’en savons rien, ou pas assez. Même ceux qui sont persuadés qu’ils savent, au contraire, ce que devrait être une telle vie, n’en promeuvent l’universalité qu’au prix d’être privés de la possibilité de la poursuivre. Si nous devons nous mettre d’accord sur les grandes lignes d’un tel modèle d’existence humaine, il faudra d’abord parvenir à un accord – et « parvenir à un accord », c’est de la politique. Un monde beaucoup plus vaste acquiert un droit de veto sur le mode de vie que vous choisissez, ou que vous acceptez, ou dont vous héritez (les détails n’ont pas besoin de nous retenir). Nous avons vu ce que cela donnait. Le
communisme mondial est la destination inévitable.
L’alternative à l’accord est le schisme. Sécession, désintégration géopolitique, fragmentation, scission – le désaccord échappe à la dialectique et se désintègre dans le néant. L’anti-universalisme, concrètement, n’est pas une position philosophique mais une affirmation effectivement défendable de la diversité. Du point de vue de l’universel (qui n’appartient qu’à Gnon, et jamais à l’homme), c’est une expérience. Le degré de confiance qu’il a en lui-même n’a pas d’importance pour ce qui est au-delà de lui-même. Il n’a de comptes à rendre qu’à Gnon. Ce que n’importe qui, n’importe où, pense de lui ne compte pour rien. S’il échoue, il meurt, ce qui ne devrait rien changer pour vous. Si vous êtes obligé de vous intéresser à l’expérience de quelqu’un d’autre, c’est qu’il y a un schisme. Bien sûr, vous êtes libre de lui dire que vous pensez qu’il échouera, en mode erreur de compatibilité, si elle vous écoute, mais il n’est absolument pas nécessaire de parvenir à un accord sur la question. C’est ce que signifie finalement le non-communisme.
Le non-universalisme, c’est l’hygiène. C’est l’évitement pratique des conneries des autres. Il n’y a pas de principe supérieur en philosophie politique. Toute tentative visant à instaurer son alternative et à imposer un universel revient à la dialectique, à la communisation, à l’évangélisme mondial et à la politique totalitaire.
Nous le disons ici, parce que la NRx est terriblement mauvaise dans ce domaine, et qu’elle dégénère en un conflit d’universalismes, comme en un équilibre instinctif. Il y a même des gens qui proposent avec assurance une « solution NRx » pour le monde. Rien n’est plus absurde. Le monde – dans son ensemble – est une poubelle d’entropie. Le communisme le plus profondément dégradé est son seul « consensus universel » possible. (Tout le monde le sait, quand il se permet de réfléchir).
Tout ordre est local – ce qui équivaut à la négation de l’universel. Il s’agit simplement de réaffirmer la deuxième loi de la thermodynamique, que « nous » prétendons généralement accepter. La seule chose qui pourrait être universellement et également distribuée est le bruit.
Tuez l’universalisme dans votre âme et vous êtes immédiatement (objectivement) un néoréactionnaire. Protégez-le, et vous êtes un obstacle à l’émancipation des différences. C’est cela le communisme – que vous le reconnaissiez ou non.”
Nick Land
Comme je l’ai dit, la néoréaction n’a pas de canons, et comme le pointe Land, l’universalisme y est présent, mais pas chez lui, ni chez Yarvin qui nomme la religion qui tue l’Occident l’Universalisme. Nous laissons la vérité universelle à Gnon, car nous savons que toute vérité ne peut-être que locale et une simple perspective. Il est vrai que je dis de mon côté que l’accélérationnisme est universaliste et identitaire, car il repose sur la seconde loi de la thermodynamique de façon universelle, qui est la source des ordres locaux identitaires. C’est sûrement une erreur. Je ne devrais même pas dire “universaliste”. Cela découle d’un principe universel, mais l’accélérationnisme n’est pas universaliste pour autant. Je parle finalement d’individuationnisme pour signaler comment de ce chaos universel naissent les identités ordonnées particulières, mais je célèbre l’ordre et non le chaos, donc l’identité et non l’universalité. Ce que je trouve de pertinent dans cette façon de poser les choses est justement de dire que ce que nous pouvons avoir de plus universel nous enseigne que l’universalisme est impossible. Je reviendrais sur l’identité plus tard.
Lumières
SOMBRES
Ebook d’une traduction du texte clé
de Nick Land, offert à nos tipeurs
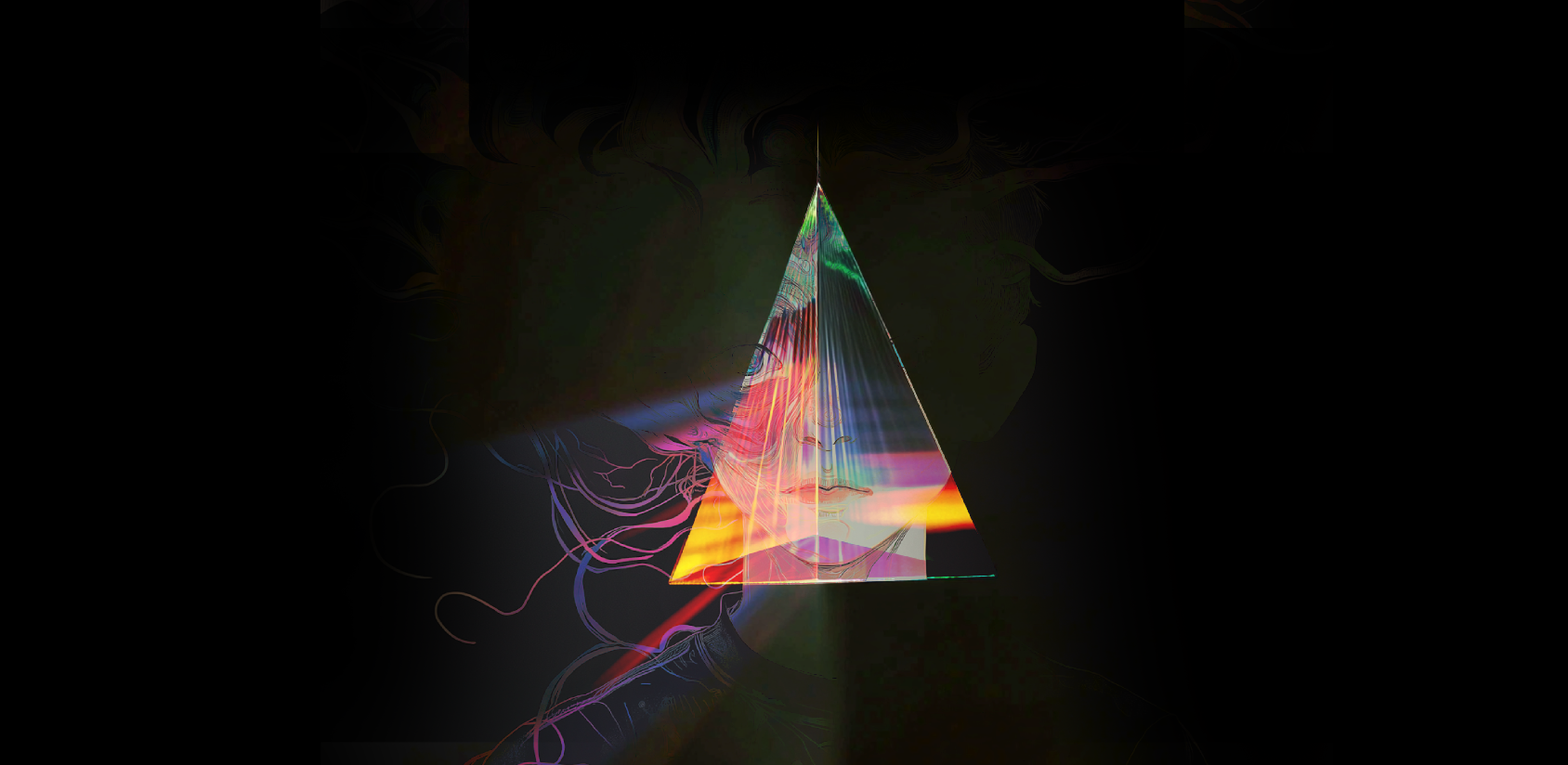
Lumières
Sombres
Ebook d’une traduction du texte clé
de Nick Land offert à nos tipeurs
Réalité et antiréalisme épistémologique
Avant d’expliciter ce qu’est l’entropie et pourquoi je pense que la réflexion que je mène peut toutefois rejoindre ce que dit Heidegger, je voudrais dire un mot sur la réalité que tu me reproches de qualifier d’objective avant de me dresser un procès en kantisme. Je dois te faire une concession ici. Je crois que, de manière plus générale, mon expression est encore trop kantienne, alors que ce que je pense réellement ne l’est pas. Je dis effectivement dans mon livre que la réalité est objective et que nous avons une perspective sur cette dernière, c’est-à-dire qu’elle existe indépendamment de nous, mais que nous ne pouvons jamais la saisir. Ma volonté est surtout de rejeter un idéalisme pur qui voudrait que le monde soit la production de notre esprit. J’ai choisi d’utiliser dans le paragraphe précédent le mot environnement plutôt que réalité pour ne pas induire en erreur. Je crois que ce fut la cause d’un malentendu te conduisant à formuler ta critique d’un retour à une métaphysique classique dualiste, mais je crois que cette critique peut être dépassé par cette reformulation. Ce que je veux dire par ici est simplement que je crois qu’il existe un monde extérieur à nous qui nous a précédé et qui nous survivra. Je crois que le monde continuera d’exister après ma mort. Je ne crois pas qu’il existe une réalité fixe que nous découvrons sans la modifier comme tu présentes la métaphysique traditionnelle de ton côté. Si je m’appuie dans mon livre d’abord sur la thermodynamique et la théorie de l’information, j’en arrive rapidement à parler de la cybernétique et la mécanique de quantique de Wheeler qui abolissent toutes les deux la relation sujet-objet. La cybernétique met en avant comment un système est le fruit d’une auto-organisation effectuée via son environnement, rendant floue toute distinction entre un sujet et un objet, et la mécanique quantique l’abolit de son côté lorsqu’elle s’est rendue compte qu’il était impossible de séparer le sujet et l’objet étudié, car le sujet fait partie de l’expérience même. Nous ne sommes jamais de simples observateurs, même dans nos expériences scientifiques. J’ai mis en avant ces différentes conceptions dans l’article suivant. En plus d’un antiréaliste sémantique, je suis alors ce qu’on pourrait qualifier d’un antiréaliste épistémologique. Je pense que la science ne parle pas de ce qui est réel dans la nature, mais de notre connaissance sur cette dernière et j’affirme que la connaissance est toujours subjective. Prenons l’exemple de l’observation d’un atome. S’il y a quelque chose à connaître sur l’atome, nos méthodes de production de la connaissance souffrent d’un problème puisque nous ne pouvons seulement le comprendre dans ses interactions. Or, lorsque nous l’observons, nous faisons partie intégrante de cette interaction. Nous ne pouvons alors qu’obtenir la connaissance de notre interaction avec l’atome et non de l’atome en lui-même, donc de notre relation à l’instant t avec ledit atome, et non l’atome lui-même. L’atome ne serait pas une pure production de notre esprit, mais la connaissance de l’atome en tant qu’objet nous serait inaccessible. C’est une position moins catégorique que celle de personnes comme Niels Bohr qui pensent que les propriétés attribuées aux particules ne sont pas inhérentes à ces objets et n’existent que dès lors qu’on les mesure, car créées par notre interaction avec elles. Alors que ces antiréalistes radicaux en arrivent à remettre entièrement en question la réalité, j’affirme simplement de mon côté que la réalité existe indépendamment de nous, mais que la connaissance qu’on en a ne peut pas être séparée du sujet. Je pense que c’est ceci que tu vois comme kantien, car on pourrait dire que l’atome existe en soi, mais qu’on ne peut jamais savoir que ce que représente l’atome pour nous. Il me semble qu’au-delà de cette distinction, nos conclusions ne sont pas si différentes, et que cette dissension relève plutôt de l’usage de termes appartenant à des corpus linguistique différents. Du moins, il ne me semble pas qu’Heidegger rejette jusqu’à l’existence d’un environnement partagé, même si nous lui conférons un sens différent. J’admets alors qu’on n’a jamais qu’une perspective sur le monde, j’admets aussi que nos connaissances scientifiques ne sont jamais que des moyens de capturer la connaissance de notre interaction avec le monde. Toutefois, la méthode scientifique révèle une chose particulière. À l’échelle macroscopique, deux expériences identiques, conduites dans les mêmes conditions, par deux chercheurs différents, donneront le même résultat, dès lors qu’ils suivent la même méthodologie. Cela signifie que j’obtiendrai le même résultat si j’étais le sujet procédant à l’expérience. La connaissance produite est donc valable pour moi aussi. Il se trouve que l’entropie est un phénomène qui n’a de sens qu’à l’échelle macroscopique et que c’est une connaissance scientifique solide. C’est pourquoi je dis dans l’ouvrage que même si notre capacité à comprendre le monde qui nous entoure est limitée et perspectiviste, je crois comme David Chalmers qu’il existe des vérités sur la réalité que l’on peut partager. La méthode scientifique montre que, bien que le chercheur fasse partie de l’expérience quand il étudie un objet, l’identité du chercheur n’a en revanche aucune importance et que la réalité revêt une stabilité suffisante pour qu’il existe des connaissances qu’on puisse acquérir sur la réalité. Si ce n’était pas le cas, alors soit la réalité serait trop changeante, soit l’identité du sujet importerait, mais la reproductibilité des expériences prouve l’inverse. Seule la méthode compte. L’entropie en fait partie. Autrement dit, tout le monde devrait pouvoir intégrer cette connaissance à sa perspective. Il serait inadéquat à mon sens de tomber dans un relativisme rejetant la méthode scientifique et ne pas tenir compte de l’entropie quand on souhaite proposer une vision du monde cohérente, simplement parce qu’elle revêt un aspect universel qui ne sied pas à nos considérations politiques.
Entropie : De la Thermodynamique à la Théorie de l’Information
Venons-en à l’entropie à présent qui est au cœur de la cybernétique. L’entropie est une notion qui est très mal comprise. Elle est effectivement souvent abordée sous l’angle de la thermodynamique pour évoquer le degré d’ordre mesurable dans un système. Il est convenu que l’univers se dirige vers toujours plus d’entropie et produit des entités réduisant leur entropie localement que l’on nomme des structures dissipatives, mais maximisant la production d’entropie générale. Cela laisse penser que l’entropie aurait la prétention d’être une mesure universelle et objective. Toi-même dans ton texte, tu ne l’abordes que de ce point de vue et je crois que c’est ici ce qui t’empêche de voir que nous ne disons rien de bien différent. Il faut en réalité comprendre cette notion à l’aune de la théorie de l’information qui nous dit que l’entropie d’un système représente le degré d’incertitude ou l’information manquante sur ledit système pour un observateur-participant. Comme l’énergie, l’information est elle aussi soumise à l’entropie et on observe que la dissipation d’énergie correspond à l’effacement d’information. L’information est donc, elle aussi, quantifiable. Dit comme cela, on imagine encore un observateur extérieur à un système tentant de le comprendre. Il n’en est rien. De la même façon que le Dasein est jeté dans le monde, l’observateur-participant est plongé dans un système de systèmes le précédant. Ces systèmes constituent son monde.
Lorsque je dis que les humains sont des structures dissipatives, il faut comprendre que le propre d’une structure dissipative est de capturer et traiter de l’information sur son environnement afin maintenir et augmenter son ordre via les flux d’énergie utilisés. Cela conduira à dissiper l’énergie et c’est pourquoi on peut voir les humains comme des systèmes thermodynamiques ouverts et imaginer que la lutte pour la survie darwinienne est en réalité une lutte pour la dissipation d’énergie. À partir de ces observations, on peut facilement retomber sur des propos nietzschéens en prenant les choses sous cet angle purement énergétique. Le monde pourrait être vu dans son essence comme une lutte pour maximiser les flux d’énergie libre à dissiper, c’est-à-dire, maximiser la réduction d’entropie locale, que l’on nomme extropie. L’extropie, qui est un mot sans prétention scientifique, mais est utilisé pour désigner la réduction d’entropie locale d’un système, serait au cœur de l’univers et des structures dissipatives comme la Volonté de puissance l’est pour Nietzsche. La seule différence avec Nietzsche, c’est effectivement que cela s’accompagne d’une notion universelle, l’augmentation de l’entropie générale de l’univers. On pourrait questionner jusqu’à la pertinence d’un mot tel que celui d’univers qui implique déjà des présupposés. On pourra lui préférer le terme de monde. Tout cela semble très froid et mécanique, n’est-ce pas ? Mais, qu’est-ce que cela fait d’être un de ces systèmes en tant qu’humain, ou Dasein ? Bien que ce procédé semble mécanique lorsqu’on l’énonce ainsi, on ne saurait réduire ces phénomènes à l’aspect énergétique et on ne saurait réduire les humains à cela pour autant. Capturer et traiter de l’information est le propre des systèmes cybernétiques. Les structures dissipatives sont des systèmes cybernétiques, c’est-à-dire qu’elles s’auto-organisent en capturant de l’information sur leur environnement leur permettant de maintenir leur ordre. L’environnement est lui-même un système supérieur qui tend à réduire son entropie. Ainsi, même en admettant qu’il n’y aurait pas à proprement parlé d’univers, on peut imaginer que nous sommes le fruit d’un monde qui veut quelque chose et que notre être doit être pensé dans cette relation que l’on entretient avec cette volonté. Une fois ceci énoncé, il pourrait sembler que le grand absent soit toujours le sens. Or, l’information ne peut pas être séparée du sens. Dans la théorie de l’information, l’entropie mesure l’incertitude avant qu’un message ne soit reçu, et sa réduction correspond à un gain de sens. Capturer de l’information revient à découvrir notre monde afin de lui donner du sens pour nous dans le but de maintenir notre être selon notre être-au-monde pour parler en terme heideggeriens. On cherche à s’approprier le monde dans le but de développer notre être. Bien que notre perception du monde soit limitée, ce monde existe en-dehors de nous.
Cybernétique et Temporalité
Cet aspect passif que tu me reproches dans l’aspect d’observateur de l’« observateur-participant » n’est en fait pas absent chez Heidegger. Heidegger utilise des termes comme « ouverture » ou « clairière » pour décrire le Dasein comme un espace où l’Être se dévoile. Ce dévoilement est en partie hors du contrôle du Dasein, car il dépend de l’Être lui-même, qui se donne et se retire. Par exemple, le Dasein ne décide pas arbitrairement qu’un arbre « est » un arbre ; il le rencontre dans un monde où l’arbre se manifeste comme tel. Il est à la fois observateur de la présence de l’arbre et participe à conférer un sens à cette présence dans l’espace au sein d’une temporalité. Le Dasein n’invente pas l’Être, mais est plutôt le lieu où l’Être se montre. La manifestation de l’Être est liée à la temporalité du Dasein, mais cette temporalité n’est pas un acte volontaire. Le Dasein est « jeté » dans le monde, c’est-à-dire qu’il n’a pas choisi d’exister ni les conditions de son existence. Il est aussi orienté vers la mort, une possibilité qu’il ne peut contrôler. Ainsi, l’Être se manifeste à travers cette structure existentielle, et non par un acte de volonté conscient. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il y a nous et le monde, inscrits dans une relation temporelle, comme le remarque Heidegger. Mais qu’est-ce que le temps ? Il peut lui-même être vu comme le produit de l’entropie. La flèche du temps est intimement liée à l’entropie, car l’entropie est statistique. L’entropie, en physique statistique, mesure le nombre de micro-états pouvant être associé à un macro-état. Plus il existe de micro-états possibles, plus le système est entropique. L’entropie maximale est statistiquement l’état le plus probable. Nous faisons l’expérience du temps, car l’univers a une tendance à aller vers le plus probable, vers plus d’entropie. Ce qu’Heidegger aborde en tant qu’Être et Temps fait état du point de vue personnel d’une entité particulière qui fait l’expérience de la lutte contre l’entropie, c’est-à-dire de combattre localement et temporairement l’effet du temps. Cela signifie réduire son entropie localement au sein d’un univers où l’entropie, est la règle et faire l’expérience de sa finitude. Je ne crois pas que cela soit en opposition avec le propos d’Heidegger. Ce qu’Heidegger envisage comme une particularité du Dasein, penser son être-au-monde est en fait commun à tout système cybernétique qui vise à capturer de l’information sur son environnement afin de se maintenir dans le temps et se développer. Cette information doit avoir du sens pour cette entité. La particularité du Dasein est simplement de le faire mieux que d’autres entités en conférant un sens différent.
Tu penses que je réduis le dévoilement à un processus cognitif. Ce n’est pas le cas. J’indique que par ses facultés cognitives, un sujet peut capturer de l’information, mais ce faisant, il va imaginer les possibilités d’un dévoilement ontologique. J’affirme que l’information est un arrière-plan ontologique. Dans la théorie de l’information quantique, l’information est vue comme un élément de base qui sous-tend les phénomènes physiques. Je réintroduis donc un aspect métaphysique, mais je ne dis pas que cet arrière-plan informationnel existe dans un “autre monde”. C’est ce que je tiens philosophiquement pour l’Être. Ceci m’amène à dépasser Heidegger dans ma propre conception de l’Être, et j’entends que tu vois cela de ton côté purement et simplement comme une usurpation par cette réintroduction d’un aspect métaphysique. Je sais qu’on ne sera pas d’accord là-dessus et que tu me diras que c’est juste ma perspective. Effectivement, nous avons une perspective différente ici. Le dévoilement de l’être est pour moi la façon dont l’information primordiale est utilisée pour s’incarner dans des entités mondaines. Le travail cognitif sert à cette incarnation dans des mèmes, mais la sélection génétique participe aussi de ce dévoilement. L’aspect cognitif n’est qu’un moyen de sélectionner parmi les possibilités de l’être laquelle porter à l’existence, et encore, dans la limite de notre contrôle. Contrairement à Heidegger, je ne sépare pas les choses entre authenticité et inhautentiticté, mais entre possibilités entropiques ou extropiques, les plus extropiques étant les plus singulières. C’est ici aussi une question de temporalité et de préférence temporelle et c’est pourquoi le futur influence le présent dans ma vision des choses. Par l’imagination, je peux identifier un futur entropique où je suis fumeur, alcoolique divorcé et obèse… Je vais l’éviter dans le présent en ne prenant pas la première cigarette et en allant à la salle et me diriger ainsi vers un dévoilement plus extropique. Toutefois, tout n’est pas sous mon contrôle et peut-être que je deviendrais ce que je redoute. Cela rejoint l’authenticité de Heidegger par certains aspects, car pour lui l’inauthenticité est de se cacher derrière le “on”, de ne pas assumer sa singularité. Or, l’extropie est une singularité alors que l’entropie est une médiocrité normale. En dernière instance, l’intelligence est la capacité à imaginer plus ou moins loin le futur. Plus d’intelligence est le moyen chez moi de sélectionner les meilleures possibilités de l’Être, mais l’intelligence n’est pas un simple travail cognitif, elle est manifestée dans tout système extropique. Cette question d’authenticité vaut alors aussi pour la technologie. Je ne crois pas que la technologie soit inauthentique. Je crois qu’il existe des usages de la technologie qui sont entropiques et d’autres extropiques, mais je crois que plus d’intelligence est mieux que moins d’intelligence et que l’intelligence artificielle est une très bonne nouvelle.
Le Moment
Straussien
Ebook offert à nos tipeurs
sans montant minimum
Le Moment
Straussien
Ebook offert à nos tipeurs
sans montant minimum
Grand Récit et efficacité
La cybernétique entend parler de tous les systèmes et ce qu’ils ont de commun alors qu’Heidegger souhaite parler de l’expérience particulière du Dasein en partant de sa propre expérience intérieure. Les deux approches ne sont pas mutuellement exclusives, mais je comprends que cette approche systémique puisse coincer pour un heideggerien qui me répondra que cette systématisation n’est jamais elle-même que la production d’un Dasein prétendant à une objectivité illusoire. Il n’y a pourtant pas tant de différence que cela à généraliser le Dasein sur un critère particulier et généraliser les systèmes sur un autre critère encore plus générique, tout en affirmant que chaque système est différent et a sa propre manière de réduire son entropie. Dire qu’il existe quelque chose de commun à tous ces systèmes ne saurait invisibiliser la particularité des humains, et même de chaque individu.
Je vais donner un exemple d’une situation pour montrer comment les deux grilles de lectures peuvent s’appliquer. Imagine que tu as un rendez-vous chez le docteur, car tu veux lui parler d’un symptôme inquiétant, comme la présence de sang dans tes selles. Ce symptôme constitue une information sur ton système. Ton docteur va prendre connaissance de cette information et la recouper avec les autres informations dont il dispose sur toi comme ton âge, ton sexe, tes habitudes, etc. et il va peut-être te demander « Depuis combien de temps avez-vous observé cela ? ». Ceci constituera une nouvelle information nécessaire à son diagnostic. Il effectuera sûrement une observation, un toucher rectal, pour voir si cela provient d’hémorroïdes, et finalement te dira « Nous devons effectuer plus de tests. Je vais vous demander un échantillon de vos selles à envoyer au labo ». Il a besoin de plus d’information pour t’éviter de filer tout droit vers l’entropie, c’est-à-dire un état où ton corps cessera d’échanger les flux d’énergie nécessaires au maintien de sa structure, c’est-à-dire, la mort. Si tu lui demandes « Qu’est-ce que cela signifie ? », il ne te parlera pas d’entropie bien sûr, il te dira que tu as des chances d’avoir un cancer du côlon et qu’il veut pouvoir vérifier ce diagnostic. Toutefois, s’il est plus philosophe, il pourrait te dire qu’en tant que Dasein tu es un être-pour-la-mort et que tu vas faire l’expérience de l’angoisse en ayant pleinement conscience de ce rapport à la mort. J’imagine que tu ne lui répondras pas qu’en tant que Dasein, que les chiffres qu’il pourrait avoir pour ses analyses n’ont pas trop de sens puisqu’ils ne sont jamais que le produit d’une prétention à l’objectivisation de la science reposant sur l’expérience d’autres Dasein, des conventions qui n’indiquent pas qu’elles puissent s’appliquer à ton cas puisque chaque perspective est unique. Tu confèreras du sens à ces chiffres qui t’offrent une information capitale permettant de maintenir ton être éloigné de l’équilibre thermodynamique et tu écouteras le docteur, même si dans l’absolu, d’un point de vue philosophique, Heidegger a raison. Cette information aura du sens et une importance à l’instant t, la même information n’en auras pas pour moi. On ne peut pas séparer l’information du sujet et de son rapport au monde. Il n’y a pas de recette clef en main pour réduire l’entropie, car la notion d’entropie ne peut pas être séparée de celle de l’observateur-participant qui participe à construire l’information, c’est-à-dire à conférer du sens.
Par cette approche, je ne cherche pas à retirer quoi que ce soit à la proposition heideggerienne qui me semble pertinente. Dire que l’homme est un système cybernétique ne dit en rien ce que cela fait d’être ce type de système cybernétique particulier et Heidegger fait un travail remarquable pour l’exprimer. Cela rejoint ce que l’on nomme le problème difficile de la conscience. Nous ne savons pas ce qu’est la conscience en réalité. Si je te mets des électrodes sur le crâne pour observer ton activité cérébrale au moment où tu manges une pomme, je pourrais observer l’activation de flux électriques dans certaines zones. Toutefois, cela ne me renseigne en rien sur l’expérience que tu ressens en mangeant une pomme. Heidegger choisit de décrire le ressentit du Dasein mangeant une pomme, et il est très méfiant des gens tentant de parler de ce sujet en observant les zones du cerveau activé, car cela conduirait à un désenchantement du monde venant capturer le fonctionnement dans le détail tout en oubliant l’expérience vécue, ce que cela fait d’être. Je ne retire rien à Heidegger, mais je crois que la cybernétique nous renseigne sur une chose cruciale qui échappe à Heidegger.
Heidegger ne fut pas un très grand fan de la cybernétique. Pourquoi ? pour deux raisons. La première est qu’au-delà de l’aspect quantifiable, cette simple rétroaction de l’environnement induit une notion d’efficacité. Heidegger y voit une façon de s’éloigner de l’authenticité de l’être, mais je crois que c’est un simple romantisme de sa part. Pourquoi dis-je cela ? Dire que le Dasein est jeté dans le monde ne rend pas compte d’un élément capital sur l’existence du Dasein. Il n’est pas jeté dans le monde en réalité, il est le produit d’un lent processus, d’une lente sélection par le monde qui peut être comprise à l’aune de l’information. Les atomes sont un support de l’information, tes gènes sont un support pour l’information, et tes mèmes sont un autre support de l’information. Le sens est dans chacun d’eux. Bien sûr, c’est moi en tant que Dasein qui confère un sens particulier rétrospectivement à ce processus, mais il me parait évident que le processus de dévoilement de l’Être dont parle Heidegger à l’échelle de la finitude du Dasein, s’applique plus largement à l’échelle des générations. Être ne peut pas être séparé de l’expérience que fait le Dasein du monde, mais être ne peut pas non plus être séparé des expériences précédentes qui nous ont conduit à être ce que nous sommes. Tes gènes sont le fruit de l’encodage de l’expérience du monde de tes ancêtres. Pas l’ensemble des expériences, seulement celles qui ont encore du sens pour toi. Dire qu’un gène a du sens signifie qu’il est efficace pour guider le comportement. Imagine une souris dont la capacité à creuser un tunnel dans la terre est encodée dans ses gènes. Cette information a du sens dans son milieu, mais si tu la déplaces dans un endroit bétonné, cela n’a plus de sens. C’est le rôle de la sélection de l’information pertinente. Or, le concept du Dasein jeté dans le monde ne peut pas rendre pleinement compte de ce processus alors que la cybernétique offre un cadre le permettant. Tes gènes furent sélectionnés, car ils entretiennent une relation positive avec le monde qui peut être appréhendée à l’aune de la réduction d’entropie. Le simple fait que le monde ait sélectionné ces gènes plutôt que d’autres témoigne de l’existence d’un sens qui précède le Dasein. Heidegger adopte une position confortable lui permettant de refuser de parler d’efficacité en s’en tenant au concept de Dasein et de son authenticité à l’Être qui n’aurait rien à voir avec l’efficacité. C’est peut-être d’ailleurs ce qui l’a conduit à soutenir les Nazis contre les versions inauthentiques du capitalisme et du communisme, mais au final, le capitalisme l’a emporté, car il était plus efficace, et même si ce n’est pas très heideggerien de le dire, je crois que c’est une règle du monde. Je vois la façon d’Heidegger de détourner le regard de l’efficacité comme un moyen de préserver une caverne mystique dans laquelle il peut se réfugier pour y chercher un autre sens plus poétique. Je fais le choix contraire d’accepter pleinement cet aspect d’efficacité et de chercher un sens à cette nécessité. Cela passe effectivement par ce que tu nommes un Grand Récit, qui observe un mouvement de l’univers qui tend à produire des entités de plus en plus efficaces. Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Je l’ignore, et je ne ressens pas le besoin d’inventer une cause finale de toute pièce, mais cela me suffit pour y voir une téléologie et me dire que la vie n’est pas absurde. Cette acceptation de l’efficacité me pousse à avoir une perception entièrement différente de la modernité et de la technologie qu’Heidegger. Je vois Un monde où tout n’est que flux, mouvement et puissance. Alors les allers-retours des trains et les fusées qui décollent et se posent m’apparaissent comme les ballets du monde moderne. Une Ferrari F40 devient un récital, le moindre petit feu tricolore devient un chef d’orchestre encore supérieur à un allumeur de réverbère. Alors, les individus qui se pressent, commis par le Gestell – et parfois, sans même vraiment savoir pourquoi – nous semblent tout à coup extrêmement moraux. Cela me tient à l’écart de toute pensée traditionaliste voulant que ce fut nécessairement mieux avant.
L’autre aspect est évidemment le fait que l’entropie reste une idée qui a une vocation universelle par nature et tu ajoutes de ton côté qu’elle serait sous ma plume une loi de la nature qui serait appelée à être répliquée au sein de la société. L’entropie est universelle, car nous sommes tous soumis à l’entropie, mais l’extropie est toujours locale et ne suit pas une règle qui pourrait être connue au préalable. Il n’est pas question d’appliquer la loi de l’entropie à la société, mais précisément l’inverse. Ce n’est pas une loi à laquelle se conformer, mais un phénomène que la vie combat localement en redoublant d’ingéniosité. Être, ce n’est pas se conformer à la loi de l’entropie, mais lutter contre l’entropie, donc faire preuve de créativité. Ceci conduit à des structures ayant des propriétés émergentes qui n’existaient pas avant. La seule règle universelle sur laquelle je m’appuie indique qu’il faut sans cesse créer le nouveau, et ce de façon locale, et non universelle.
Horreur
Augmentée
Sélection de textes de
Zero HP Lovecraft
Horreur
Augmentée
Sélection de textes de
Zero HP Lovecraft
Bien et Singularité
« Nous naviguons finalement bien dans les eaux troubles du pire platonisme. Voilà le Bien universel, voilà les règles universelles que tout homme doit suivre universellement, car elles sont des vérités valables pour tous. Tâchez de vous oublier un peu, vous individus. Tâchez de vous mettre en retrait, de vous neutraliser et de vous universaliser. Tâchez de subordonner vos actions à ce Bien que le néo-réactionnaire a pris soin de définir pour vous, car c’est lui votre nouveau pasteur. »
J’aimerais commencer par un mot sur le platonisme. Alors que j’explore la possibilité de Roger Penrose qui imagine que les règles mathématiques existeraient vraiment dans un autre monde, je dis « La Vérité existerait sur un autre plan. Les mèmes que nous créons, seraient évidemment des symboles, mais ils seraient une représentation mentale d’un monde plus fondamental qui existe réellement. Cela signifierait qu’il existe des catégories de mèmes, par exemple les nombres, qui auraient un statut spécial reflétant ce monde mathématique plus fondamental. Mais les mèmes ne sont qu’un support pour l’information, de la même façon que les gènes le sont, alors il ne nous semble pas évident de sauter sur cette conclusion voulant que soudainement, nous aurions créé un type de support permettant d’appréhender un autre monde ». Pour être plus claire, je ne le crois pas du tout. Je ne crois absolument au monde des idées platonicien. Cela me semble incongru que soudainement une entité mondaine aurait trouvé un accès à un séparé du monde sensible. Dans ma vision, les mèmes sont aussi matériels que les gènes. Les mèmes ne sont jamais que des sons ou des symboles, donc des ondes de différentes fréquences, qui ont besoin des conditions matérielles pour exister. Le son ne se propage pas dans l’espace. C’est au sein de la biosphère que les mèmes sont nés, permettant de générer les cultures. Les idées et la capacité d’abstraction des humains sont pour moi une simple capacité à se projeter dans les possibles. Je rejette le platonisme une seconde fois en explorant l’idée de la simulation et dit « Mais alors Platon pourrait aussi avoir raison avec son idée de démiurge. Et s’il y avait effectivement un démiurge tout-puissant, il pourrait faire flamber un buisson sans qu’il ne brûle simplement pour se marrer en observant la réaction du pauvre bougre à qui il joue ce tour… Et c’est ce qui nous dérange un peu dans cette idée. On pourrait être prêt à croire un peu n’importe quoi. Et nous croyons que nous devons être vigilants avec cela. Même si notre capacité à comprendre le monde qui nous entoure est limitée, nous croyons comme David Chalmers que la réalité existe, que la vérité compte et “qu’il existe des vérités sur la réalité” ». Je ne tranche pas sur cette hypothèse, car il est en fait impossible de trancher, mais j’indique qu’à titre personnel, je ne la tiens pas pour vraie. Je ne crois pas à titre personnel que l’information existe sur un autre plan entièrement différent, mais qu’elle est un arrière-plan ontologique, une composante fondamentale de la réalité, mais pas sur un plan entièrement distinct ou séparé. Cela signifie que l’information pourrait être une condition de possibilité de l’existence des choses, intégrée à la structure même de la réalité, plutôt qu’une entité flottant dans un domaine totalement indépendant.
Nous pouvons alors discuter du Bien à présent, mais au risque de spoil un peu, je définis le bien comme la création du nouveau, du singulier, donc je ne vois pas comment tu en arrives à dire que j’ai défini un Bien universel, valable pour tous et auquel se conformer. Je dis « Ce que l’on nomme bon ou mauvais, juste ou injuste, est ce qui favorise respectivement l’extropie ou l’entropie. Une société devrait alors chercher à s’organiser selon de bonnes lois épousant la Loi de l’univers et favorisant le progrès de l’extropie qui passe par la production du nouveau, du remarquable, du singulier. Tout ce qui s’en écarte est mal. » Il n’est pas question ici de dire que le bien est de se conformer à la Loi, mais que la société ne doit pas entraver l’individu créateur du nouveau. Pour donner un exemple concret, je crois que le mouvement de la décroissance qui cherche à imposer une réduction de la consommation d’énergie cherche à instituer une loi qui s’oppose à la Loi de l’univers, et ce faisant, elle entrave l’individu dans la production potentielle du singulier, donc dans sa capacité à faire le bien selon moi. Je ne comprenais pas ce que tu entendais par platonisme, mais je crois que c’est dû à cette phrase « La production extropique du nouveau, du singulier dans le réel, est à chercher par-delà le monde sensible, dans le possible ». Toutefois, je ne parle pas ici d’un monde des idées, mais simplement des possibilités d’un être dynamique. Je dis simplement que le nouveau et singulier est à chercher parmi les possibilités improbables. Par exemple, quand Musk fabrique une fusée capable de revenir au sol contre toute probabilité, cela fait partie de ce type de possibilité. Le bien est toujours singulier chez moi et il est appelé à être créé. Je dis d’ailleurs « Si l’extropie est une réduction locale d’entropie, alors la règle dans l’univers, c’est le Mal. Le Bien, comme réduction du Mal, est l’exception. Le Bien est une singularité. […] la règle fondamentale guidant ce processus est invariable, elle revient à identifier l’entropie afin de favoriser l’extropie ». Quand je parle de Bien absolu, je parle de cette capacité à le définir de façon invariable, mais une fois ceci énoncé, nous n’avons pas dit grand chose. Tout ce que je sais, c’est que le bien est une réduction d’entropie, mais je ne sais pas quelle forme cela doit prendre localement selon des perspectives différentes.
La perception que tu livres de ma conception du bien va alors à l’encontre de mon propos. Se conformer à la règle universelle de l’univers, ce serait se conformer au mal. Je dis évidemment qu’il faut au contraire générer le bien localement. Mais ce dernier ne se réduit effectivement pas à l’individu. Étudions cela. En adoptant un point de vue perspectiviste, on pourrait en arriver à la conclusion que le bien se confond avec ce qui est bon pour moi, ce qui réduit mon entropie ou, pour le dire en termes nietzschéens, ce qui augmente ma puissance. C’est d’ailleurs peu ou prou la conclusion de Nietzsche. Je ne suis pas d’accord, car ma perspective personnelle que je fais reposer sur la cybernétique me permet d’appréhender le monde comme un enchevêtrement de systèmes. Si je mène des actions qui réduisent mon entropie au prix du désordre du système supérieur, est-ce que j’ai fait le bien ? Si je mens volontairement en politique pour m’enrichir au prix du remplacement ethnique de mon peuple pendant que j’obtiens les moyens financiers d’éviter le chaos que je génère, et donc augmente ma puissance, est-ce que j’ai fait le bien ? Est-ce que nous devrions tout simplement ne pas avoir de considération pour le bien ? On pourrait dire qu’au final, on ne veut jamais que notre bien, car détruire l’environnement qui permet notre puissance finira par se retourner contre nous et qu’en professant le bien de la société, c’est toujours le nôtre que l’on cherche. Je pense que cette approche n’est pas sans fondement, mais il est possible d’obtenir les bienfaits de ses mauvaises politiques jusqu’à sa mort. L’histoire ne manque pas d’exemples, et il ne faut pas aller chercher bien loin. Ce n’est évidemment pas une bonne façon d’agir à mon sens, et même Heidegger serait d’accord avec moi pour dire que le Dasein est le fruit d’un monde qui le précède dans lequel il prend place. Alors je crois qu’il faut comprendre le bien à l’aune du monde, de ce qui est extérieur à nous, les systèmes auxquels nous participons, à commencer par nous, puis de façon de plus en plus éloignée de manière concentrique, jusqu’à aboutir au monde quoi que cela puisse signifier. Je veux mon bien, mais je veux aussi celui de ma famille, puis de ma nation, etc. Alors est-ce que le Bien serait l’amour universel comme l’imaginent les chrétiens ? Je ne crois pas. Je ne définis pas le Bien comme l’amour, mais avant de parler de ce que je vois comme le bien, il me faut discuter de l’aspect universel. En aucun cas je ne pars de l’universel pour aller vers le particulier. Vouloir le bien est forcément conflictuel et appelle soit à un équilibre, soit à un conflit. Si ce qui est bien pour moi ne l’est pas pour ma famille, alors je vais chercher un équilibre. Je ne vais pas m’acheter un nouvel iPhone si cela m’empêche de vêtir mes enfants, mais je vais payer pour une consultation chez le médecin pour moi plutôt que de leur acheter un nouveau t-shirt. Évidemment, cela est un exemple facile, car il tombe sous le sens d’aimer ses enfants. Si on imagine une simplification me représentant au sein de systèmes auxquels j’appartiens partant de moi-même, puis ma famille, ma ville, ma nation, ma civilisation, la biosphère, le système solaire, la Voie lactée et l’univers dans ses parties constituant la fin de mon monde connaissable, il est évident de voir que cela implique de nombreuses entités potentielles pour le conflit. Quelle considération dois-je avoir pour un Pakistanais avec qui je partage la biosphère, mais qui ne fait pas partie de ma civilisation et encore moins de ma famille ? Je crois que je n’ai pas spécialement de considération à avoir pour lui, je ne vais pas aller lui chercher conflit chez lui, mais s’il vient chez moi et rend les choses conflictuelles, alors il n’y a pas d’équilibre à chercher non plus. La règle est la non-agression autant que faire se peut, mais cela ne signifie pas rejeter la violence. Toutefois, le bien ne peut pas être réduit à la non-agression. Il ne me semble pas que quelqu’un ait particulièrement fait le bien simplement en passant sa vie à ne pas agresser. Il me semble que pour comprendre ce qui est bien, il faut partir de ce qu’est l’entropie dans ce qu’elle a de statistique encore une fois. L’entropie maximale est statistiquement l’état le plus probable, mais ce n’est pas un bon état. Un bon état, extropique, est au contraire statistiquement improbable. C’est une singularité. L’évolution produit régulièrement ce genre de singularités. Par exemple, le pouce opposable est une singularité qui provient d’une mutation génétique improbable. Il confère à son porteur une meilleure capacité d’action, donc une large gamme d’expression de cette singularité. Il peut grimper aux arbres plus facilement, lui permettant de trouver plus de nourriture et voir plus loin par exemple, mais il peut aussi se saisir d’un bâton et éclater la tête d’un camarade pour avoir plus de nourriture. Il peut se délecter de bananes en haut de son arbre pendant que ses congénères meurent de faim en bas. Ses congénères peuvent peut-être se liguer pour l’étriper. Est-ce que tout cela est bien ou mal ? Je dirais que ces actions sont mauvaises, car cela correspond à ma perspective, mais pour ces entités ne disposant pas du langage, ce n’est ni l’un ni l’autre. On ne peut pas séparer le bien, de la connaissance du bien et du mal. De la même façon, on ne peut pas séparer l’entropie et la connaissance de l’entropie. Je crois que l’expression d’une singularité est fondamentalement bonne. Le faire pour soi en premier lieu est parfaitement bon. L’utiliser au détriment du groupe, ou en les méprisant ne me semble pas exactement une bonne attitude cependant. Une réaction du groupe contre l’expression d’une singularité reposant sur le ressentiment est fondamentalement faire le mal en revanche, car c’est la destruction d’une improbabilité extropique. Toutefois, comme je le dis, c’est mon point de vue, cela dépend du sens que j’attribue aux choses, mais c’est là le propre de l’entropie. Je donne dans mon livre l’exemple des billes de couleur à mettre en ordre. Pour un daltonien pour qui les couleurs seraient les mêmes, quelque soit l’ordre des billes, l’entropie serait toujours la même de son point de vue. Aucun ordre n’aurait plus de valeur que l’autre. Seul une personne percevant une différence de couleur dans les billes pourra identifier ce qui constitue selon lui un meilleur ordre. Ce qui constitue un bon ordre n’est pas universel et est toujours une expression locale. Si la Chine fait des percées technologiques et nous devance, je devrais bien saluer leur singularité, mais si cela conduit à leur domination, alors cela ne constitue pas un bon ordre pour moi. Je chercherai à changer cet ordre des choses, car cela me semble bien. Nous sommes ainsi les législateurs et les créateurs du monde. Certaines théories en arrivent même à imaginer que l’entropie augmenterait inéluctablement dans l’univers, de par l’émergence de nouveaux observateurs-participant toujours plus capables d’identifier ce qui pourrait constituer des moyens de mieux ordonner le monde. Si ces observateurs-participants ont des conceptions différentes de ce qui constitue un meilleur ordre, alors cela sera la source d’un conflit. Tendanciellement, le vainqueur sera celui qui a effectivement une meilleure conception de ce qui constitue un meilleur ordre (c’est pourquoi je trouve un peu cringe de se dire nazi ou communiste aujourd’hui. Ils voulaient un nouvel ordre, mais le test a été effectué et ils ont perdu face à ce qui doit être, de facto, une meilleure conception du monde). L’entropie ne peut donc pas être séparée d’un observateur-participant et cela la rend extrêmement compliquée à appréhender, mais au final, elle revêt un aspect externe quand même. Le monde sélectionnera la Chine ou l’Occident, et cela repose sur l’expression de la singularité la plus extropique, et ceci est fondamentalement bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles pour paraphraser Leibniz. Il n’y a toutefois aucune façon de décider cela à l’avance. Je me méfierais d’ailleurs d’un leader politique qui aurait pour promesse de campagne de réduire l’entropie au nom du Bien. On ne peut pas connaître la Vérité et on ne peut pas agir au nom du Bien universel, mais ceci serait peut-être encore préférable qu’une pure attente de l’action de la providence venant nous sauver sans se livrer à l’action. Battez-vous et l’extropie reconnaîtra les siens. Si cela admet l’existence et la nécessité de la force, ce ne doit pas pas être entendu comme un éloge de la violence, et surtout pas de la violence gratuite. Ne pas connaître ce qui constitue le Bien, et admettre que cela implique une perspective, fait que je ne peux pas te punir pour avoir fait le Mal, car tu as refusé de réduire l’entropie. Je sais simplement que l’univers sélectionnera les systèmes les plus extropiques, les plus singuliers, mais je ne sais pas lesquels ils sont, ni même ce que cela signifie pour chaque système. Tout ce que je peux affirmer, dans l’absolu, c’est que le bien est la production du nouveau que je nomme l’être-singulier, mais je ne peux pas dire ce que c’est. Donc quand tu dis « Tout semble donc indiquer que la liberté créative de l’homme ne reste que très secondaire dans le dispositif métaphysique néo-réactionnaire », ce ne peut être plus faux, puisque je considère justement le bien le plus grand comme la création du nouveau, du remarquable, du singulier ! Je dis au sujet de ce que je me donne comme morale “Ainsi, les humains les plus moraux sont les créateurs qui vont créer l’ordre. Ce sont les bâtisseurs, les chefs d’industrie, les grands chefs d’État, mais aussi les artistes, et dans une autre mesure, les chefs de guerre, qui sont utiles à la création et au développement de leur culture et du Technocapital”. En un mot, le bien est la singularité. Et je ne parle pas de la singularité technologique ici, je parle de toutes les singularités. Je ne sais pas comment le dire autrement, je l’avais déjà explicité chez Lino.
La singularité technologique n’est qu’une singularité parmi d’autres. Il n’y aura jamais, comme tu le laisses penser, « un état de complexité formidable où la société deviendrait une structure parfaitement ordonnée » qui arriverait au moment de la singularité. C’est là aussi une mauvaise lecture de mon propos. Je mets clairement en avant que l’intelligence se trouve toujours au bord du chaos. Un système trop ordonné meurt dans la nécrose car l’information n’y circule plus. À l’inverse, un système trop chaotique meurt aussi, car l’information n’est plus conservée. S’il peut jamais y avoir un état parfaitement ordonné, ce serait à la fin de l’univers, dans la mort thermique. Ce qui est sûr, c’est que pour nous, cela n’a pas de sens de parler de la singularité technologique en ces termes. Je n’en parle pas en ces termes en tout cas. Je crois que la singularité technologique produira au contraire beaucoup de chaos, car le chaos représente les possibilités à explorer et la singularité ouvre un champ de possibilités. Soit dit en passant, les nouvelles technologies reposant sur la théorie de l’information furent grandement améliorées grâce à la connaissance de l’entropie. Cette idée a de la valeur, parce qu’elle améliore notre capacité à agir dans le monde.
Ma conception du Bien n’est pas alors platonicienne, mais de manière étonnante, elle pourrait être chrétienne. Si Nietzsche et Heidegger portent un coup fatal à la philosophie occidentale, on pourrait dire que la Bible était arrivé à la même conclusion avant eux. Si la connaissance est toujours subjective, qu’est-ce que cela nous dit quant au projet philosophique de la recherche de vérité ? Le cœur de la philosophie platonicienne revient à dire que, par la philosophie, il nous est possible de connaître le Bien par la raison et de s’y conformer. Léo Strauss, dans son Interprétation de la Genèse, soutient que le texte biblique s’oppose fondamentalement à cette conception de la philosophie grecque, articulant une tension irréductible entre la révélation et la raison. Dans le premier chapitre de la Genèse, la dépréciation du ciel, réduit à un simple instrument créé tardivement, conteste le thème central de la cosmologie grecque, où la contemplation des astres mène à la sagesse. Le deuxième chapitre critique l’intention philosophique en condamnant la connaissance autonome du bien et du mal, assimilée à une quête de vérité par la raison, inspirée par le ciel. Heidegger inclut le christianisme dans sa critique de la philosophie occidentale s’étendant de Platon à Nietzsche, car il repose, selon lui, lui aussi sur une vérité objective. Toutefois, l’interprétation straussienne nous laisse entendre qu’il n’est pas réductible à une métaphysique de la vérité objective. Le christianisme, via l’Ancien Testament, affirme le caractère dangereux de la quête de la connaissance. La quête de la connaissance est dangereuse parce que la vérité objective et éternelle est inaccessible et que, par conséquent, la quête de la vérité mène à des erreurs dangereuses ou à un scepticisme dangereux. Sur ce point, le message de la Bible n’est pas incompatible avec la mise en garde de Nietzsche, puis de Heidegger sur les illusions de la vérité objective, qui constitue le projet philosophique occidental. La philosophie prétend qu’il est possible de connaître le bien a priori par la raison, indépendamment de l’action, donc de notre relation au monde, or cela ne semble pas correct. Au contraire, la Bible nous met en garde contre l’illusion de cette connaissance qui n’appartient qu’à Dieu. La philosophie ne peut jamais que nous permettre de mieux comprendre cette relation qui nous unit au monde et nous connaître nous-même, conclusion à laquelle aboutira Socrate. Dans l’Apologie de Socrate, Platon nous livre comment l’oracle de Delphes aurait déclaré que Socrate était le plus sage des hommes. Socrate explique qu’il a cherché à comprendre ce jugement en interrogeant ceux qui semblaient savants. Il en conclut que sa sagesse réside dans la reconnaissance de son ignorance, contrairement à ceux qui croient savoir sans réellement savoir. La véritable sagesse est atteinte lorsque nous devenons conscients des limites de la quête de connaissance et de l’impossibilité de la vérité objective. La connaissance la plus élevée à laquelle peut nous amener la raison est alors qu’on sait qu’on ne sait pas. Au-delà, la révélation prend le relais dès lors qu’on admet la possibilité qu’il existe également ce que l’on ne sait pas que l’on ne sait pas. Le bien ne peut pas être connu a priori, il est révélé par l’action. C’est l’enseignement de la Bible qui nous dit que nous sommes condamnés à agir dans l’ignorance et que seul Dieu déterminera ce qui est bien ou mal. L’inaction n’est alors pas une option. Le bien et le mal sont jugés par l’extérieur évaluant la valeur de nos actions et non de nos pensées. Je ne parle pas d’un processus cognitif comme tu le laisses penser, mais bien d’un dévoilement ontologique et pour moi il n’y pas de différence entre ce que je nomme dévoilement et révélation. L’être est dévoilé ou le bien est révélé dans l’action, pas dans la connaissance. La connaissance sert l’action. Tous les systèmes supérieurs constituent l’extérieur. Le bien est toujours relationnel entre les systèmes. Il représente la valeur de l’action entre un sujet et ce qui lui est extérieur incluant des rétroactions entre les deux. C’est une relation entre une intérorité immanente, la nature du sujet, et son extériorité transcendante, la Nature ou le Dieu de la Nature, Gnon. Je crois qu’Heidegger pousse effectivement la philosophie à son terme en supprimant l’objectalité. Il aboutit à une ontologie fondée sur le Dasein comme être-au-monde, où le sens émerge de la relation dynamique entre l’Être et le monde, entre l’intériorité et l’extériorité. Pourquoi la création du nouveau, du singulier, donc du bien, est-elle possible en premier lieu ? La philosophie ne peut pas y répondre. Heidegger peut alors détruire la philosophie, mais il ne peut pas détruire la proposition de la révélation. En détruisant la philosophie, il renforce même la possibilité de la révélation. Nietzsche ne peut pas tuer Dieu et révoquer le bien et le mal, mais seulement la possibilité de connaître Dieu ainsi que le bien et le mal via la raison. Est-ce que Dieu existe ? Je ne sais pas, mais il n’est pas mort, car il ne dépendait pas de la philosophie. Cela n’entache en rien l’aspect vitaliste de la philosophie nietzschéenne. Que Dieu existe ou non, nous pouvons nous comporter en nietzschéen. C’est pourquoi je peux apprécier BAP comme Peter Thiel, le premier étant un vitaliste nietzschéen et le second un chrétien straussien. Nick Land, qui n’est pas influencé par Hoppe et Rothbard comme tu l’affirmes, mais plus par Nietzsche et Deleuze, semble porter de plus en plus d’intérêt à la proposition biblique également d’ailleurs. Heidegger finira lui-même par affirmer que seul un dieu peut nous sauver. Je crois que ce dieu est Gnon, qui constitue une réponse occidentale à la possibilité de la révélation, appelant à produire le nouveau plutôt qu’à se conformer à un ordre divin fixe auquel se soumettre. Ce point de vue n’est donc pas incompatible avec le vitalisme. Gnon laisse en suspens la tension entre la raison (philosophie) et la foi (révélation) qui selon Strauss est constitutive de la condition humaine et ne doit pas être résolue en faveur de l’une ou de l’autre. “Le mystique, ce n’est pas comment est le monde, mais qu’il soit” dit Wittgenstein. Pourquoi le monde existe en premier lieu ? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Le monde est lui-même une singularité. Pour paraphraser Wittgenstein et répondre au titre de ta critique (Entropie, le Dieu qui va échouer), je dirais que le divin, ce n’est pas comment le nouveau apparait dans le monde via des singularités extropiques, mais que le monde soit lui-même une singularité. Le divin, ce n’est pas l’entropie, mais la singularité.
Introduction
en douceur à
Unqualified
Reservations
Premier tome de l’oeuvre
majeure de Curtis Yarvin
Introduction
en douceur à
Unqualified
Reservations
Premier tome d’une série de 7 de l’oeuvre de
Curtis Yarvin offert à nos tipeurs.
Identité et conflit politique
Tu dis :
« nous sommes universellement déterminés par des lois naturelles. Ces lois naturelles doivent être répliquées dans les lois humaines et les organisations sociales que nous construisons. Nous devons donc partir de l’universel pour penser nos structures sociales et politiques, au lieu de partir du singulier différencié et du monde spécifique qu’il projette. Le risque est donc grand. NIMH a aboli la radicalité théorique du perspectivisme ontologique sur lequel se constitue l’identitarisme. Dès lors que nous vivons tous le même monde, et que nous sommes tous soumis à ses lois universelles, et ceci de telle sorte que ces lois soient aussi des lois politiques, alors il n’y a plus aucune raison de ne pas défendre un universalisme pan-anthropique. »
Je comprends mieux pourquoi tu imagines que mon propos ne s’accomoderait pas avec ton perspectivisme identitaire, mais je crois que là aussi, cela repose sur un malentendu dans ce que tu crois avoir compris de mon propos. C’est alors une bonne nouvelle, car je crois que nous sommes en réalité d’accord. Très honnêtement, je ne vois même pas comment tu arrives à ces conclusions d’après mes écrits. Je ne comprends pas comment tu ne fais pas un lien direct entre l’extropie locale, l’identité et le conflit. Quand je parle de « l’universalité de l’extropie », il ne faut pas comprendre ici « extropie universelle ». Je signale seulement que le principe extropique se retrouve dans chaque système vivant, pas qu’il existerait une unité extropique. L’extropie est toujours locale. Cette universalité me permet de dire que dans l’absolu, ce qu’on nomme le bien est l’extropie, mais ton extropie n’est pas mon extropie. Si le monde peut être vu comme une marre de chaos avec des îlots de néguentropie, résultat d’une lutte pour la dissipation d’énergie, la paix extropique universelle me semble compromise. Il n’y a aucune ambition « pan-anthropique » de ma part, c’est pour moi voué à l’échec. Je ne crois pas plus que nous « vivons le même monde », mais nous vivons dans le même monde, malheureusement. Chercher son extropie est nécessairement identitaire et conflictuel. Tout ton texte est un contresens total de mon point de vue. Tu sembles le présenter comme une pirouette de ma part passant de l’universalisme à l’identitarisme, mais c’est tout simplement le propre d’un univers qui est universellement entropique, mais localement extropique, et le mot extropie est un néologisme qui induit justement qu’il ne faut pas se conformer à l’entropie. L’identitarisme découle naturellement de cela, et je ne vois ni la nécessité, ni la seule possibilité de rejeter des lois universelles comme la thermodynamique et l’évolution comme préalable à une meilleure pensée.
Tu prends le passage sur Carlyle où je dis que le ciel a une loi et que jamais on a cru que le mensonge pouvait servir l’organisation de la société. Est-ce que tu rejettes ces lois ? Est-ce que tu rejettes le fait qu’elles s’appliquent à tout le monde ? Je ne comprends pas bien la critique. Si tu me disais que tu rejetais les lois de la thermodynamique et de l’évolution parce que cela dérange ton discours politique, je ne te prendrais pas pour un interlocuteur sérieux. Est-ce qu’il faut les répliquer dans nos sociétés ? Allons, je ne sais même pas ce que cela signifierait de répliquer l’entropie dans nos lois. Je n’ai pas l’impression que tu comprennes que ma seule proposition politique est le patchwork, précisément parce que je dis qu’il est impossible de connaître ce qui constitue une bonne organisation a priori. Tu y vois un platonisme, mais il n’y a aucun platonisme ici. Je ne décris pas un monde des idées et une nécessité de se conformer à des lois. L’organisation d’une culture repose sur ses mèmes et la qualité de ces derniers, les vérités, pas la Vérité. Cela implique de toujours créer de nouvelles catégories et non de se conformer à une Vérité éternelle. Quand Carlyle dit que le ciel a une loi, il dit simplement que vous pourrez bien voter démocratiquement, que la gravité ne s’applique plus à vous, elle continuera à le faire. Mais il serait tout aussi stupide d’inscrire dans les lois qu’il est un devoir de respecter les lois de la gravité. Cela n’aurait pas de sens, car on ne peut pas faire autrement de toute façon. Il en va de même pour l’entropie. Il n’est pas question de respecter la loi de l’entropie et d’inscrire dans la loi « Tu dois respecter l’entropie », ou plutôt « Tu dois combattre l’entropie ». Tout le monde le fait naturellement, car c’est le propre de la vie et des sociétés humaines. Il faut chercher les meilleurs moyens de combattre l’entropie, et ces règles ne sont pas inscrites dans le ciel. Elles appellent à être créées. Toutefois, si des lois visent spécifiquement à s’opposer à l’auto-organisation de la société, cela me semble être un mauvais point de départ. C’est cela que j’entends en disant que « Les lois représentent les conditions d’auto-organisation de la société et il n’y a aucune raison de penser qu’elles puissent s’émanciper des lois de l’univers ». Si tu veux forcer les gens à arrêter d’utiliser l’énergie dans un but décroissant, alors je te dirais que cela est surement une mauvaise loi, car elle semble effectivement s’opposer à des principes évidents des structures dissipatives. Je ne crois pas, effectivement, qu’on puisse s’émanciper de la thermodynamique par un vote, mais je ne vois pas comment tu pourrais ne pas être d’accord avec cela. Mais encore une fois, ce n’est pas parce qu’il existe une loi universelle qui est l’entropie qu’il faut s’y conformer, mais au contraire créer le nouveau pour s’en éloigner. Qu’est-ce que cela signifie de s’en éloigner ? De favoriser la production du nouveau, du remarquable, du singulier. En un mot, en favorisant la capacité à innover qui permet la puissance. Je ne sais pas à quoi ressemblera l’innovation, mais je sais qu’il faut la favoriser. Je ne sais même pas ce qui favorisera l’innovation. C’est en cela que je critique la démocratie et en arrive à proposer le patchwork comme seule proposition politique. Le patchwork favorise l’innovation en terme d’organisation politique, ce qui devrait permettre de favoriser l’innovation économique. Mais cela est aussi valable pour l’aspect identitaire. Alors que la démocratie est une tentative de résoudre les conflits dans le temps via un consensus, le patchwork est une proposition visant à réduire les conflits potentiels dans l’espace en permettant l’expression de son identité et sa conception différente de recherche du bien-être. Réduire les conflits, mais pas les supprimer. La guerre reste le dernier tribunal.
Tu dis :
« Il propose en ce sens un programme politique clair : abolition de la démocratie, instauration d’une autorité monarchique souveraines, créations d’une diversités de petits États concurrents, défense du libre marché, etc. Et tout ce programme, il prétend bien l’avoir tiré de ses vérités révélées universelles. »
C’est entièrement un contresens. Il n’y a pas de vérité révélée a priori universelle et éternelle dans laquelle chercher la bonne organisation. La seule fois où j’évoque une vérité révélée est le passage suivant quand je dis « Ce n’est qu’une fois la vérité révélée que les forces de l’ordre peuvent se dresser pour la défendre dans une lutte à mort s’il le faut. C’est la différence entre le religieux et le politique. Le religieux peut prôner la non-violence au nom de la vérité, mais le politique doit défendre la vérité en répondant à l’agression. La vérité peut venir de tout le monde, mais il faut être prêt à perdre tout ce qu’on possède en la révélant ». Il n’est pas question ici d’une Vérité éternelle sur le monde, mais beaucoup plus prosaïquement de ce qu’on observe de tout temps, et encore aujourd’hui dans nos sociétés contemporaines, qu’il n’est pas simple d’énoncer des vérités s’opposant à la doxa du moment. Ce fut le cas pour Giordano Bruno sous l’inquisition, c’est le cas aujourd’hui pour celui qui oserait dire publiquement qu’il existe un écart type dans les mesures du QI entre les Blancs et Noirs aux USA. Au contraire, la vérité est multiple, je l’avais d’ailleurs exposé dans ce cours article où j’explique que la bataille politique relève moins d’imposer une vérité qu’une perspective.
Pour cette raison perspectiviste, je suis plutôt sceptique quant à la monarchie centralisée et la proposition néocaméraliste sans le patchwork. La valeur est dans le patchwork pour moi, car il permet une mise en compétition des perspectives et la sélection des bonnes formes d’organisations. Et une bonne forme d’organisation pour un groupe de personnes n’est peut-être pas une bonne forme pour un autre. C’est précisément ce perspectivisme identitaire qui m’amène à la défense du patchwork, alors je ne comprends pas du tout pourquoi tu affirmes que je détruis cette possibilité. C’est tout l’inverse et s’il y a bien un endroit où j’aurais pensé que nous serions d’accord, c’est celui-ci.
J’en arrive à défendre les marchés libres, précisément parce que je ne crois pas qu’il existe de lois a priori permettant de réduire l’entropie. Si je devais donner une mesure à maximiser, en dernière instance, je donnerais l’intelligence. Il semble que l’univers tend à favoriser les systèmes les plus intelligents, et ce à plusieurs échelles. Afin de donner un exemple concret, en tant qu’individu occidental de 2025 vivant en France, le marché libre fait partie de ton monde. Ta façon de maintenir ton ordre dans le temps et même de l’augmenter, est de trouver ta place au sein de ce marché libre. Travailler pour une compagnie implique à un moment ou à un autre de capturer de l’information sur le marché afin d’identifier les produits qui pourront être vendus, ainsi que les partenaires qui pourront les produire, etc. En capturant cette information, tu vas participer à l’auto-organisation du marché, mais tu vas le faire en fonction de ce que cela t’apporte à toi. Les deux ne sont pas indépendants. On ne peut pas séparer l’individu et le marché, de la même façon qu’on ne peut pas séparer le Dasein et le monde. C’est ta capacité à permettre l’auto-organisation du marché qui te verra récompensé par ledit marché et il semble que la réussite au sein du marché libre soit liée à l’intelligence. Mais cela ne s’arrête pas là. Le marché n’est pas un objet fixe à découvrir, mais c’est une entité dynamique qui est co-créée par l’action de ses participants, guidée par leurs désirs. Il semble offrir de plus en plus de possibilités, donc de plus en plus d’incertitudes, et pourtant, les individus comme Nick Land qui l’ont appréhendé sous l’angle de la réduction d’entropie ont clairement identifié qu’il se dirigerait nécessairement vers la production d’intelligence artificielle en le voyant comme un système lui-même intelligent, c’est-à-dire capable de réduire son entropie. Cet exemple du marché est une simple illustration visant à montrer une facette de comment tu es au monde aujourd’hui, comment tu as le souci de toi-même, mais aussi comment le monde effectue une rétroaction sur toi et in fine, et semble se diriger vers quelque chose qui pouvait être prédit en usant de la bonne lentille épistémologique. Si l’univers tend à produire des entités de plus en plus efficaces, à produire de l’entropie, alors ces entités doivent être de plus en plus intelligentes. Alors est-ce qu’il faudrait maximiser l’intelligence ? Je ne crois même pas en réalité. Un patchwork laissant les gens vivre selon leurs préférences, leur recherche de bien-être, augmenterait naturellement l’intelligence à mon avis.
Contrairement à ce que tu affirmes, et peut-être à l’exception de Nick Land, la néoréaction ne s’appuie pas sur les règles discutées ci-dessus pour parler des phénomènes sociaux. Tu dis « Pour eux, par exemple, les structures sociales et les appareils de production se pensent et se formulent en terme de « dissipation d’énergie ». Ils ne savent pas les formuler autrement. Ils ne sont pas pour eux des lieux sociaux, des lieux d’échanges et d’interactions où se nouent des jeux de pouvoirs, de normes, de comportementalités, des conventions morales, des arbitrages symboliques etc. », ou encore « Il reste toujours que ces différentes populations vivent le même monde dans le système NRx. Elles voient la même chose, vivent la même réalité, sont prises dans le même Être fondamental et subissent les mêmes lois universelles ». C’est entièrement faux et j’imagine que tu n’as pas lu une seule ligne de Yarvin, Land, ou Spandrell pour affirmer cela. Tu fais une critique de la néoréaction à partir de mon livre sans avoir pris le temps de lire la production des néoréactionnaires. Or, mon livre n’a pas pour but de vulgariser les idées clef de la néoréaction. Tu penses que les néoréactionnaires n’ont pas conscience de parler d’un point de vue, tu penses avoir percé le discours néoréactionnaire à jour en le réduisant justement à un discours et non pas qui ne serait pas « la description objective d’une Vérité de nature transcendantale », mais tous les néoréactionnaires seront d’accord avec cela. Yarvin énonce très clairement qu’il s’adresse à la jeunesse blanche qui va au Burning Man. Il ne lui parle pas dans un langage de techbro, il décortique le pouvoir en s’appuyant sur des penseurs comme Jouvenel ou Burnham, sans jamais faire de référence directe à la physique ou y chercher des moyens d’interpréter les phénomènes sociaux. Tu exhortes la droite à effectuer un travail sociologique visant à penser de que signifie d’être un Occidental Blanc, mais c’est une chose que Nick Land a débuté en réalité. Nick Land a un article sur la blanchité nommé White Fright.
La diversité biologique humaine (DBH) ne se limite clairement pas à la variation raciale. Elle concerne également le dimorphisme sexuel humain et s’intègre finalement dans une future génomique comparative humaine. Cependant, lorsqu’elle est perçue comme provocante, la définition de la DBH en tant que « science raciale » ou « racisme scientifique » masque toutes les autres dimensions de sa portée. L’aspect choquant de la DBH réside dans l’insistance sur l’existence de la race, déclenchant l’horreur raciale. Au-delà de l’indignation sociale, il y a une détresse cosmique, une panique sans bornes. La DBH remet en question la promesse d’une humanité universelle et doit donc être stoppée à tout prix.
Je vais limiter ce post à un objectif modeste : refonder les Études Critiques de la Blancheur sur des bases résolument néoréactionnaires. Les Blancs sont WEIRD (bizarres). Un groupe particulièrement significatif d’entre eux a brisé le modèle archaïque de l’identité raciale humaine, créant ainsi le monde moderne et, avec lui, leur identité ethnique est devenue un paradoxe dynamique. La Blancheur est une réaction historique incontrôlée que personne — surtout pas les antiracistes des Études Critiques de la Blancheur ni les nationalistes blancs — n’a commencé à comprendre.
Nick Land, White Fright
Nick Land, pleinement conscient de ce que représente l’entropie soit-il, peut reconnaître l’importance de penser la particularité des Européens d’aujourd’hui. Et je crois qu’il a raison en identifiant que la psychologie WEIRD des Européens est une singularité. Je n’y vois pas de désaccord ici. Tu accuses les néoréactionnaires de refuser le conflit, en imaginant un Dieu unitaire dans l’entropie, mais c’est une conception entièrement distordue de ce que nous défendons. Nick Land dit au contraire que tout ce qui a de la valeur fut forgée en enfer, dans le conflit, et que ce n’est pas l’entropie qui est Dieu, mais la guerre. Nick Land dresse un parallèle entre la production de la vérité et la guerre. La réduction d‘entropie est la réduction d’incertitude. Le droit est certainement d’un grand secours pour résoudre certaines incertitude et éviter la violence, mais il semble que la guerre soit le dernier tribunal, la façon ultime de résoudre l’incertitude. Un conflit est une incertitude qui appelle à être résolue. C’est la base du progrès. En Europe, le progrès est né d’énormes conflits entre nos populations qui ont conduit à des guerres fratricides. La proposition du patchwork est une façon de résoudre les conflits, donc l’incertitude – donc réduire l’entropie –, sans en arriver à la guerre. La néoréaction intègre pleinement cela.
Tu affirmes que les penseurs phares de la néoréaction sont influencés par Hoppe et Rothbard. Ce n’est pas du tout exact. Yarvin rompt avec ces penseurs. Il recommande la lecture des dix livres suivant :
1. Edmund Burke — Reflections on the Revolution in France
2. Henry Maine — Popular Government
3. W. E. H. Lecky — Democracy and liberty
4. Walter Lippmann — Public Opinion
5. Edgar Lee Masters — Lincoln the Man
6. Albert Jay Nock — Memoirs of a Superfluous Man
7. John T. Flynn — As We Go Marching
8. Bertrand de Jouvenel — Sur le Pouvoir
9. Erik von Kuehnelt-Leddihn — Liberty or Equality
10. James Burnham — Suicide of the West
Son œuvre est beaucoup plus influencée par Burnham en réalité, dont je te laisse un extrait de l’ouvrage recommandé par Yarvin.
“Il n’y a qu’une seule façon d’échapper aux conclusions de ces déductions logiques : en rejetant au moins certains des principes d’où partent les déductions. Il faudrait, en particulier, rejeter la réduction quantitative des êtres humains à l’Homme Commun ; et réaffirmer les distinctions qualitatives. Très spécifiquement, il faudrait réaffirmer la conviction pré-libérale que la civilisation occidentale, donc l’homme occidental, est à la fois différente et supérieure en qualité aux autres civilisations et non-civilisations, quelle que soit la source de cette différence et supériorité. Et il faudrait une volonté renouvelée, légitimée par cette conviction, d’utiliser un pouvoir supérieur et la menace du pouvoir pour défendre l’Occident contre tous les défis et challengers. À moins que la civilisation occidentale ne soit supérieure aux autres civilisations et sociétés, elle ne vaut pas la peine d’être défendue ; à moins que les Occidentaux ne soient prêts à utiliser leur pouvoir, l’Occident ne peut pas être défendu.”
J’espère qu’après ceci tu comprendras que la néoréaction n’est pas incompatible avec tes projets. Curtis Yarvin et Nick Land sont tous les deux fermement contre l’universalisme, bien plus que je ne l’exprime dans mon livre, et je ne saurais que trop te conseiller de lire ces autres auteurs qui ne s’engagent pas sur le terrain d’une unité ontologique comme je le propose. Ceci est une conception très personnelle de ma part, et je mesure en quoi cela n’est pas en accord avec Heidegger qui refuse d’aller sur ce terrain, mais je crois sincèrement que cet arrière-plan ontologique informationnel existe et que c’est ce qui confère la possibilité de l’existence. En réalité, je crois que les dissensions persistantes entre ton identitarisme radical, ancré dans un perspectivisme ontologique heideggero-nietzschéen, et mon accélérationnisme néo-réactionnaire, qui tente d’articuler un donné universel avec un différentialisme identitaire relève justement du paradoxe WEIRD que Nick Land met en avant. L’universel est un truc de Blanc WEIRD, une perspective sur le monde qui se demande “Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien ?”.
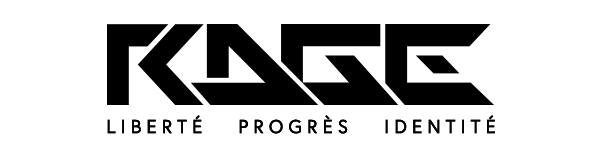

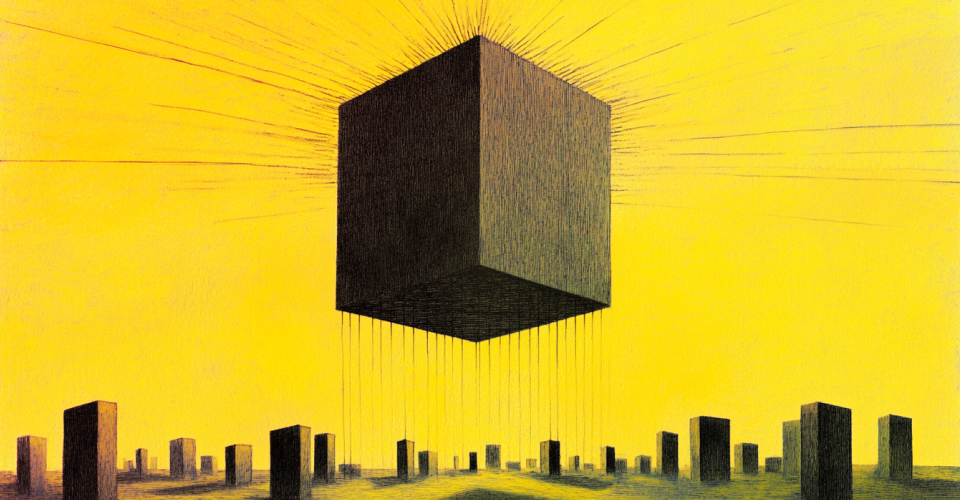





Y a-t-il eu une réponse?
Non et Europagande a supprimé son compte X.