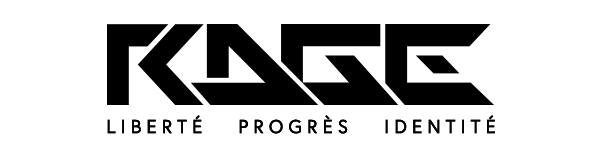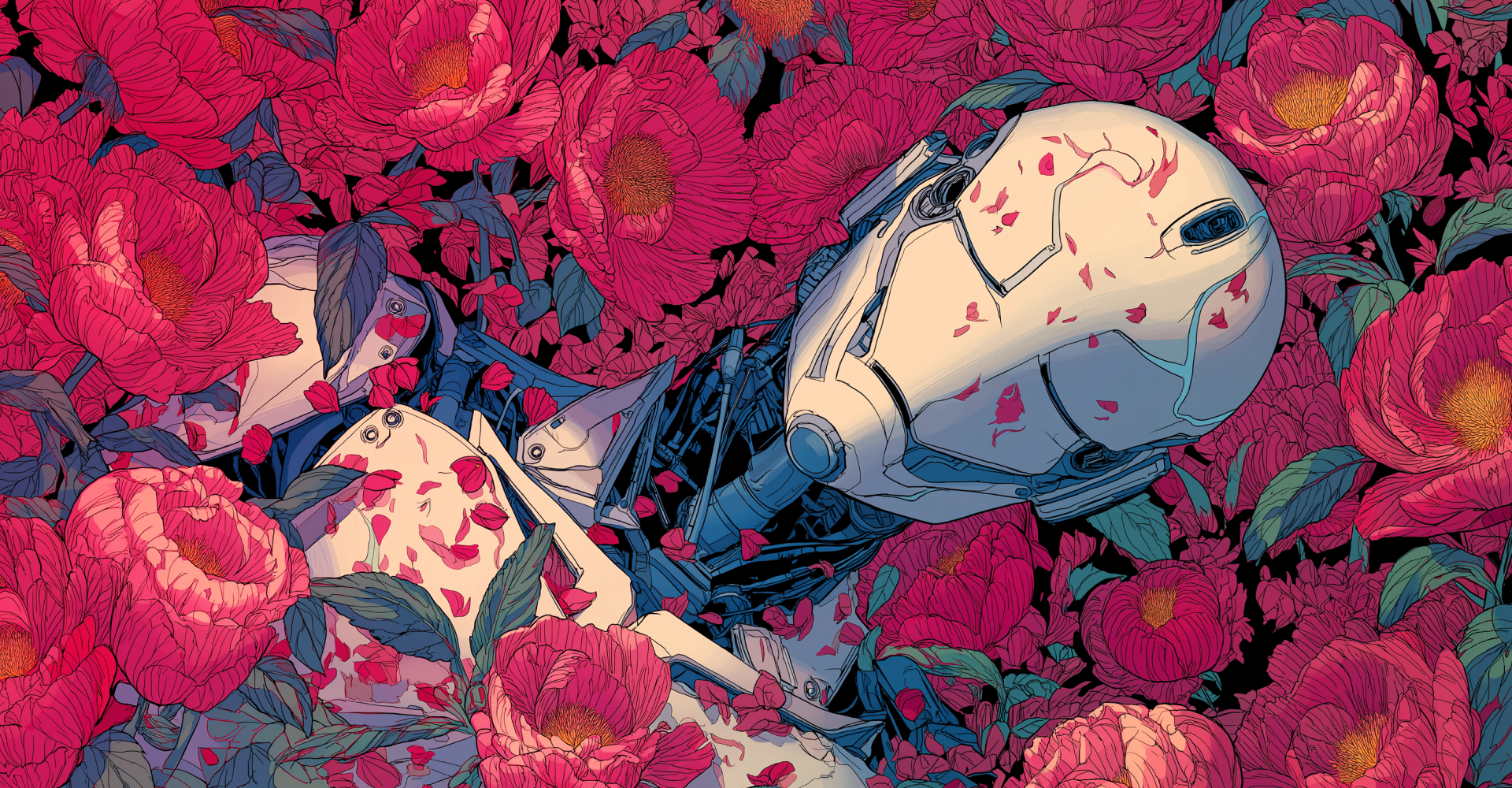La singularité, phénomène que nous jugeons inévitable, mettra à notre disposition des super intelligences censées résoudre les problèmes techno scientifique à une vitesse exponentielle… à condition d’avoir des données et de décrire correctement nos objectifs aux IA.
Nous traversons indéniablement une crise environnementale, mais nos données sont limités et notre conception d’un monde durable est catastrophique.
Comment décrire le conflit entre techno-capitalisme et biosphère ?
La dépendance aux énergies fossiles est notre premier problème. L’épuisement des réserves est inévitable. Le changement climatique entraîne une réduction de l’habitabilité de la Terre. Ce qu’on gagne en productivité des plantes aériennes C3, on le perd très largement en production halieutique, instabilité climatique et en terres émergées.
Le second problème est l’épuisement des ressources minérales. Même en excluant les énergies fossiles, même en prenant en compte les milliers d’années de potentiel géologique exploitable, nous exploitons nos ressources minérales d’une manière incompatible avec une accélération drastique de l’activité humaine et son expansion à très long terme, 5000 ans ça reste très provisoire.
Vous pouvez objecter que ces éléments, à l’inverse du pétrole, ne sont pas détruits au cours du processus de consommation. Certes, mais leur entropie augmente considérablement. Nous exploitons uniquement des gisements exceptionnellement concentrés et purs, puis nous les dispersons dans des produits dans lesquels ils sont dilués et mélangés. Le recyclage est marginal sauf pour les métaux les plus communs utilisés sous forme concentrée et relativement pure.
En résumé, nous utilisons une source d’énergie non-durable, nous dégradons l’environnement en le rendant moins accueillant et moins productif. Nous dissipons l’entropie en détriment des autres systèmes de dissipation/espèces qui constituent la biosphère. Notre civilisation est charognarde, elle prolifère sur des carcasses non-renouvelables et disparaîtra quand elles seront épuisées.
Techno-capitalisme vs Biosphère, extropie vs entropie
Si l’activité humaine ne fait qu’augmenter l’entropie en désorganisant la biosphère, alors les partisans de la décroissance ont raison de vouloir abattre le capitalisme industriel. La seule issue serait de ramener les humains à une place limitée dans la biosphère terrestre, comme les super prédateurs. Une IA alimentée par les conceptions en vogue dans la cathédrale pourrait très bien arriver à cette conclusion dramatique.
Pourtant les processus industriels humains sont comparables, en volume d’énergie et de matières transformées, à l’activité de certaines espèces vivantes. La biomasse humaine est du même ordre de grandeur que celle des termites. Pourquoi une biomasse gargantuesque de termites prospère depuis 150 millions d’années alors que nous sommes incapables de projeter notre société industrielle au-delà de quelques siècles ?
La photosynthèse à oxygène extrait 120 milliards de tonnes de CO2 de l’atmosphère chaque année, malgré sa très faible concentration. Les plantes utilisent les mêmes métaux (Fe, Cu, Mo, Mg, B, Zn) depuis 500 millions d’années en les extrayant de sols où ils sont en très faibles concentrations. Les luxuriantes forêts équatoriales ne manquent ni d’azote ni de phosphore ni de potassium ni d’oligoéléments, pourtant elles poussent dans des sols aux réserves minérales faméliques. Pourquoi sommes-nous incapables de faire de même ?
La solution du vivant pour dissiper des quantités colossales d’entropie (presque) indéfiniment
Vous souvenez-vous des algues Caulerpes taxifolia qui envahissaient la Méditerranée au début des années 90 ? Elles profitaient d’un environnement pollué (nitrate) et d’une absence de maladie et d’herbivore adapté. Cependant leur folle cavalcade qui excitait les médias ne dura pas. Dès 2015, 80% des surfaces avaient disparu, pendant que les posidonies autochtones reprenaient du terrain.
Pourquoi cette différence ? Parce que les posidonies ne sont pas juste des opportunistes, elles construisent un biotope résilient et adapté à leurs besoins. Certains clones auraient entre 80 et 200 000 ans. Et cela n’aurait rien d’exceptionnel, 3.5 à 8.9% des individus de Posidonies seraient vieux de plusieurs siècles ou millénaires.
Elles sont productives, jusqu’à 700 tiges par m², mais n’ont pas besoin d’apports d’azote venant de l’extérieur. Leur photosynthèse efficace leur permet d’échanger, via leurs racines, des sucres contre des composés azotés à des bactéries fixatrices d’azote. Leurs racines et leurs rhizomes transforment les fonds marins en une structure, la matte, adaptée à leur propre expansion et qui hébergent leurs bactéries symbiotiques. Leurs laisses de mer ou égagropiles viennent stabiliser les zones côtières évitant les eaux turbides qui gênent la photosynthèse. La Méditerranée est le jardin des posidonies, et les posidonies les jardinières de la Méditerranée.
Un autre exemple d’espèces clefs de voûte est les coraux. Ils n’exploitent pas une ressource, ils ont résolu le problème du manque de ressources minérales dans les eaux tropicales peu profondes. Ils hébergent des microalgues et les mettent dans des conditions de croissance optimale. Ils font exploser la productivité primaire des zones qu’ils occupent : 1,7kg/carbone par an/m² contre 200g/C/m²/an dans une zone côtière productive. Avec seulement 0,16% de la surface des océans, ils hébergent 30% de la biodiversité. Les coraux transforment des environnements très pauvres et sableux en récifs où plus de coraux peuvent se développer. Ils sont sensibles à la chaleur, ça tombe bien ils stockent du carbone dans leurs exosquelettes.
Quels sont les secrets de nos fameux termites ? Leurs actions sur l’environnement sont simples : mettre en relation des végétaux morts et des champignons qui ont besoin d’humidité et de température contrôlée pour les décomposer. Cette opération est critique en milieu tropical sec car les champignons ne peuvent recycler la matière végétale morte sans humidité. Les termites libèrent de l’espace et les minéraux pour la génération suivante de plantes. Sans termite nous n’aurions pas de savane et ni de forêt galeries en zone tropicale, beaucoup plus d’incendie et probablement pas de forêt équatoriale aussi luxuriante et résiliente. Sans termites pas d’environnement pour les termites. Les termites sont méthanogènes, mais ce n’est pas problématique car elles aiment la chaleur.
Ces organismes sont des espèces clef de voûte. Elles pratiquent une forme naturelle de géoingénierie qui modifie l’environnement à leur avantage. Elles étendent leur bulle d’extropie en résolvant les problèmes locaux qui brident les activités biologiques. Elles peuvent partager une grande part de leur extropie parce qu’elles utilisent une source d’énergie sans limite pour concentrer et cycler les ressources rares et diluées. Elles font exactement l’inverse des industries humaines, qui utilisent le moins d’énergie possible pour obtenir des éléments rares dans les gisements concentrés, puis les diluent en dégradant l’environnement.
Pourquoi l’écologie ne s’inspire pas plus des espèces clefs de voûtes ?
La cathédrale, conformément à sa mission anti-accélérationniste, offre sa puissance médiatique et les moyens universitaires à des ingénieurs et des physiciens qui ne comprennent pas les écosystèmes (Jancovici, Barrau) et à des biologistes bio conservateurs (Rabhi, Servigne, Gouyon, Bourgignon) qui méprisent l’industrie et plus généralement l’intervention humaine. Les deux se rejoignent sur la décroissance, l’anti-accélération du capitalisme.
En agronomie ces anciennes générations commencent à être bousculées par des innovateurs plus jeunes qui communiquent en dehors des médias et des filières universitaires classiques. Pour les praticiens les plus innovants de l’agroécologie l’abondance n’est pas un problème, mais une loi de la Nature qu’il faut juste aiguiller dans le sens plus favorable à nos besoins. La Nature adore l’abondance, la productivité maximale et la biodiversité maximale sous étroitement lié dans le cadre des climax écologiques.
Comment transformer les transhumains en espèce clef de voute ?
Le complexe techno-capitaliste reconfiguré par la singularité doit résoudre les mêmes problèmes que la biosphère :
Le premier est la mise à disposition d’une source d’énergie sans limite avec un coût marginal proche de 0. Les plantes partagent une grande part de leur production pour les services annexes parce que l’énergie solaire est gratuite. C’est le point le plus facile car nous avons un large panel de technologies existantes ou accessibles compatibles avec ces contraintes.
Le recyclage des éléments doit être intégral. Ce second point est subsumé au premier car c’est l’abondance de l’énergie qui autorise le recyclage intensif. Néanmoins c’est le défi le plus compliqué car il n’a jamais été sérieusement envisagé, étudié et encore moins mis en œuvre.
Dans la nature les deux pivots du recyclage sont l’air (Carbone, Oxygène et Azote) et le sol (les éléments non gazeux). Or nous n’avons pas un sol artificiel qui décompose les smartphones et qui livre les minéraux sous formes pures aux usines. Même si on peut se simplifier la tâche via la conception (à la fois en réduisant les éléments rares et en rendant plus facile la récupération) il va falloir quasiment tout inventer. Les champignons ont mis 50 millions d’années pour décomposer le bois, il va falloir faire mieux et dans un délai un million de fois plus court.
La question de la pollution est très simple à résoudre. Yarvin propose d’appliquer le principe de souveraineté à la pollution. Polluer revient à dégrader le bien d’autrui, que cela impacte un particulier ou un sovcorp. Limiter puis interdire la pollution est donc une mission régalienne légitime.
Le dernier principe est que l’activité humaine doit « terraformer » la Terre pour la rendre encore plus habitable. L’activité humaine consiste à dégrader la productivité et l’ordre de l’environnement pour en extraire quelques ressources adaptées a ses besoins.
L’agriculture illustre parfaitement cette démarche. Un champ de blé « bio » produit deux ou trois fois moins de biomasse sèche (2 tonnes de blé, 3 tonnes de pailles, 4 tonnes de racine et rhyzodéposition) qu’une forêt ou une prairie (8 à 12 tonnes de biomasse aérienne et autant dans le sol), mais beaucoup plus de nourriture pour les humains. La productivité de l’agriculture est une fausse information, la dissipation d’entropie résultante est la pollution des rivières et la dégradation des sols. Les intrants ne font qu’accélérer le processus et augmenter la dissipation d’entropie nécessaire au rétablissement de la vérité.
Sur cette thématique les agronomes et les écologues ont une grande avance sur les ingénieurs de l’industrie. Les keylines de Yeomans, les analogues de barrage de castor, les récifs marins artificiels, les boutures decoraux, les plantations de mangroves, la permaculture de Mollison & Holmgren, l’agriculture syntropique d’Ernst Götsch, ils ont déjà de nombreux axes de recherche pour faire respecter le principe de puissance maximum conforme à la pression de sélection.
Les principes sont au premier abord simples, la mise en œuvre est une énorme montagne à gravir car elle implique des révolutions technologiques et psychologiques. La quantité de connaissances à acquérir est titanesque. Nous devrons passer de procédures standardisées, réductionnistes et fixistes, à une approche bayésienne de recherche d’équilibre dynamique, agrégeant d’innombrables leviers d’action pour adapter les choix à pratiquement chaque m² de terrain. Un patchwork agroécologique doit remplacer l’uniformisme de la révolution verte et le fixisme traditionnel. Il faudra accepter de traverser des vallées du doute et dissiper beaucoup d’entropie par l’échec expérimental. Mais cela veut aussi dire que l’histoire n’est pas terminée et qu’il y aura du travail pour plusieurs générations, même assistées par des IA.