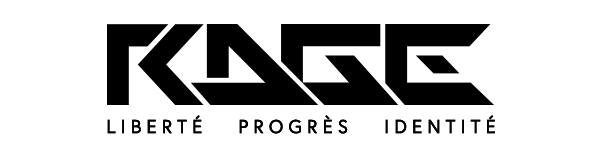Né en 1984, Philippe Fabry est historien du droit, des institutions et des idées politiques. Féru d’histoire romaine, il s’intéresse particulièrement à la théorie du droit naturel, de l’École de Salamanque à l’École autrichienne. Dans ses livres, il développe des parallèles entre l’Antiquité gréco-romaine et notre époque, invoquant les « lois de l’histoire » pour étayer ses anticipations. Dans cet entretien, nous avons décidé d’adresser des questions en rapport avec l’actualité géopolitique ; en effet, les prises de décisions polémiques et anti-occidentales du gouvernement d’Erdogan méritent d’être davantage cernées.

Dr. Manhattan – Bonjour Monsieur Fabry et merci d’avoir accepté cette invitation. Pour commencer, quelles sont les implications de cette polémique ? Le rappel de l’ambassadeur de France en Turquie est-il vraiment un geste fort et annonciateur ?
Philippe Fabry – Bonjour, merci de m’accueillir. De mémoire, la dernière fois que la France a rappelé un ambassadeur pour consultation était lorsque Luigi Di Maio, alors vice-président du Conseil italien, avait reçu des Gilets Jaunes. Le gouvernement français avait considéré cela comme une ingérence. Pour autant, il est évident que l’Italie et la France n’ont pas été à couteaux tirés. Le rappel d’ambassadeur pour consultation fait toujours son petit effet, mais on peut dire que c’est l’outil du dessus dans la boîte diplomatique pour signifier un certain agacement. C’est donc aussi un passage obligé dans une escalade verbale, mais pas nécessairement annonciateur de plus, en soi, même s’il est évident que la situation n’est d’ores et déjà plus comparable avec l’incident italien d’il y a deux ans.
Très franchement, le fait d’avoir positionné des rafales au soutien de la Grèce était en soi un geste beaucoup plus fort, puisqu’il s’agissait d’une position militaire. Mais la crise en question était d’un autre ordre, il s’agissait de soutenir les Grecs et de prendre la posture de gendarme en Méditerranée dans une région qui fait traditionnellement partie de la zone d’influence française. Alors que la crise qui a provoqué le rappel de l’ambassadeur est uniquement relative aux propos déplacés d’Erdogan, à l’encontre du chef de l’Etat français, et dans une période de deuil national. Il est important de faire le distinguo parce qu’en matière diplomatique il est d’usage de compartimenter les problèmes, pour pouvoir toujours les négocier séparément et éviter une brouille générale entre deux Etats, même si, bien entendu, une relation s’évalue en fonction du nombre de points de friction, et que la multiplication des litiges rend chacun d’entre eux un peu plus difficile à résoudre.
Condor – Quelle place la Turquie occupe-t-elle sur le plan diplomatique en ce moment avec ces événements qui la confronte à la Grèce et Chypre ? Certains avancent que les prétentions turques ne sont pas si dénuées de sens, le partage des eaux territoriales étant très inégal.
Je n’appellerais pas ça un partage inégal, parce que l’égalité, l’équité est une question morale. Je préfère parler de déséquilibre parce que cette notion renvoie à des considérations plus objectives de rapport de force entre Etats, et de l’adéquation ou inadéquation des droits acquis avec ces rapports de force.
La Turquie actuelle a hérité de frontières de pays vaincus, même si Mustapha Kemal avait réussi à éviter le pire en reprenant du terrain aux Grecs après la défaite dans la Première Guerre Mondiale. Dans ce genre de configuration beaucoup de prétentions irrédentistes sont entretenues durablement, parce que les frontières ont été fixées sur un point trop distant d’un point d’équilibre. Dans la mer Egée, par exemple : si la Grèce avait vaincu les Turcs au début des années 1920, la côte anatolienne en Egée serait intégralement grecque et la Turquie aurait un territoire replié sur l’Anatolie, qu’elle n’aurait peut-être jamais contesté. Mais les Turcs ont gagné la guerre et repris la côte anatolienne, de sorte qu’aujourd’hui la Turquie est un pays puissant, beaucoup plus vaste et peuplé que la Grèce, et une frontière « équilibrée » dans un tel cas, vues les forces respectives, serait vraisemblablement le milieu de la mer Egée. Or, la frontière héritée des aléas de l’Histoire, du fait de la conservation par les Grecs de la ceinture d’îles orientales bordant la côte anatolienne, accorde la domination de toute l’Egée à la Grèce. Cela ne correspond objectivement pas aux rapports de force entre les deux seuls Etats grec et turc, et ne tient que par l’implication de puissances extérieures : les membres de l’OTAN, en particulier les Etats-Unis, bien sûr, mais aussi, la France.
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
Traité
Néoréactionnaire
Le premier livre de NIMH
DM – On a l’impression que tous les musulmans voient tous les événements au travers du prisme de la religion. Au final – vous avez déjà parlé du projet politique de Erdogan précédemment – est ce que leurs élites n’ont simplement aucune arrière-pensée et n’agissent que sincèrement dans le sens de leur religion ? Autrement dit, est ce que l’islam, à l’inverse des autres grandes idéologies politiques, n’est pas vraiment utilisée à dessin ?
Je pense qu’Erdogan est aussi authentiquement islamiste que Staline était sincèrement communiste : l’un et l’autre ont forgé leur conscience politique dans un certain courant de pensée, et n’ont pas cessé brutalement d’y adhérer après des décennies, simplement en arrivant au pouvoir. Simplement, il faut comprendre qu’il n’y a pas d’un côté les préoccupations idéologiques, et de l’autre le projet politique, l’ambition nationaliste. Au contraire, les deux se combinent et se nourrissent : l’idéologie vient justifier l’ambition nationaliste en lui donnant une légitimité supérieure, en rationnalisant l’exceptionnalisme nationaliste (« mon pays vaut mieux que les autres »), et l’ambition nationaliste s’ordonne dans un projet grandiose qui, seul, semble à la hauteur de l’idée que se font les nationalistes du rôle de leur pays, et qui ne saurait se réduire à une lutte d’influence et la défense d’intérêts prosaïques.
En d’autres termes, les ambitions stratégiques turques existeraient avec ou sans islam, mais l’islam sert à la fois à les justifier, à les augmenter et à les mettre en œuvre. Vous pouviez dire la même chose du communisme et des ambitions stratégiques russes sous l’Union soviétique.
DM – Est-ce que la crise économique, et par conséquent l’importante dévaluation de la Lire turque n’oblige pas aussi Ankara à opérer une fuite en avant ?
On est souvent tenté de chercher des « causes de politique intérieure » dans ce genre de situation. Sur les plateaux télé ou radio, il y aura toujours un commentateur qui évoquera cela, souvent en se croyant plus subtil que les autres, d’une part parce que la cause de politique intérieure semble moins évidente s’agissant d’une crise internationale, et d’autre part parce que cela permet souvent de relativiser en expliquant qu’au fond il n’y a pas vraiment de crise internationale, puisque les causes ne sont pas dans les rapports entre nations. Dans les années 1930, on trouvait des éditorialistes pour expliquer que les revendications territoriales d’Hitler servaient d’abord un propos de politique intérieure.
C’est un argument qui est d’ailleurs souvent employé de manière partiale, puisqu’on pourrait aussi bien dire que si Emmanuel Macron affiche une posture de fermeté, c’est parce qu’il est affaibli au plan intérieur par les difficultés économiques, le Covid, les gilets jaunes, l’approche de la prochaine échéance électorale… Evidemment que la réaction d’un dirigeant est partiellement conditionnée par sa situation intérieure. Mais la réalité est que les ambitions stratégiques demeurent les causes premières des crises stratégiques, que si Erdogan se déploie actuellement tous azimuts c’est parce qu’il porte depuis longtemps une ambition nationale turque de grande ampleur, et si Emmanuel Macron s’y oppose plus franchement que tout autre en Europe c’est parce que la Grèce est dans la zone d’influence française depuis le XIXe siècle.
De fait, les difficultés économiques turques sont en grande partie le fait de la politique d’Erdogan, mais c’est raisonner en occidentaux obsédés par les taux de croissance et de change que de croire que tout dirigeants voit cela comme la préoccupation primordiale. Pour un dirigeant comme Erdogan, le primordial, c’est l’ambition stratégique, et le reste n’est qu’intendance qui doit suivre. Les difficultés économiques ne l’inquiètent qu’en tant qu’elles peuvent entraver ses ambitions stratégiques, et visiblement il n’en est pas encore là.
C – Les quelques aventures militaires d’Erdogan contre des faire-valoir (Syrie, kurdes, Libye) se sont soldées par des gains modestes. A l’instar de la Russie, est ce qu’une armée turque purgée de ses cadres n’est-elle pas un épouvantail ?
Il est vrai que les avancées ne semblent pas spectaculaires, mais il faut bien voir que pour l’essentiel, Erdogan n’a engagé sur ces théâtres que des supplétifs, s’agissant d’auxiliaires recrutés parmi les groupes combattants djihadistes syriens qui ont été déployés d’abord contre les Kurdes, puis transportés en Libye et, semble-t-il, au Haut Karabagh. Ce n’est donc pas principalement l’armée régulière turque qui se bat, ce qui permet à Erdogan de mener des semi-guerres hybrides, de limiter les pertes de soldats turcs et donc de ménager son opinion publique.
L’autre point à souligner est que sur tous ces fronts, Erdogan s’est heurté à la Russie de Poutine, garante du camp d’en-face : soutenant Haftar en Libye, Assad en Syrie. Cela limite a priori les possibilités de gains.
En revanche, rien ne me paraît permettre d’affirmer, jusqu’à présent, que l’armée turque ait pâti des purges de 2016 d’un point de vue opérationnel : il n’y a pas eu de revers dû à des lacunes dans le commandement, à ma connaissance. Mais il est aussi possible qu’Erdogan ait rechigné à engager son armée régulière précisément par conscience d’une faiblesse de son encadrement après les purges.
DM – Vous comparez Erdogan à Hitler en ce qu’ils sont tous deux d’après vos propres termes des “Révolutionnaires Revanchards”. Est-ce que cette comparaison n’est pas limitée par une situation radicalement différente dans le cas de la Turquie : elle est moribonde à la différence de la situation du Reich des années 30. Finalement, on a l’impression que, comme Moscou, Ankara cherche à jouer sur la corde du conservatisme et populisme pour plaire à son peuple tout en faisant croire que le monde entier est contre eux. Mais la réalité serait que ces nations ne font peur à presque personne et qu’elles vont naturellement s’autodétruire ?
La Turquie n’est pas du tout moribonde, elle est en plein essor depuis la fin du XXe siècle. Il faut se rendre compte qu’en 1920, la Turquie comptait 13 millions d’habitants, alors que les grandes puissances européennes tournaient autour de 50 millions d’habitants. Aujourd’hui, avec près de 84 millions d’habitants, la Turquie est démographiquement devant n’importe quel pays de l’Union européenne, Allemagne y compris – d’autant qu’il y a en Allemagne un million et demi de Turcs, et que la réciproque n’est évidemment pas vraie. En parité de pouvoir d’achat, le PIB de la Turquie se trouve entre celui de la Corée du Sud et celui de l’Italie, et représente les trois quarts de celui de la France. En matière industrielle et technologique, la Turquie rattrape son retard et travaille notamment à se construire un complexe militaro-industriel. D’ores et déjà, elle fabrique ses propres drones. Je sais que l’on a souvent envie de se rassurer en se disant que nos adversaires vont finir par s’effondrer tout seuls : depuis au moins dix ans on entend souvent les commentateurs se demander si ce n’est pas le début de la fin pour Poutine à la première manifestation qui se tient en Russie. Dernièrement, c’est le Covid qui devait coûter sa place au maître du Kremlin. Le même genre de raisonnement est tenu à propos d’Erdogan ou même de Xi Jinping. Ce sont, là encore, des raisonnements de comptables occidentaux qui pensent que la santé économique fait tout, alors que ce n’est qu’une partie de la politique. Il y a là quelque chose qui tient du syndrome du vainqueur de la Guerre froide, de l’idée que l’Ouest a gagné parce que l’économie tournait bien, et que l’URSS a perdu en raison de ses difficultés économiques. Cette vision omet que la première condition de la chute d’un régime est sa délégitimation, qui est distincte de la ruine économique. Un régime ruiné dont la légitimité n’est pas anéantie dans la masse du peuple peut durer très longtemps. L’URSS n’est pas tombée parce qu’elle était ruinée, mais parce que sa ruine se cumulait à de graves échecs qui avaient discrédité le régime : la défaite militaire en Afghanistan, la catastrophe industrielle de Tchernobyl. Pour faire tomber un Erdogan, on ne peut pas faire l’économie d’une confrontation humiliante pour lui, car toutes ses rodomontades et ses manœuvres agressives laissées sans réponse ne font que renforcer sa légitimité nationaliste.
DM – Merci pour ces réponses éclaircissantes. Où peut-on vous retrouver ?
On peut me retrouver sur www.historionomie.net, et sur ma chaîne YouTube.