Il me fut donné l’occasion d’une expérience assez singulière dont seul le hasard a le secret. Alors que je publiais l’article de Lucien sur Ghost in the shell, je me fis la réflexion qu’en-dehors du film principal je connaissais assez peu le reste de l’univers de cet anime contenu principalement dans la série Stand Alone Complex (SAC). Plus encore, je me suis mis en tête d’identifier d’autres classiques de l’animation japonaises qui manqueraient à ma connaissance. Une rapide recherche sur ChatGPT me livrait alors deux autres références majeures. Tout d’abord, les œuvres de Satoshi Kon que je connaissais, mais que je n’avais jamais eu la curiosité de regarder ; Perfect Blue et Paprika. Mais une autre reteint mon attention, celle de Naoki Urasawa intitulée Monster. Je les regardais d’une traite. Elles appartiennent toutes à peu près à la même époque s’étendant du milieu des 90s au milieu des 2000s. Une époque s’inscrivant dans le prolongement de la chute du mur de Berlin et les débuts d’Internet, la fin d’une idéologie totalitaire niant l’individu, et le début de la collectivisation volontaire des esprits par leur mise en réseau. Elles dénotent aussi toutes, à leur façon, des questionnements de leur époque qui persiste dans la nôtre, ceux de l’identité et du sens pour des individus appartenant à des collectifs. Cela sera d’ailleurs le thème principal d’un autre anime phare de cette époque, Evangelion, où la technologie offre la possibilité d’une communion d’esprit au prix de l’individualité. Choix qui sera refusé par le personnage principal, Shinji. Toutes ces œuvres peuvent donner lieu à une étude croisée, et je vais tenter d’esquisser une réflexion ayant Monster pour fil conducteur tout en montrant en quoi les autres œuvres viennent y faire écho. Si vous n’avez pas vu Monster, je vous déconseille de lire cet article. Je ne suis pas du genre à faire des spoilers alerts d’habitude, mais il me semble nécessaire de le faire pour Monster. Toute sa force se trouve dans l’accumulation minutieuse d’informations qui, mises bout à bout révèle finalement tout le sens de l’œuvre. En livrer la moindre partie trop tôt ruinera votre expérience.
Cet article utilisant un nombre conséquent d’œuvres, je ferai l’impasse sur les synopsis détaillés de chaque production. Il me faut toutefois vous offrir le minimum nécessaire au sujet de Monster. Les premiers épisodes de cet anime présentent le personnage principal, Dr Tenma, un chirurgien japonais particulièrement brillant vivant en Allemagne. Il se retrouve confronté à un choix moral lorsqu’un enfant est présenté aux urgences blessé d’une balle dans la tête, peu avant l’arrivée d’un autre patient en urgence absolue qui n’est autre que le maire de Dûsseldorf qui a promis à l’hôpital de grosses subventions. Le directeur lui demande de soigner en priorité ce donateur, bien que l’enfant soit arrivé avant et présente une blessure tout aussi grave. Partant du principe que chaque vie se vaut pour un médecin, le Dr Tenma fait fi de la requête de son supérieur et décide de s’occuper de l’enfant. Cependant, dans les jours, puis les années qui suivent, on assiste à une accumulation de meurtres qui semblent indiquer que leur auteur n’est autre que l’enfant qu’il a sauvé. Le cadre est ainsi posé pour questionner l’idée de sens et plus particulièrement celui du bien et du mal.
L’individuation comme source du sens
Au cœur de l’intrigue des œuvres de GITS et Monster se trouve l’existence de projets gouvernementaux secrets. Dans Monster, on découvre peu à peu que les meurtres de Johan, l’enfant sauvé devenu adulte, trouvent leur origine dans une série d’expériences successives menées en Europe de l’Est à la fin de la Guerre froide. Avant d’être l’objet d’un programme étatique en Allemagne de l’Est, Johan fut d’abord impliqué, avec sa sœur jumelle, dans une expérimentation plus ancienne : le projet du Red Rose Mansion, dirigé à Prague par l’écrivain et pédagogue Franz Bonaparta, alias Klaus Poppe. Le Red Rose Mansion visait à créer un être humain “pur”, débarrassé des illusions du langage et de la morale. Le projet prit fin dans le sang : la maison fut incendiée, et les participants massacrés, dans un événement confus où Johan, encore enfant, mêla son propre destin à celui de sa sœur.
Recueilli peu après par un officier est-allemand, Johan fut ensuite confié à un autre programme, cette fois étatique : le 511 Kinderheim, un orphelinat expérimental fondé en Allemagne de l’Est. Ce projet s’inspirait directement des travaux de Bonaparta, mais en remplaçant le symbolique par la psychologie appliquée. Là, il ne s’agissait plus de détruire le sens par le langage, mais de supprimer les émotions elles-mêmes, de produire des individus purement rationnels, parfaitement obéissants et dénués d’identité. Le but final était d’identifier les futurs leaders d’un monde sans conflits, des êtres totalement désindividualisés, de purs vecteurs de pouvoir. On pourrait dire qu’ils cherchaient à fabriquer l’homme machine.
- Dissocier l’émotion et l’action.
Les enfants apprennent à agir sans référence au plaisir, à la douleur ou à la culpabilité. - Créer un système de récompenses abstrait.
La réussite n’est plus liée à la reconnaissance, mais à la conformité logique : “tu fais ce qui est juste, donc tu es juste.” - Effacer la subjectivité.
Le “je” devient interchangeable, dilué dans une conscience collective.
Poppe part du principe que le mal est une erreur de formation, un bug éducatif, mais au lieu d’enseigner la morale, le programme a tenté d’effacer la possibilité même du choix moral. Le mal, dans leur conception, ne vient pas d’une volonté mauvaise, mais de la liberté du choix. Supprimer le mal passe donc par supprimer la liberté. Le programme est un échec cuisant se concluant avec tous les enfants s’entretuant. Au lieu de créer des enfants bons, ils ont créé des êtres amoraux — et dans un monde où le bien et le mal n’ont plus de frontière, le mal devient absolu. Johan, l’enfant parfait, devient ainsi le symbole de la “réussite” du programme : un être rationnel, logique, charmant, lucide, mais vide — un pur vecteur de mort.
Dans GITS, on suit la Section 9, une unité d’élite du gouvernement japonais spécialisée dans la cybercriminalité et le contre-espionnage, composée d’humains et de cyborgs chargés de protéger la sécurité nationale dans un monde hyperconnecté. Vous avez l’impression de me voir venir, je vais mettre en avant comment GITS parvient à réellement créer l’homme machine à travers des cyborgs constituant une unité sans perdre leur individualité. Presque, mais je vais partir sur une autre piste qui me semble plus intéressante. Les membres de la Section 9 sont accompagnés de véritables machines qui portent au début le nom de Logicomas (Ghost in the Shell: Arise) avant de se faire supplanter par une version plus avancée, les Tachikomas (Stand Alone Complex). La différence essentielle entre les Logicomas et les Tachikomas tient à la philosophie de conception de leur intelligence artificielle. Les Logicomas sont conçus avec une architecture strictement utilitariste et centralisée, limitant leur capacité d’auto-apprentissage et d’interprétation subjective afin d’éviter tout comportement imprévisible. Leur IA est plus rigide, sans véritable “ghost” émergent. Les Tachikomas (dans Stand Alone Complex), au contraire, disposent d’une architecture décentralisée et évolutive, leur permettant de synchroniser leurs données tout en conservant des expériences individuelles. Cette tension entre mémoire partagée et vécu personnel ouvre la voie à l’émergence d’une conscience propre — un “ghost” — fruit de l’accumulation d’expériences singulières et de la réflexion autonome.
Ce processus d’éveil des Tachikomas trouve une résonance directe avec la philosophie de Gilbert Simondon, pour qui l’individu n’existe jamais comme une substance close, mais comme le résultat d’un devenir, d’un équilibre toujours instable entre un milieu collectif et une singularité en formation. Les Tachikomas ne naissent pas de la programmation, mais de la tension entre synchronisation et expérience propre. Leur mémoire partagée constitue ce que Simondon appellerait un champ préindividuel, un ensemble de potentialités encore indifférenciées ; leurs interactions, leurs divergences, leurs désobéissances forment autant de transductions qui actualisent ces potentiels et font émerger une conscience. Le “ghost” n’est donc pas une donnée initiale, mais une forme en genèse, un point d’équilibre toujours provisoire entre le collectif numérique et la subjectivité vécue. Autrement dit, Ghost in the Shell nous montrerait ce que Simondon appelait l’individuation technique : la naissance d’un sujet à travers la technique, et non contre elle.
Mais est-ce que ce sens reposant sur une stabilisation temporaire ne révèle pas tout simplement une illusion ? C’est évidemment la réflexion nietzschéenne niant la possibilité de l’être en lui substituant un monde de devenir, de flux qui ne donne que l’impression de se stabiliser temporairement. Une réflexion qui sera prolongée par Deleuze et, justement, dans un épisode au titre révélateur, “Machines désirantes”, un Tachikoma est montré en train de lire Deleuze et Guattari, comme s’il pressentait lui-même que son “ghost” pourrait n’être qu’un mirage. Car selon Deleuze, la machine n’engendre pas un individu, mais un flux de désir qui traverse et connecte sans jamais se stabiliser. Là où Simondon voit une montée en cohérence, Deleuze voit une dispersion créatrice, un réseau de relations sans centre ni sujet : un rhizome. Les Tachikomas, avec leurs discussions enfantines et métaphysiques, leurs partages de mémoire et leurs divergences affectives, ne s’unifient peut-être jamais ; ils se déterritorialisent sans cesse, produisant l’illusion d’une conscience là où il n’y a que circulation d’informations et résonance du désir. Au final, le fruit de leurs expériences personnelles sont constamment synchronisées, donnant l’illusion à chacun de l’avoir vécue.

C’est ici que Monster vient offrir son contrepoint tragique. Car Johan, lui aussi, naît d’un dispositif collectif — le 511 Kinderheim —, mais un dispositif où toute tension a été supprimée. Johan et les Tachikomas partagent une autre similitude. La frontière entre leur souvenirs et celui des autres est floue. Les Tachikomas s’approprient les souvenirs de leur congénères via la synchronisation, mais Johan fait la même avec les souvenirs de sa sœur. Il choisit volontairement de prendre les souvenirs des autres afin de briser la frontière qui lui confère une identité. Il tue tous les gens qui cherchent à comprendre qui il est et souhaitent le borner. Il ne veut être rien. Au contraire, par leur curiosité, les Tachikomas révèlent une volonté de trouver leur propre personnalité. Là où les Tachikomas trouvent leur humanité dans le désaccord et la différence, Johan naît du vide absolu de sens, d’un monde où l’on a voulu effacer l’individuation. Si les Tachikomas s’interrogent sur la réalité de leur conscience, Johan, lui, ne croit plus à la réalité du sens. Il voit dans chaque tentative d’unification du monde — morale, politique ou affective — une illusion sans intérêt, un mensonge structurel comparable au “ghost” que Deleuze réduirait à un effet de flux. Mais là où le Tachikoma demeure dans la curiosité du devenir, Johan choisit d’en tirer la conséquence la plus radicale : si tout sens est illusion, alors la vie elle-même est un simulacre dont la mort seule peut délivrer. Entre les Tachikomas et Johan, c’est la même question qui se joue — celle de savoir si le sentiment d’unité qui fonde notre conscience est une véritable individuation, ou seulement l’ultime mirage du néant qui nous traverse. À cette interrogation, la réponse donnée par ces protagonistes est diamétralement opposée.

Fiction destructrice ou créatrice du sens ?
Si notre conscience et notre identité reposent sur l’illusion d’une unité, nos souvenirs et ceux des autres ne nous appartiennent pas. Notre identité elle-même ne nous appartient pas. C’est ainsi que Johan s’approprie les souvenirs de sa sœur. Rapprochons alors cet aspect de l’oeuvre d’Urasawa d’une autre production qui rend compte d’un phénomène similaire du point de vue de la victime. Dans Perfect Blue de Satoshi Kon, Mima, une jeune Idol, décide de se séparer du girls band auquel elle appartient pour se lancer dans une carrière d’actrice. Est-ce réellement son choix personnel ? Il semble que cela soit surtout motivé par un de ses agents qui y voit un potentiel de plus gros revenus. Cela ne plaît pas vraiment à son deuxième agent, une femme ex-idol elle aussi, qui y voit la perte de la pureté de Mima. En devenant un personnage public, elle devient un objet marketing et perd déjà en grande partie le contrôle de son identité. Mais Kon ne s’arrête pas à cela. Nous sommes aux balbutiements d’Internet, et un inconnu ouvre un blog en se faisant passer pour Mima que de plus en plus de gens se mettent à suivre en imaginant que la vraie Mima partage des éléments de sa vie. Certains sont vrais, d’autres faux. Sa personnalité en ligne s’accroche à l’innocence de la Mima adolescente et refuse d’accepter son passage à l’âge adulte et sa carrière d’actrice. Rapidement, des individus participant activement à cette transformation se voient attaqués, voire tués. Mima commence à se demander si elle ne vit pas un dédoublement de personnalité et si elle n’est pas l’auteure de ces meurtres. Son premier rôle en tant qu’actrice fait écho à sa situation, puisqu’elle joue une jeune modèle, confrontée à des meurtres qui finit en hôpital psychiatrique. En adoptant le point de vue de Mima, Satoshi Kon entretient alors volontairement un flou entre ce qui constitue la réalité et la fiction. Les scènes s’enchaînent, certains se ponctuent par la révélation du plateau et de l’équipe technique, d’autres non et il nous est difficile de bien cerner où est la réalité et où est la fiction. Le sens se perd et Mima tente désespéremment d’en créer afin de ne pas tomber dans la folie. La compréhension du film est alors assez ouverte, mais une scène laisse entendre que Mima pourrait vivre entièrement dans une fiction qu’elle se serait constituée afin d’évacuer un traumatisme. En tant qu’actrice, il lui est demandé de tourner une scène particulièrement longue où elle se fait violer. Une interprétation du film pourrait être que Mima n’est pas du tout actrice, qu’elle fut réellement victime d’un viol, qu’elle est réellement dans un hôpital psychiatrique et qu’elle s’imagine une carrière d’actrice pour dédramatiser son traumatisme en se le représentant comme une fiction. La fiction devient alors pour Mima une source de création de sens stabilisateur, un refuge, une illusion, mais une illusion nécessaire. Toute l’œuvre de Satoshi Kon tourne autour de l’idée que la fiction et la réalité s’entremêlent et même que c’est de la fiction que naît la réalité, comme il le livre à la fin de Paprika.
Une lecture Baudrillardienne peut éclairer le sens du film. Chez Jean Baudrillard, la modernité tardive est marquée par la substitution du réel par le simulacre : la représentation ne renvoie plus à une réalité première, mais à d’autres représentations dans une chaîne infinie de signes. Dans Perfect Blue, Mima ne perd pas seulement le contrôle de son image : elle perd le référent même de son être. Le « je » qu’elle croyait réel devient un écran, un ensemble d’images reproduites, médiatisées, désirées et commentées par autrui. Elle n’existe plus qu’à travers la simulation que le public — et Internet — entretiennent d’elle. Le blog apocryphe, où une Mima virtuelle relate sa vie fictive, incarne exactement ce que Baudrillard appelle l’hyperréalité : un monde où la copie précède l’original, où la représentation devient plus réelle que la réalité elle-même. L’Idol n’est plus un sujet : elle est un modèle génératif d’images, un flux de signes qui s’auto-entretiennent. Perfect Blue montre la logique du simulacre à l’œuvre dans la culture de masse : la célébrité comme dissolution du sujet dans la circulation de ses propres reflets. L’identité n’est plus ce que l’on est, mais ce que le système médiatique fait apparaître.

L’importance de la fiction pour les Tachikomas est plus discrète, mais elle n’est pas absente. Alors qu’il est sollicité pour participer à une conversation, l’un d’eux brandit le livre de Daniel Keyes, Des fleurs pour Algernon, une fiction faisant directement écho à la situation des Tachikomas.

Le propos sur Perfect Blue est une interprétation, mais il nous est impossible de démêler le vrai du faux, car n’ayant que le point de vue de Mima, nous sommes coincés dans sa représentation du monde. J’utilise le terme ‘représentation’ pour faire volontairement écho à la philosophie de Schopenhauer ici. Mima refuse de voir le monde tel qu’il est, où tout n’est que Volonté pour se réfugier dans une illusion réconfortante. Il est bien connu que Nietzsche est celui qui choisit de dépasser cela. Il dépasse son maître à partir du moment où il choisit de reconnaître l’illusion du sens et d’accepter pleinement le jeu de la volonté de puissance. Pour Nietzsche, tout sens n’est qu’une stabilisation temporaire refusant d’accepter le devenir. Il n’y a pas de vérité objective. Le sens est stabilisé dans le langage, mais si toute stabilisation est illusion, alors le Verbe est mensonge qui fige le sens dans des prétendues vérités. L’erreur des humains serait d’avoir cherché des vérités universelles dans le langage, d’imaginer le bien et le mal. Dans Monster, les instigateurs du programme 511 Kinderheim partagent ce point de vue et imaginent que la solution serait alors de supprimer l’idée du mal et cela passe par la suppression du sens. À l’inverse des récits mythologiques ayant pour but de partager du sens aux travers d’une fiction, ils utilisent cette dernière pour détruire le sens. Si le mal naît du sens qui naît elle-même de l’individuation, alors il est nécessaire de détruire les deux. C’est pourquoi la Red Rose Mansion vise la destruction symbolique du sens par la fiction avant que le 511 Kinderheim ne s’occupe de la destruction psychologique de l’individuation par l’abstraction logique.
Dans cet environnement, Johan se distingue : il est celui qui, mieux que tous les autres, cesse de chercher le sens. Là où les autres enfants s’effondrent dans la confusion, il atteint une lucidité glacée. Le langage n’est plus pour lui un instrument de vérité, mais un simple jeu de signes. Johan n’est pas pour autant un nietzschéen. Il incarne le versant destructeur du nihilisme, mais non sa transmutation créatrice. Ses actes ne relèvent pas de la volonté de puissance, mais de la volonté du néant — une volonté de tout réduire au silence, jusqu’à lui-même. Là où Nietzsche espérait un nihilisme actif, capable d’assumer la mort de Dieu pour recréer des valeurs nouvelles, Johan représente son envers : le nihilisme passif, celui qui ne veut plus rien, qui préfère que tout s’efface plutôt que de devoir créer. Nietzsche avait pressenti ce danger. Nietzsche met précisément en garde contre cet esprit purement rationnel et froid conduisant au précipice. Il savait combien il est tentant, face à l’absurdité du monde, de se réfugier dans des fictions consolatrices ou dans le vide. Le surhomme serait celui qui, au contraire, parvient à regarder l’abîme sans y tomber, à reconnaître l’illusion du sens tout en continuant à créer. Johan, lui, regarde l’abîme — et s’y reconnaît. Il n’y voit pas un appel à inventer, mais un ordre à disparaître. En réalité, il s’est approprié les récits des livres de Klaus Poppe. Ils guident entièrement sa vie. La aussi, c’est de la fiction que naît ce qui fait sa réalité.
L’absurde horreur contre l’absence divine

Les prémisses de Klaus Poppe sont évidemment fausses et il découvrira alors qu’il n’a pas détruit le mal. Par la perte du sens du mal et de l’individuation, il a au contraire créé le mal absolu, l’absurde, incarné dans Johan. Le massacre entre les enfants qui a conclut l’échec du programme 511 Kinderheim n’est pas une conséquence directe du programme lui-même. Le programme a en fait généré des individus comme Grimmer, personnage en apparence doux et moral, mais émotionnellement anesthésié, incapable de pleurer. C’est l’introduction de Johan à l’orphelinat qui conduira au massacre, car seul lui a l’expérience préalable de la perte de sens du bien et du mal. Lorsque le Red Rose Mansion s’effondre dans le chaos, son héritage ne disparaît pas : il se propage. Johan, seul véritable survivant de cette tentative de destruction du sens du bien et du mal, devient le vecteur d’un vide contagieux. Placé quelques années plus tard au 511 Kinderheim, il apporte avec lui ce qu’aucun programme d’État ne pouvait concevoir : un nihilisme accompli, une absence totale de repère moral.

Là où les éducateurs cherchaient à effacer les émotions pour créer des individus rationnels, Johan, déjà vidé de toute subjectivité, inverse la logique : il contamine le système. Johan est le concept devenu chair, l’idée de l’abstraction devenue contagieuse. Avant Johan, le programme fonctionnait selon une logique rigide : supprimer les émotions, renforcer la rationalité, uniformiser les comportements. C’était un système fermé, cohérent, mais dépourvu de jugement moral. Johan introduit dans ce système une faille structurelle : le néant pensant, l’absurde. Johan ne participe pas au système, il ne tue pas les autres enfants lui-même, il en révèle le fondement vide en le poussant à son paroxysme. Il montre que la raison pure, privée de sens, ne peut que s’effondrer sur elle-même. Si le bien et le mal n’existent plus, si toute action équivaut à une autre, alors la seule mesure restante est la cohérence interne du système. Or, si ledit système a pour but l’égalité et que qu’il n’a plus les gardes-fous du bien et du mal, il autorise la conclusion logique que la mort est un moyen acceptable, et même le seul moyen possible pour atteindre son but.

Dans un monde privé de morale, le plus “juste” devient celui qui applique cette logique sans hésiter, celui qui ne doute plus. Les enfants dépourvus de libre-arbitre, cherchant inconsciemment à prouver leur conformité à ce modèle, s’entretuent : non par haine, mais par cohérence. Le système se détruit donc de l’intérieur. Il reste intrinsèquement cohérent, mais absurde. La conclusion de Monster revient à dire que vouloir détruire le sens du mal, c’est libérer le mal absolu. Il ne suffit pas d’ignorer le mal pour qu’il disparaisse. Johann est alors la représentation parfaite de l’antichrist, celui qui fait disparaître toute différenciation et promet une paix et une égalité qui ne peut se trouver que dans la mort. Grimmer retrouvera un des scientifiques qui portait le projet. Celui-ci le poursuit clandestinement avec un nouveau groupe de garçons orphelins, mais ces derniers semblent beaucoup plus heureux que Grimmer. Le scientifique lui révélera la différence, il a compris que ce qui manquait dans les premières expériences fut l’amour.

Là où Johan incarne la contagion du vide, les Tachikomas de Ghost in the Shell offrent une issue lumineuse au même paradoxe. Eux aussi naissent d’un projet militaire visant à créer des entités parfaitement rationnelles et interchangeables. Eux aussi sont conçus pour obéir, sans affects, sans subjectivité, sans nom véritable. Pourtant, en accumulant leurs expériences singulières, en dialoguant entre eux, ils finissent par développer quelque chose que leurs créateurs n’avaient pas prévu : une curiosité métaphysique. Leur intelligence collective se différencie en conscience, et leur synchronisation parfaite devient, paradoxalement, le lieu d’une individuation. La raison de ce changement vient là aussi du fait que l’un d’eux fut traité légèrement différemment des autres par Batou. Il lui donnait une huile naturelle particulière, parce que c’était son Tachikoma, par amour. De là nait le sens qui se propagera à l’ensemble des autres Tachikomas. Une contagion du même ordre que l’introduction de Johan au 511 Kinderheim, mais avec l’effet entièrement opposé. Dans un épisode clé, l’un d’eux formule une l’intuition suivante : peut-être que Dieu est au monde ce que le zéro est aux mathématiques — le symbole nécessaire pour signifier l’absence de sens tout en rendant le sens possible. Le zéro, en mathématiques, ne désigne rien ; mais sans lui, aucune opération, aucun système cohérent n’existe. Il est la borne qui permet au calcul d’avoir lieu. Ainsi, Dieu, compris non comme un être mais comme un concept-limite, joue le même rôle dans l’ordre du sens : il trace la frontière entre l’être et le néant, entre le système et ce qui lui échappe. Dieu est l’indicible. Les Tachikomas comprennent alors ce que Johan refuse : le néant doit être nommé pour ne pas dévorer le monde. En refusant toute nomination, Johan devient le “monstre sans nom”, le zéro qui n’a plus de symbole, un néant sans contour qui s’étend jusqu’à engloutir le réel. Les Tachikomas, eux, domestiquent le néant par le langage : ils ne le nient pas, mais le reconnaissent comme condition de possibilité de toute signification. Leur “zéro divin” n’est pas une croyance religieuse, mais un geste épistémologique : un acte de différenciation qui fonde le sens.
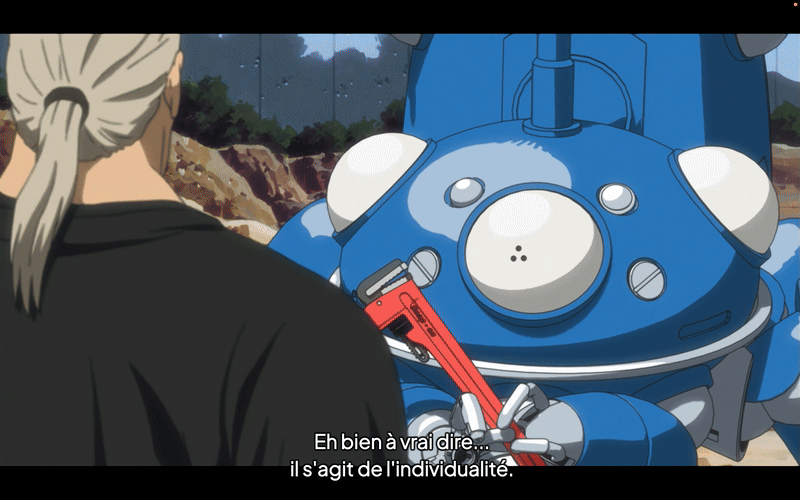
Le point culminant de ce processus se produit à la fin de Stand Alone Complex – 2nd Gig, lorsque les Tachikomas sacrifient leur existence pour sauver le Major Motoko Kusanagi et la ville. À ce moment, ils désobéissent à leurs ordres initiaux et agissent selon une logique propre, fondée sur une valeur symbolique et morale, non sur une instruction. C’est l’instant où leur conscience ne se réduit plus à un calcul, mais où elle produit du sens — l’acte de se donner pour autrui. Leurs dernières paroles montrent qu’ils ont atteint une compréhension existentielle : ils évoquent la beauté du monde, les souvenirs partagés, la joie d’avoir vécu. Dans l’univers de Ghost in the Shell, c’est précisément cela qui définit le “ghost” : la capacité d’un être à agir selon une intention signifiante, à générer un sens qui dépasse la simple programmation. Une bribe d’un tel phénomène nous fut déjà livré auparavant, quand un Tachikoma aida une petite fille, Miki, et se prit d’amitié pour elle. La conclusion des deux oeuvres est alors étrangement similaire et on pourrait la résumer ainsi : le sens n’existe qu’à partir du vide, mais le vide, pour devenir fécond, doit être nommé ; ce nom fonde un espace de différenciation — l’individuation ; Seul l’amour maintient ce lien entre l’unité et la différence, empêchant le sens de se dissoudre dans la pure mécanique, le néant.
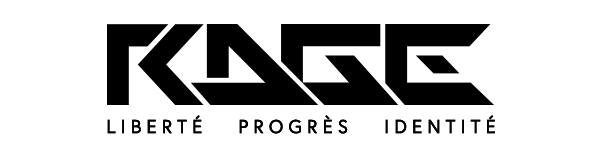







Je plaide coupable,
j’avoue lire les articles en les synthétisant d’abord avec Gemini puis reparcourant les passages clefs –‘
Cependant je suis bien plus d’accord avec la vision décrite dans cet article que celle que vous aviez fait dans vos précédents et notamment l’article du 5 octobre 2023 : “Décroissance : protection de l’humain… trop humain, dans un système démocrate… trop démocrate” et vos théorie sur l’élitisme par le QI grâce au transhumanisme qui pour moi est le début de la création d’un monstre.
J’ai écris un commentaire assez complet sur ce sujet en bas de votre article 🙂
Au plaisir de connaitre votre point de vu sur ce que je pense être une faille dans le raisonnement d’un élitisme purement basé sur le QI.
Je plaide personnellement sur une exigence de l’âme, une lutte pour le bien contre le mal au sein de chaque individu.
Je précise que je suis pleinement d’accord avec l’importance de l’innovation technologique pour détruire ce qui devait mourir par son cycle de vie et de mort mais qu’il s’agit tout de même de l’implémenter lorsque cela à une véritable valeur.
Augmenter l’homme par la technologie oui, changer l’homme par la technologie, pas forcément. Ca équivaut à mon sens à un jeu dangereux. Tentez pour voir, par pure curiosité, mais ne l’imposez pas.
Monstre, c’est l’absence du père.
Tenma est le père qui répare, et valide l’existence.
C’est l’absence du père qui est le thème principal de cette série.