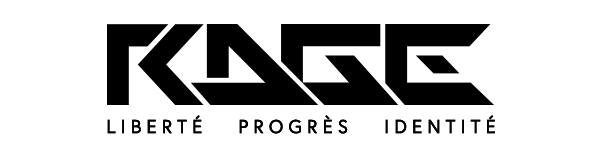Vous trouverez ci-dessous la traduction du premier chapitre d’un romain de Mishima jamais traduit dans son intégralité, La maison de Kyōko. Si l’histoire vous plait, faites-le moi savoir et si on est assez nombreux, alors je pourrais envisager d’obtenir les droits pour une traduction officielle.
Tout le monde bâillait.
— On va où ? demanda Shunkichi.
— Où veux-tu aller à cette heure-ci ?
— Nous, on descend ici, on va chez le coiffeur, dirent Mitsuko et Tamiko, de leur ton plein d’entrain caractéristique.
Shunkichi et Osamu n’émirent aucune objection à ce qu’on dépose les deux jeunes filles là. Seule Kyōko resta dans la voiture. Mitsuko et Tamiko, de leur côté, ne voyaient aucun inconvénient à ce que Kyōko reste seule. Shunkichi et Osamu dirent au-revoir aux filles chacun à sa manière, avec une politesse un peu raide. En revanche, de Natsuo, dont les relations avec elles n’avaient jamais franchi le seuil de l’amitié, elles attendaient un adieu plus doux, presque tendre. Et Natsuo, fidèle à lui-même, leur offrit exactement cela.
On était au tout début d’avril 1954, vers trois heures de l’après-midi. La voiture de Natsuo, conduite par Shunkichi, tourna dans une rue à sens unique. Où aller ? Il leur fallait un endroit calme.
Les bords du lac Ashinoko, où ils venaient de passer les deux derniers jours, étaient bondés ; Un retour à Ginza, d’où ils étaient venus, n’étaient évidemment pas une option.
Dans ces moments-là, on se fiait toujours au bon goût de Natsuo.
— L’autre jour, je suis allé dessiner à Tsukishima. Que diriez-vous des terrains gagnés sur la mer, dans la baie de Tokyo ?
La proposition plut à tous, et la voiture prit cette direction.
De loin déjà, aux abords du pont Kachidoki, on voyait une file de voitures immobiles.
— Qu’est-ce qui se passe ? Un accident ? demanda Osamu.
En regardant mieux, il comprit : c’était l’instant où le tablier basculant se relevait.
Shunkichi claqua la langue.
— Pfff… laisse tomber la baie. C’est agaçant, dit-il.
Mais Natsuo et Kyōko, qui n’avaient encore jamais vu le pont s’ouvrir, tenaient absolument à assister au spectacle. Ils garèrent la voiture et traversèrent l’un après l’autre la passerelle métallique réservée aux piétons. Shunkichi et Osamu n’y prêtèrent guère attention.
La partie centrale du pont, en acier, formait la travée mobile qui se dressait pour laisser passer les navires et redescendait ensuite pour rétablir la circulation. À chaque extrémité, des hommes agitaient des drapeaux rouges devant les files de voitures à l’arrêt. Sur la passerelle latérale, une chaîne barrait le passage. Beaucoup de curieux s’étaient attroupés. D’autres, livreurs, chauffeurs, semblaient goûter cette pause forcée.
Les plaques métalliques de la voie centrale, où couraient aussi les rails du tramway, luisaient d’un noir huileux. Massés aux deux bouts du pont, les spectateurs et leurs voitures regardaient.
Les travées se mirent à monter, lentement, ouvrant une brèche béante. Dans le même mouvement, les garde-fous latéraux, avec leurs arceaux de protection, basculèrent vers le ciel ; les feux qui les coiffaient, à demi allumés, se dressèrent droit au-dessus des têtes. Toute la charpente énorme s’articula en un seul geste continu. Natsuo, saisi, en regardait la beauté mécanique.
Quand les plaques d’acier approchèrent de la verticale, un tourbillon de poussière jaillit des entrailles du tablier et des cavités des rails ; il monta en nuage léger, puis se désintégrait en une pluie fine sur le canal. Les milliers de rivets qui ponctuaient le tablier rapetissèrent peu à peu ; l’ombre des garde-fous se rétrécit, changea d’angle, puis s’immobilisa lorsque les plaques furent presque perpendiculaires. Natsuo leva les yeux, fasciné, vers l’immense arche du pont dont les contreforts s’étaient déjà repliés à l’horizontale ; à cet instant précis, une mouette passa en rasant le ciel.
Ainsi un mur d’acier se dressa devant les quatre jeunes gens.
Ils durent attendre longtemps. Lorsque le pont se remit à descendre, l’envie de pousser jusqu’aux terres gagnées sur la mer de Tsukishima s’était déjà dissoute. Une fois la travée remise en place, Il ne restait plus qu’à traverser, puisque le passage était ouvert. Fatigués par le voyage et le manque de sommeil, ils n’avaient plus le cœur à discuter ni à modifier leurs plans. Leur but, c’était la mer ; ils iraient aussi loin qu’elle les laisserait aller, voilà tout. Peu bavards, bâillant par instants, ils regagnèrent la voiture d’un pas lent.
Le pont Kachidoki franchi, ils pénétrèrent dans la ville de Tsukishima, puis passèrent un second pont, celui de Reimei. Au-delà s’étendait une large plaine bleue-verte, quadrillée jusqu’à l’horizon par des routes formant une grille. La brise marine leur frappait les joues. Shunkichi arrêta la voiture devant un panneau « Accès interdit » planté au bord d’un chemin longeant le périmètre d’une piste d’atterrissage militaire américaine. À côté du bâtiment du quartier général, une allée luisait au soleil.
Descendant de la voiture, Natsuo éprouva une joie nette et se dit à lui-même : « J’aime les ruines et ces terrains arrachés à la mer ». Mais, étant de nature calme et réservée, il ne disait jamais ce qu’il ressentait ; et il n’avait pas non plus le tempérament sombre des esthètes tourmentés. De toute façon, ce genre de confidences n’avait pas sa place dans leur groupe : c’était même pour cela qu’il s’y sentait bien. Il n’en continuait pas moins d’absorber le paysage, d’en scruter sans relâche les nuances.
Au-delà de la plaine artificielle, on distinguait un cargo blanc qui venait de quitter les quais de Toyosu ; sur la cheminée était peint en gros traits le kanji « 井 ». Tout semblait rigoureusement en ordre et d’une beauté parfaite. À cela s’ajoutaient les champs printaniers, épais, qui recouvraient les rectangles géométriques des terrains gagnés sur la mer.
Soudain, Shunkichi partit en courant. Il courait sans s’arrêter ; sa silhouette rapetissait à mesure qu’il s’enfonçait dans la plaine.
— Demain, il reprend l’entraînement… Ça m’énerve de le voir aussi enthousiaste. Au fond, j’envie cette vigueur, cette légèreté. remarqua Osamu, acteur qui ne semblait jamais décrocher de vrai rôle.
— À Hakone, il courait tous les matins. Il se donne à fond dans son entraînement, ajouta Kyōko.
Shunkichi s’était arrêté. De là où il se tenait, les silhouettes de ses trois amis, au loin, semblaient minuscules. Courir était devenu pour lui une nécessité quotidienne ; les jours de pluie, il ne manquait jamais de sauter à la corde vingt minutes d’affilée dans le pavillon de sport.
Il était le plus jeune du cercle de Kyōko. Capitaine de l’équipe de boxe, il terminerait ses études l’année suivante. Tous les autres les avaient déjà finies ; Osamu depuis longtemps, Natsuo aussi.
Shunkichi avait été invité pour la première fois chez Kyōko par Yanagimoto Seiichirō, un amateur de boxe plus âgé que lui. Depuis, avec son détachement habituel, il était devenu membre du groupe. Il n’avait pas de voiture, mais conduisait remarquablement bien, ce qui en faisait un invité précieux. Et puis, être boxeur, au milieu de camarades qui ne partageaient ni son âge ni sa profession ni même son milieu, lui valait une admiration un peu naïve. Malgré son jeune âge, il avait des convictions très fermes, qu’il ne trahissait jamais : dont celle de ne pas ruminer les choses inutilement. À sa manière, c’était sa discipline.
Ce matin même, en courant seul le long du lac Ashinoko, il avait déjà oublié ce qui s’était passé la veille avec Tamiko. Il fallait devenir un homme sans souvenirs.
Le passé… Il n’en conservait qu’une part minimale : les souvenirs nécessaires, ceux qui servaient d’appui et d’élan. Par exemple, le jour de son premier entraînement dans le club de boxe universitaire, trois ans plus tôt ; ou la première fois où il avait fait un sparring avec un camarade plus expérimenté.
En se remémorant ces débuts, il mesurait le chemin parcouru. C’était durant son premier mois au club. Aujourd’hui encore, il sentait très clairement le tissu rugueux du bandage qu’on lui avait passé sur les mains ce jour-là, bien qu’il les eût lavées des centaines de fois depuis. Le coton épais serré contre le dos de la main et la base des jointures, enroulé encore et encore, presque rituellement. Il aimait déjà ses mains robustes : de larges mains solides, comme des maillets de bois. Les lignes simples de sa paume formaient un dessin sans complication : rien qui aurait réjoui un chiromancien. À chaque flexion des doigts, ces lignes ressortaient comme gravées dans la chair.
Shunkichi se laissa envahir par ces souvenirs. Il se revoyait, bras tendus, tandis que deux camarades vétérans lui enfonçaient des gants usés de 340 grammes. Du véritable cuir tanné, fendu par endroits, laissant luire des fils blancs dans les craquelures violettes : plus que des gants, des reliques. Mais l’intérieur, vaste et râpé, était chaud, doux. Les lacets furent serrés fermement autour de ses poignets.
— Ça serre ?
— Celui de la main droite, un peu.
Pendant un mois entier, il avait rêvé d’entendre ces mots au bord du ring. Deux vétérans prenaient soin de lui comme on nourrit un animal qu’on va lancer au combat. Le moment où ils nouaient les gants à ses poignets était, pour lui, d’une émotion muette. Il aspirait à toutes les petites cérémonies de la vie du boxeur, comme ce moment où, dans la minute de repos, l’assistant lui tendait une canette vide remplie d’eau pour se rincer la bouche.
— Après tout, on le fait pour la guerre. Il faut bien prendre soin des guerriers.
Son assistant lui posa ensuite pour la première fois le casque d’entraînement. Il se souvenait encore de l’impression que lui fit ce couronnement de vieux cuir. La sensation de la pression du casque sur ses lobes rougies brûlants, dont seules deux ouvertures lui donnaient un peu de répit et d’air frais au niveau des oreilles.
Il avait immédiatement essayé les gants, se donnant de légers coups au menton, au nez, au sourcil. D’abord doucement, puis de plus en plus fort. Une ombre brûlante et lourde semblait s’écraser contre son visage.
— Tous ceux qui montent pour la première fois en sparring font ça, dit le vétéran à côté de lui.
Shunkichi rougit en y repensant. C’était le moment de monter sur le ring. La cloche retentit ; il comprit aussitôt la dureté du combat. Bien plus violente que n’importe quelle mise à l’épreuve précédente. Malgré ses nombreuses tentatives, aucun de ses coups ne touchait. Ceux de l’adversaire, au contraire, pleuvaient : visage, estomac, foie… nets et impitoyables. Il avait l’impression d’affronter le bodhisattva Kannon, ce dieu légendaire aux bras et aux yeux innombrables. Au second round, sa main gauche s’affaiblit ; les coups devenaient aussi mous que du coton. Pourtant, ce fut le moment que choisit son adversaire pour l’encourager :
— Beau gauche !
L’espace d’un instant, Shunkichi perçut dans ces mots entrecoupés un léger essoufflement. Quelle joie de sentir cette petite faiblesse pointer chez son adversaire. Il tirait de cette allégresse un regain de puissance.
Il regarda la mer grisâtre du printemps. Au large, un cargo de cinq mille tonnes, du type qu’on trouvait aux alentours de Mishima. Une couverture de nuages informes voilait la mer calme à l’horizon. Le soleil brillant rendait le blanc entre eux d’autant plus pur.
Shunkichi leva les poings face à la mer. Son démon intérieur faisait surface. C’était aussi ce démon qui lui avait soufflé à l’oreille l’idée de devenir boxeur.
Il n’était pas question de shadow-boxing contre un ennemi invisible. Son adversaire était bien réel ; c’était cette mer trouble et immense ; la succession de vagues brisant doucement au loin, la houle de la haute mer déferlant sur les rochers. Un ennemi qui ne ripostait jamais, mais qui avait pour arme une placidité terrifiante qui menaçait de l’engloutir par son immensité dans un sourire léger continu.
Pendant qu’ils attendaient le retour de Shunkichi, les trois autres s’assirent sur des blocs de pierre destinés au chantier et fumèrent une cigarette. Dans ces moments-là, celui qui semblait le mieux fait pour l’oisiveté, au point de donner l’impression de n’être même pas là, c’était Osamu. Kyōko et Natsuo avaient depuis longtemps remarqué ce trait. Dès l’instant où il se taisait un peu trop longtemps, une muraille invisible se dressait autour de lui, un rempart qui n’avait l’air de rien et qui pourtant interdisait à quiconque d’entrer ; son monde à lui seul apparaissait alors, clos à toute intervention extérieure. C’est pour cela qu’on le trouvait parfois ennuyeux ou trop absorbé. Pourtant, il n’avait rien d’un rêveur. Il n’était ni rêveur ni réaliste. Il était seulement comme il était, Osamu. Kyōko, habituée à son caractère, ne s’interrogeait plus sur ses pensées.
On ne pouvait pas dire non plus qu’il fût solitaire. Rares étaient les hommes qui, seuls, donnaient si peu l’impression de l’être. Il mâchait en permanence une inquiétude confortable qu’il fabriquait lui-même, comme on mâche un chewing-gum. « Je suis là, en ce moment, j’existe réellement », se disait-il en lui-même, mais au fond, était-il vraiment là ?
Shunkichi revenait en courant. Sa silhouette grandissait sur l’horizon. L’ombre de ses genoux se projetait sous la lumière oblique. Enfin son visage rouge, mouillé de sueur, s’approcha ; il respirait encore vite mais sans forcer.
— Alors ? La mer, comment elle sentait ? demanda Kyōko.
— Elle sentait l’ammoniac, répondit-il.
Natsuo regarda l’horizon. La ligne de flottaison du cargo était peinte en deux couleurs : une bande noire au-dessus, un rouge vif en dessous. La précision de ces lignes tranchait nettement. On aurait dit que l’horizon lui-même était quadrillé de tracés mathématiques. Dans la brume, pourtant, certaines lignes tracées par la proue du cargo se perdaient comme des algues flottantes.
Osamu, absent, se souvenait soudain de la soirée de la première représentation du groupe de théâtre étudiant. Il était debout sur scène, dans un uniforme de garçon d’hôtel. Il avait senti l’obscurité de l’amphithéâtre monter devant les planches, et sa silhouette s’éclairer sous les projecteurs, tandis que le public disparaissait dans l’ombre. Cette énigme l’inquiétait. Il avait la sensation d’être absorbé par des regards invisibles, de devenir la proie de vies étrangères.
Quant à Kyōko, elle aimait laisser les jeunes hommes libres, elle savourait même de les observer des cet état hébété, absents. Elle voyait bien qu’aucun ne pensait plus à la femme avec qui il avait passé la nuit. Le voyage touchait à sa fin ; la fatigue pesait, et éveillait en elle des émotions nouvelles. Sa seule préoccupation était de savoir si le vent marin, qui se renforçait peu à peu, n’allait pas la décoiffer. Elle porta les mains à ses cheveux. En se tournant vers la voiture, elle aperçut un groupe de quatre ou cinq hommes qui regardaient dans leur direction en riant.
Ils portaient des vestes de travail tachées de terre, des monpes et étaient chaussés de jika-tabi. Sans doute des ouvriers d’une usine proche. L’un d’eux avait un essuie-mains noué autour de la tête comme un bandeau. On ne les avait pas entendus jusqu’ici, mais quand ils virent le visage de Kyōko se tourner vers eux, leurs rires épais trahit leur ivresse. L’un ramassa une pierre blanche et la jeta sur le toit de la voiture. Quand elle se fracassa dans un bruit sec, Ils éclatèrent de rire de plus belle.
Shunkichi se leva. Kyōko aussi, tentant de le retenir.
Osamu sortit lentement de sa torpeur, ou plutôt de la brume qui lui servait de réalité. Avant même que l’idée d’agir ne l’ait effleuré, il avait déjà capitulé. Il n’avait jamais eu à se battre. Et surtout, il lui était impossible de croire à la réalité d’un événement qui surgissait ainsi sous ses yeux sans prévenir.
Natsuo, conscient lui aussi de sa faiblesse physique, se plaça néanmoins instinctivement devant Kyōko comme un bouclier. La voiture, achetée par son père un mois plus tôt, qu’il n’osait pas conduire lui-même et confiait à Shunkichi, venait d’être rayée. Il l’imagina déjà mise en pièces, sa laque égratignée, détruite. Et pourtant, lui qui depuis l’enfance se désintéressait des biens matériels, il regardait la voiture se faire saccager, presque hypnotisé par l’imminence du désastre.
Shunkichi s’était déjà planté devant le véhicule, encerclé par les quatre hommes.
— Qu’est-ce que vous foutez ? lança-t-il d’une voix forte.
Osamu, agacé, pensa : « Voilà qu’il proteste. C’est bien lui, ça, il se plaint. Et pour quoi faire ? Cette voiture n’est même pas à lui. » Il se trompait pourtant sur les intentions de Shunkichi, qui n’avaient rien à voir avec un quelconque sens de la justice.
Les ouvriers, la mine fermée, marmonnaient entre eux. Leurs insultes n’avaient rien d’original. Shunkichi écoutait sans bouger. Il distingua quelques grossièretés visant Kyōko. Que des jeunes traînent là, en plein midi, à flirter avec une femme, semblait les exaspérer. Celui qui avait lancé la pierre, l’un des plus âgés, avait sans doute cru, à tort, que Shunkichi était le propriétaire de la voiture : il l’appela « le fils à papa ! ». L’injure, mal adressée, raffermit encore son courage. Il arrive qu’un malentendu de ce genre soit exactement ce qu’il faut pour se battre.
Une nouvelle pierre vint frapper une vitre. Le verre ne se brisa pas, mais se couvrit d’une fissure en étoile.
Shunkichi avait attrapé le poignet du lanceur au moment où celui-ci projetait son geste, ce qui avait suffi à amortir l’impact. Dans le même temps, un autre ouvrier tenta de le faucher avec ses jika-tabi, mais manqua sa cible. Shunkichi pivota et lui donna un coup de tête. L’homme tituba en arrière, avant de s’effondrer dans l’herbe.
Kyōko poussa un cri : le plus âgé s’apprêtait à lancer une pierre dans le dos de Shunkichi. Encore penché après son coup de tête, il se tourna d’un bond, esquiva l’homme qui fondait sur lui, le laissa trébucher, puis le saisit par les revers de sa veste de travail et lui envoya un direct à la joue.
Le cri de Kyōko attira l’attention des deux derniers. Ils aperçurent alors le petit gaillard frêle qui la protégeait, et, derrière eux, le jeune homme à l’air absent, aux vêtements chics. Une main énorme, sale, attrapa Kyōko par l’épaule, la tirant par sa robe.
Shunkichi se glissa de côté et arracha aussitôt cette main de l’épaule de Kyōko. Mais l’homme lui asséna alors un coup en pleine poitrine. Il recula de deux ou trois pas, sans tomber. Il aperçut alors la chemise blanche de l’homme, tendue sur un ventre qui ondulait, et, dessous, la boucle d’une ceinture au plaqué or écaillé par lambeaux. Une boucle de cuivre criarde, affublée d’une énorme pivoine argentée qui saillait grotesquement. Il se dit qu’un coup là-dessus risquait de lui ouvrir les phalanges. Dommage d’abîmer des mains aussi précieuses pour une querelle aussi vulgaire.
Son adversaire était hors de lui, ce qui, pour Shunkichi, ne faisait que confirmer qu’il avait déjà gagné. Il enfonça ses poings dans son estomac, en crochets successifs. Ses coups ne rencontraient aucune défense ; il sentait sous ses phalanges la large surface de chair qui absorbait les impacts sans résistance. L’espace devant lui n’était plus qu’une masse compacte de viande humaine. L’ouvrier s’affala sur lui-même, puis s’écroula lourdement au sol.
L’autre prit la fuite.
À ce moment-là, Natsuo sauta dans la voiture et mit le contact. Kyōko, Osamu et Shunkichi montèrent ; la voiture bondit en avant, franchit aussitôt le pont de Reimei et se glissa dans les rues encombrées de Tsukishima. Natsuo lui-même s’étonna de sa conduite, plus sûre qu’il ne l’aurait cru.
Un moment encore, Shunkichi se débattit avec l’arrière-goût amer de la bagarre, cette sensation que son propre corps se ratatinait d’un seul coup. Bientôt pourtant, sa maxime stoïque, « ne rumine pas les choses inutilement », reprit le dessus.
Il s’était interdit l’alcool et le tabac. Les bagarres, comme les femmes, en revanche, étaient inévitables : on ne les choisit pas, elles vous tombent dessus. Shunkichi n’était pas seul à vivre ainsi dans une forme de stoïcisme. Le groupe d’hommes qui avait pris l’habitude de se retrouver chez Kyōko, malgré des métiers et des caractères sans rapport, avait un point commun : chacun, à sa manière, vivait en stoïcien. Osamu était de ce type d’homme. Natsuo était de ce type d’homme. Seiichirō Yanagimoto en était l’épitôme. Ils avaient honte de la plainte et de l’impatience de la jeunesse contemporaine. À force de cacher leurs sentiments, ils avaient poussé l’ascétisme à l’extrême : ils serraient les dents, arboraient un visage gai pour sauver les apparences et se sentaient moralement tenus de faire semblant de ne pas croire à la souffrance. Ils devaient, en somme, renier leur existence.
La voiture prit la direction de la maison de Kyōko, à Shinanomachi, à l’est de Yotsuya.
Il est de ces maisons où les hommes aimaient se retrouver. Celle de Kyōko était l’une d’entre elles. L’atmosphère y était si libre qu’on aurait pu la confondre avec une maison de plaisir. Tout y était permis : plaisanteries, propos absurdes. Pas besoin d’argent ; on y buvait sans payer. Il y avait toujours un visiteur pour amener une bouteille et l’abandonner à son départ. On y trouvait télévision et table de mah-jong. On entrait et sortait à sa guise. Tout dans la maison devenait un bien commun. Si quelqu’un arrivait en voiture, les autres pouvaient en user comme bon leur semblait.
Si le père de Kyōko revenait un jour hanter les lieux, il serait sûrement épouvanté en jetant un œil au registre des visiteurs. Kyōko n’avait aucune conscience de classe ; elle jugeait les gens à leur seul pouvoir de séduction. Dans son salon, toutes les étiquettes de classe avaient été arrachées. Personne n’égalait Kyōko dans l’art de trahir son origine et de briser les cadres sociaux de l’époque. Elle ne lisait presque pas les journaux, et pourtant sa maison avait fini par devenir un réceptacle de tous les courants du temps. Elle avait fini par considérer comme une sorte de maladie incurable le fait qu’aucun préjugé, de quelque nature qu’il soit, ne parvienne jamais à prendre racine dans son cœur. Comme ces enfants de la campagne, élevés dans une propreté trop parfaite, plus vulnérables aux virus, elle avait grandi sans défense au milieu de toutes les idéologies vénéneuses de l’après-guerre ; alors que les autres commençaient à guérir, elle, ne s’en était pas encore remise. Jusqu’à la fin des temps, elle resterait une anarchiste. Quand on la traitait d’« immorale », elle riait de la ringardise du mot, sans voir qu’il était devenu, entre-temps, l’insulte la plus moderne.
Kyōko avait hérité de son père un visage d’une beauté chinoise ; la finesse de ses lèvres semblait parfois exprimer une légère cruauté, mais la partie intérieure, charnue et chaude, formait un contraste parfait avec l’impression glacée du contour. Elle portait à merveille les robes occidentales. L’été venu, elle choisissait des robes légères qui découvraient épaules et bras, avec des motifs voyants qui lui allaient à ravir. Elle respectait scrupuleusement les saisons pour ses vêtements ; seuls les parfums échappaient à toute règle : elle passait de l’un à l’autre, au gré de ses caprices.
Kyōko tolérait la liberté d’autrui au maximum, adorait le désordre plus que quiconque, et était pourtant devenue paradoxalement la plus stoïque de tous. Trop consciente de son propre charme, elle n’avait plus envie d’en goûter les fruits. Elle aimait se montrer, mais cela s’arrêtait là. Elle savourait en secret la réputation sans fondement de sa prétendue immoralité, et plus encore lorsque, par erreur, on l’imaginait danseuse ou entraîneuse de cabaret. Ce tissu de mensonges infondés était devenu sa fierté. Elle parlait toute la journée de coucheries tout en les méprisant intérieurement. La plupart des jeunes hommes qui fréquentaient la maison tombaient sous son charme, puis finissaient par renoncer et se consolaient avec la première jolie fille venue. Observer ce scénario se répéter était pour Kyōko une source de joie presque féroce.
Cette femme, enfant unique gâté qui n’aimait ni les oiseaux, ni les chiens, ni les chats, mais s’intéressait sans relâche aux êtres humains, avait prise pour époux un homme qui adorait les chiens. Ce fut la première cause de leurs disputes, et, au bout du compte, la cause du divorce. Leur fille Masako resta avec Kyōko alors qu’elle mit son mari à la porte ; et avec lui sept chiens de race : plusieurs bergers allemands et un grand danois. La maison se trouva enfin délivrée de l’odeur qui l’emplissait ; moins une odeur de chien que celle d’un homme fétide qui méprisait l’humanité.
Kyōko avait une certitude, qu’elle éprouvait chaque fois qu’elle croisait un couple marié dans la rue. Sans exception, l’homme la regardait discrètement. Elle sentait, avec une évidence presque douloureuse, que ces hommes, tout en se contenant, la désiraient plus que leurs propres femmes. Elle adorait tous ces regards contenus que les hommes posent sur elle. Son mari, lui, ne l’avait jamais regardée ainsi. Même s’il l’aimait encore, ses yeux restaient froids, parfaitement maîtrisés. Et c’est précisément ça qui, un jour, lui fit froid dans le dos : elle comprit que son mari préférait peut-être les chiens parce qu’ils ont, eux aussi, ce regard éternellement contenu, cette soumission muette.
La maison de Kyōko était accrochée en haut d’une coline. Rien qu’en franchissant le portail, on découvrait un vaste jardin en contrebas. Sous la pente, on voyait passer les trains de la gare de Shinanomachi ; au loin se superposaient les arbres de la haute forêt du Meiji Kinenkan et ceux du parc du Palais impérial, leurs masses sombres découpant l’horizon. C’était la saison des fleurs, mais il y avait peu de cerisiers. Dans le vert profond de la forêt du Meiji Kinenkan, un seul grand cerisier éclatait en fleurs. À côté, des arbres plus sombres dressaient leur feuillage complexe comme un éventail, laissant filtrer, par les fentes de leur ramure, la chute du soleil.
Dans le ciel au-dessus de la forêt, des vols de corbeaux passaient occasionnellement, dispersant l’horizon d’une gerbe de points noirs, comme des graines de sésame éparpillées. Depuis l’enfance, Kyōko avait grandi avec ce décor : les vols de corbeaux des jardins du Jingu Gaien, du Meiji Kinenkan, du Palais impérial. Ici, les nids abondaient. On les voyait encore depuis la terrasse du salon. Très loin, une nuée apparaissait ; soudain, elle se dispersait en petites taches noires, et ce spectacle laissait dans le cœur de la petite Kyōko un vague sentiment de mélancolie. Il lui arrivait de les observer longtemps. Quand elle croyait qu’ils avaient disparu, ils réapparaissaient tout à coup, croassant dans les bois qui descendaient sous la maison, leurs cris clairs résonnant dans le ciel… À présent, Kyōko n’y pensait plus guère. Mais Masako, sa fille de huit ans, qui restait souvent seule, épiait elle aussi les corbeaux depuis la terrasse.
Comme on l’a dit, un jardin de style occidental, en accord avec le paysage, s’ouvrait devant l’entrée principale. À gauche se dressait le pavillon ; plus loin, encore sur la gauche, une petite maison japonaise où la famille avait vécu pendant la réquisition du bâtiment principal. La rue devant le portail étant trop étroite pour qu’une voiture y stationne, on avait pris l’habitude de les garer dans la cour intérieure, devant le manoir.
Dès qu’il eut franchi le portail, Natsuo fut frappé par la beauté du crépuscule surplombant la forêt du Palais Impérial. Une fois les autres déposés, il retourna contempler le coucher de soleil.
Tout le monde connaissait le tempérament doux et réservé de Natsuo ; on le laissait donc filer sans rien dire. N’importe qui d’autre, s’il avait essayé de s’éclipser ainsi au lieu d’entrer, aurait dû s’inventer une excuse en béton, sous peine de se voir aussitôt rabroué sèchement d’un « Hé, tu vas où, toi ? ». Mais personne n’aurait même songé à parler à Natsuo sur ce ton.
Ce qui surprenait, chez lui, c’était qu’il ne portait en lui pas la moindre trace de cette « difficulté de vivre » dont souffrent souvent les êtres d’une sensibilité trop fine. Entre son monde intérieur et le monde extérieur, les autres, la société, il n’y avait jamais eu de heurt. Sa sensibilité fonctionnait comme la main d’un voleur en gants blancs, ou comme la dextérité d’un prestidigitateur : elle découpait discrètement dans le réel les tableaux qui lui plaisaient, sans que personne ne s’en aperçoive. Jamais il n’avait souffert de la richesse de ses sentiments ; il vivait dans une clarté intérieure, rare et presque vide.
On l’aimait pour son calme, sa maturité, sa bonté. Était-ce ce caractère qui était venu d’abord et qui avait ensuite nourri sa sensibilité ? Ou bien ce caractère s’était-il façonné pour protéger une sensibilité innée, trop vulnérable ? Lui-même aurait été bien en peine de répondre. Il gardait un équilibre sans le chercher, et parce qu’il n’exigeait aucun sens du monde naturel, la nature elle-même se sentait en sécurité pour lui confier sa beauté. Bien qu’il eût remporté deux années de suite le prix de sélection spéciale depuis sa sortie de l’école des beaux-arts, ce jeune peintre japonais affable et sans prétention ne s’était jamais une seule fois tourmenté de la question de savoir s’il était ou non un génie.
Une fois de plus, ses yeux découpèrent un fragment du monde extérieur. Presque inconsciemment, ils ne cessaient de chercher à voir. Les nuages, comme des taches d’encre de Chine rouge sombre, flottaient dans le ciel crépusculaire et faisaient ressortir la ligne supérieure de la forêt. Un vol de corbeaux s’y déplaçait avec lenteur. Très haut, le ciel était déjà d’un bleu profond, saturé du pressentiment que la nuit allait bientôt tomber.
« J’ai complètement oublié la bagarre. Ce n’était qu’un spectacle, une distraction », pensa Natsuo. En réalité, le spectacle avait été dangereux ; mais, au fond, ce n’était qu’un spectacle. L’incident concernait davantage la voiture que lui-même. Pour Natsuo, c’était quelque chose d’extérieur. Rien ne lui arrivait jamais à lui-même ; c’était le trait constant de sa vie. Un mois plus tôt, tout le monde parlait encore des retombées radioactives de l’atoll de Bikini. Des pêcheurs japonais, travaillant près de l’atoll, avaient été frappés par une pluie radioactive lors d’un essai de bombe H. Toute la population de Tokyo redoutait désormais de manger du poisson, par crainte de contamination ; les prix s’étaient effondrés sur les marchés. Cela devint un phénomène social d’ampleur. Mais cela n’affectait pas Natsuo. L’incident ne lui était pas arrivé à lui. Compatissant, bien sûr, il plaignait les victimes ; mais l’événement n’avait pas creusé en lui la moindre faille, ni infléchi le cours de sa vie.
Il vivait avec une sorte de fatalisme enfantin, qui cohabitait, sans qu’il en ait conscience, avec une foi tout aussi naïve : la confiance naïve de quelqu’un qui se sent protégé, d’une manière ou d’une autre, par une divinité ou un ange gardien. De là découlait chez lui une absence d’esprit de combat et une indifférence générale à toute forme d’action entreprise pour réaliser un rêve.
Il regardait simplement les choses avec des yeux de peintre. Il était spectateur : il n’habitait pas les événements, il les contemplait. Il cherchait sans cesse un prétexte visuel qui pourrait servir de matériau à son regard d’artiste. Il attendait l’instant où une image attirante se présenterait pour se laisser traverser par elle. Ce qu’il contemplait ainsi était, sans conteste, beau. Pourtant, il arrivait qu’un voile d’inquiétude remonte du fond de lui. Alors, pour son « autre lui », il se posait une question : « Quand mes yeux voient quelque chose comme un objet digne d’amour ou de désir, est-il vraiment permis que je me laisse entièrement happer par cet objet ? »
À ce moment, quelqu’un le tira par le pantalon. Masako éclata de rire. Parmi tous les visiteurs de la maison, Natsuo était son favori. La fillette venait d’avoir huit ans. Elle était vraiment jolie et, fait étrange pour une enfant de cet âge, adorait s’habiller « comme une petite fille » : elle ne cherchait pas à singer les adultes. Elle rêvait plutôt de ressembler à une poupée « tellement adorable qu’on en croquerait un morceau ». Toutefois, on pouvait dire qu’elle avait, pour son âge, un sens critique étonnant.
Tant que Natsuo se trouvait dans la maison, Masako restait collée à lui. Elle s’accrochait à sa manche, à son pantalon, à sa cravate. Kyōko la réprimandait parfois ; la fillette s’éloignait alors un moment, pour revenir bientôt à la charge, et Kyōko, de son côté, oubliait vite lui avoir fait la leçon. Natsuo songeait : « Si j’avais fait hier soir quelque chose de déplacé, je n’aurais pas le courage de regarder le visage de Masako. » Il se rassurait ainsi : « Non, hier soir, j’ai bien agi. » Ce jeune homme candide se répétait cela en caressant les cheveux de l’enfant.
À l’hôtel de Hakone, alors que Shunkichi et Osamu avaient partagé chacun une chambre avec leur compagne d’un soir, Kyōko et Natsuo avaient dormi dans des chambres séparées. C’était une décision de Kyōko, qui tenait à afficher, dès le départ, sa correction. Pourtant, à minuit, c’est elle qui était venue frapper à la porte de Natsuo.
— Tu n’as pas quelque chose à lire ? Je n’arrive pas à dormir, dit-elle en entrant.
Natsuo, encore éveillé, un livre à la main, se contenta de lui tendre un magazine avec un léger sourire. Il ne l’invita pas à rester, mais elle s’assit à côté de lui. Natsuo aurait dû se sentir gêné par ce prétexte à conversation, mais il n’avait aucune raison de l’être. Kyōko, qui d’ordinaire méprisait la coquetterie, parlait toute seule comme si elle était possédée.
Jusqu’ici, Natsuo n’avait éprouvé pour Kyōko qu’une gratitude tranquille : celle d’une amitié sûre. Et, durant ce voyage, rien ne lui donnait de raison d’en douter. Mais cette nuit-là, il tenta pour la première fois de la regarder autrement. L’effort même de cet essai le mettait dans une position inconfortable.
Ses seins apparaissaient vaguement à travers l’encolure lâche de sa chemise de nuit ; sous la lumière crue de la lampe de chevet, ils étaient éblouissants de blancheur. Une ligne douce descendait du cou de Kyōko vers sa poitrine avec une majesté silencieuse. Elle parlait sans cesse avec ses lèvres fines, mais ses yeux restaient fixés, alourdis d’une douceur languissante. Par moments, d’un geste nerveux, elle effleurait le lobe de son oreille avec ses ongles rouges, comme si cela la démangeait.
— Quand je ne porte pas de boucles d’oreilles, j’ai parfois l’impression d’être nue, dit-elle, avec un soupçon de gêne.
Dans ce décor, ces mots semblaient réclamer, comme naturellement, une réponse audacieuse, un peu effrontée. Mais rien ne vint. Natsuo connaissait trop bien Kyōko. Il lui paraissait gênant de se lancer dans une désinvolture jouée, étrangère à son caractère.
Ce bonheur tiède et tenace valait infiniment mieux. D’ailleurs, il voyait en Kyōko une femme d’une solidité à toute épreuve ; pour feindre de la méprendre, il aurait fallu jouer sa propre fierté, oser un courage effrayant. Or Natsuo était absolument étranger à cette vanité juvénile que recouvre le gros mot de « courage ».
Un sentiment, lorsqu’on le laisse vivre, ne tolère pas longtemps l’ambiguïté : il se définit, tranche, puis se dissout. Ce n’est pas que Natsuo l’ait appris par expérience, ni reçu de quelqu’un comme une leçon ; il avait simplement pris l’habitude de laisser les choses se régler d’elles-mêmes. Peut-être n’avait-il pas assez vécu pour en juger, mais il avait ce talent singulier consistant à s’en remettre en toute situation aux mains de la nature.
Kyōko finit par comprendre que les hésitations de Natsuo venaient du respect qu’il lui portait. Du moins, elle le crut. Alors, soudain, son visage s’éclaira, et, d’une voix claire et lumineuse, presque déplacée à cette heure de la nuit, elle dit « Bonne nuit », puis elle sortit de la chambre.
— Pourquoi la vitre de la voiture s’est cassée ? C’était un coup ? demanda Masako.
— Oui, un coup.
Masako esquissa un léger sourire.
— Comment ?
— Avec une pierre.
— D’accord.
Contrairement aux autres fillettes de son âge, Masako n’épuisait pas la patience des adultes par une suite interminable de « pourquoi ? ». Elle s’arrêta là. Cela ne signifiait pas qu’elle avait tout compris. Il restait des choses obscures. Mais déjà, à huit ans, elle avait pris l’habitude d’interrompre ses questions au bout d’un moment.
Rassemblés autour de Kyōko, les jeunes gens buvaient une bouteille de Fino que quelqu’un avait apporté. Shunkichi, lui, s’obstinait à boire du jus d’orange. Tous étaient accoutumés à ses manies ascétiques et n’y voyaient plus rien d’étrange.
Kyōko demanda à Shunkichi et à Osamu de lui raconter en détail la nuit précédente. Tous deux avouèrent, très simplement, avoir laissé leurs compagnes payer l’hôtel. Osamu aurait pu se montrer plus galant, mais Shunkichi n’avait presque pas d’argent ; en un sens, c’était logique. Lorsqu’il s’agissait de se rappeler précisément comment elles s’étaient débrouillées au lit, Shunkichi ne se souvenait de presque rien. Osamu, lui, se rappela tout, et, malgré une certaine gêne, se mit à parler. Kyōko voulait tout entendre, jusqu’au moindre détail. Pendant qu’ils s’enfonçaient dans ce récit, Masako tournait autour du groupe, les écoutant d’un air innocent. Natsuo, comme toujours, la surveillait avec inquiétude.
— Mon Dieu… C’est incroyable que Mitsuko ait fait ça, dit Kyōko.
— Je te jure que c’est vrai, répondit Osamu.
Mais à peine avait-il parlé qu’il eut l’impression que ses paroles sonnaient faux, que rien, en réalité, n’avait vraiment existé.
Natsuo s’adressa alors à Shunkichi, resté silencieux jusque-là :
— Je dois te remercier. Sans toi, je ne sais pas ce qui serait arrivé à la voiture.
Shunkichi, vautré dans un fauteuil avec l’air d’un poivrot malgré son verre de jus d’orange, écoutait tout ça d’un œil insolent. À ces mots, il eut un sourire un peu gêné et, sans rien dire, fit un petit geste de la main devant son visage, comme pour chasser une mouche.
On pouvait se demander pourquoi les incidents semblaient toujours se produire autour de Shunkichi, alors qu’on pouvait parier qu’il ne se passerait rien de tel si Natsuo se trouvait seul dans les mêmes circonstances. Shunkichi ne gardait en mémoire que les anecdotes qui pouvaient nourrir une conversation : boxe, bagarres imprévues… Quant aux femmes, il oubliait presque tout aussitôt.
Natsuo, en tant qu’artiste, s’intéressait depuis longtemps au visage de Shunkichi. Un visage simple, viril. On voyait qu’il avait été modelé par les coups, mais certains de ces coups l’avaient étrangement embelli. Il est des visages auxquels les coups confèrent une terrible beauté, et d’autres une terrible laideur. Sa peau battue avait acquis un éclat particulier. Chez Shunkichi, la simplicité de ses traits accentuaient encore l’impression de force ; la peau abîmée la soulignait, creusait les lignes. Ses grands yeux anguleux, sous des sourcils droits, indemnes de cicatrices, paraissaient plus nets encore. Ils mettaient en valeur la profondeur et la fraîcheur de son regard. À la différence des autres hommes, son visage, lisse comme le cuir d’un ballon de football, n’exprimait presque rien par lui-même ; l’expression entière tenait dans l’éclat de ces yeux.
— Et après, qu’est-ce qui s’est passé ? demanda Kyōko en baissant la voix, non par crainte que Shunkichi ou Natsuo entendent, mais pour donner à Osamu envie de continuer.
— Après…
Osamu se remit à détailler ce qu’il avait vécu dans la chambre d’hôtel. À mesure qu’il parlait, le sentiment d’irréalité grandissait : cette nuit lui semblait de moins en moins lui appartenir. La rugosité des draps amidonnés, la légère moiteur de la peau, l’impression d’un bateau flottant sur un lit de piliers trop souples… Tout cela, certes, avait existé. Persistait aussi cette sensation de soulagement, continue, à sentir le plaisir s’éloigner de lui. Une seule chose demeurait incertaine ; est-ce que tout cela lui était arrivé à lui ?
Le jour touchait à sa fin. Masako, assise sur les genoux de Natsuo, feuilletait tranquillement un manga.
Un instant, l’idée de « bonheur » traversa l’esprit de Natsuo, et il en fut effrayé. « Si cet endroit où je suis maintenant était ma maison, si c’était ma famille, pensa-t-il, ce serait terrible. »
La fenêtre de la terrasse était ouverte : on entendait nettement le souffle des trains qui s’élançaient. Une rangée de lumières s’alluma, là-bas, à la gare de Shinanomachi.
Il était dix heures lorsque la sonnette de l’entrée retentit. C’était Yanagimoto Seiichirō. Kyōko, qui, après la fatigue du voyage, allait justement se coucher, se rafraîchit devant le miroir ; en un instant, sa somnolence s’évanouit. Masako dormait déjà. Chez Kyōko, on accueillait bien les visiteurs, quelle que soit l’heure.
Seiichirō attendait dans le salon. En la voyant, il lança d’un ton mécontent :
— Comment, tout le monde est déjà parti ?
— Mitsuko et Tamiko sont rentrées seules dès Ginza. Ensuite, je suis venue ici avec les trois, et Shunkichi et Natsuo sont repartis presque aussitôt. Le dernier, c’était Osamu, mais il est parti il y a une demi-heure. J’étais sur le point d’aller dormir, répondit Kyōko.
L’idée de lui dire : « Tu aurais pu appeler avant » ne lui vint même pas. Elle savait bien que Seiichirō avait l’habitude d’arriver sans prévenir. Elle n’osa pas davantage lui faire remarquer son état d’ivresse par un « Tu as bu, n’est-ce pas ? ». Quand Seiichirō venait tard, c’était presque toujours après avoir bu quelque part. Parmi les hommes qui fréquentaient sa maison, c’était avec lui qu’elle entretenait le lien le plus ancien : depuis ses dix ans. Il était comme un petit frère.
— Et le voyage ? demanda Seiichirō.
La façon dont il posa la question trahissait son manque d’intérêt. Kyōko écourta :
— Bien. Rien de spécial, répondit-elle.
Seiichirō, lorsqu’il était dans cette maison, avait un visage où se mêlaient à la fois un mécontentement extrême et un calme non moins intense, curieuse combinaison de humeurs opposées. On aurait dit l’expression d’un de ces salarié japonais qui va boire un verre après le travail, mais ce masque était contredit par ses traits : une mâchoire forte, des yeux au regard perçant, d’où émanait une volonté dure. Avec ce visage, ou plutôt derrière ce visage, il croyait fermement à la fin du monde.
Après lui avoir servi une coupe de saké, Kyōko aborda, comme on parlerait de golf avec un passionné, le sujet favori de Seiichirō : l’effondrement du monde.
— Aujourd’hui, personne ne nous prend au sérieux si l’on parle de fin du monde. En temps de guerre, Seiichirō, pendant les bombardements, on t’aurait cru sans hésiter. Juste après la guerre, quand les communistes répétaient qu’une révolution pouvait éclater d’un moment à l’autre, tu aurais fait ton effet. Il y a trois ou quatre ans, quand la guerre de Corée a commencé, on t’aurait écouté peut-être. Mais maintenant ? Maintenant que nous vivons dans le confort… Qui va nous croire si l’on parle de fin du monde ? Ce n’est pas comme si nous étions à bord du Daigo Fukuryūmaru, le bateau de pêche dont l’équipage a été irradié.
— Quel rapport entre ce que je dis et la bombe atomique ? demanda Seiichirō.
Puis, d’une voix enflée d’une poésie un peu ivre, il exposa son point de vue à Kyōko.
Selon lui, le fait que rien, en apparence, ne laisse présager la décadence constituait justement le signe le plus clair de la destruction certaine du monde. Quand il se produit des troubles sociaux, on en vient toujours à bout par un compromis raisonnable ; tout le monde croit à la victoire de la paix et de la raison, l’autorité se rétablit, on ne se bat plus, on ne se dispute plus, et une mentalité de pardon généralisé envers l’adversaire finit par dominer… Aujourd’hui, la plupart des foyers se permettent le luxe d’élever un chien ; au lieu de risquer ses économies dans la spéculation, le sujet de conversation des jeunes est de savoir à combien montera leur retraite patiemment économisée… Et pendant ce temps, les cerisiers fleurissent, tranquilles, au printemps radieux… Tout cela, pour Seiichirō, était le signe manifeste d’une destruction à venir.
Il n’aimait pas discuter ses idées avec les autres, et parlait rarement de tout cela avec des femmes. En réalité, les hommes eux-mêmes évitaient ce terrain. Mais avec Kyōko, il sentait un lien. Elle rejetait les obligations, les normes morales ; elle se laissait aller à l’indolence, et si elle ne vendrait jamais son corps, elle avait tout de même la délicatesse de se maquiller pour une visite nocturne.
— Ce collier ne va pas avec ta robe, dit-il sans façon en sirotant sa liqueur.
— Ah oui ? répondit Kyōko.
Elle alla immédiatement en changer. Elle avait confiance en ses avis, à cause de leur longue amitié depuis l’enfance.
« Ces derniers temps, quand elle est fatiguée, de légères rides apparaissent près de ses yeux, pensa Seiichirō. Elle a trois ans de plus que moi, elle a déjà trente ans. C’est injuste que nous devions vieillir, nous aussi, comme les autres, alors que nous ne nous sommes jamais vraiment intéressés à cette époque dans laquelle nous vivons. »
Kyōko revint avec un autre collier. Il allait effectivement mieux avec la robe. Ce simple changement, dans ce petit espace de peau blanche entre le cou et la poitrine, semblait adoucir la rugosité de ses rapports avec le monde extérieur, en ajoutant un peu plus d’harmonie. Peut-être l’alcool amplifiait-il la sensation chez Seiichirō. En tout cas, il lui dit que cela lui allait bien. Elle se réjouit du compliment, et ils échangèrent un sourire. Ils se comprenaient à demi-mot et une joie partiellement feinte, mais irrésistible, se communiquait de l’un à l’autre jusqu’au plus profond d’eux-mêmes.
Peu après la mort de son père, Kyōko avait mis son mari à la porte ; depuis, Seiichirō se sentait plus libre. Son propre père, du vivant du père de Kyōko, avait été son fidèle collaborateur. Les dimanches et jours de fête, il venait avec sa femme et son fils. Comme le père de Kyōko était ce qu’on appelait un « véritable démocrate », Seiichirō, enfant, avait pu jouer avec elle, plaisanter librement, et, en repartant, recevait toujours quelques sucreries. Mais lorsqu’ils atteignirent l’âge du mariage, Kyōko et lui cessèrent de se voir ; son père ne l’emmenait plus lors de ses visites. Plus tard, une fois Kyōko mariée, alors qu’il était déjà étudiant, Seiichirō avait repris l’habitude de venir quelques fois par an faire une visite de courtoisie, et le père de Kyōko comme le jeune couple l’accueillaient chaleureusement… Aujourd’hui, lorsqu’il venait dans cette maison, on aurait dit qu’il se comportait en maître des lieux.
À y bien regarder, cette attitude avait quelque chose de sarcastique. Mais Seiichirō connaissait Kyōko et partageait son effort pour en finir avec les barrières de classe ; il la tenait même pour un exemple à suivre. Ses visites à l’improviste, son arrogance sans retenue, sa manière de présenter Kyōko à tous ses amis sans distinction, d’ajouter des noms à la liste de ses admirateurs… Tout cela allait parfaitement dans le sens du souhait de Kyōko. Dire qu’elle aimait Seiichirō serait sans doute exagéré ; mais, au moment précis où elle se retrouvait seule, elle savait qu’elle n’avait pas de meilleur ami que lui. Elle détestait par-dessus tout la servilité. À l’inverse, une certaine arrogance hautaine lui paraissait belle. Sans doute étaient-ils plus proches l’un de l’autre, depuis l’enfance, qu’ils ne se l’étaient jamais avoué.
Kyōko acceptait d’un cœur léger le comportement capricieux de Seiichirō dans cette maison. Il lui arrivait d’ailleurs de faire preuve d’une délicate retenue. En tant que gestionnaire de ses biens, il la conseillait avec soin. D’un côté, il s’y connaissait en finances et en administration de patrimoine ; de l’autre, son nihilisme constant traînait derrière lui une ombre. Parmi tous les visiteurs, c’était celui que Masako détestait le plus.
Comme Seiichirō revenait sans cesse à la destruction du monde, Kyōko lui dit :
— J’ai du mal à supporter l’idée que tout s’écroule après tant d’efforts de reconstruction depuis la guerre. La semaine dernière, je suis montée sur le toit de l’immeuble M. Cela faisait longtemps que je n’avais pas observé le centre de Tokyo d’en haut. En voyant de mes propres yeux à quel point les travaux avaient avancé, je n’en revenais pas. Il ne reste plus aucune trace des ruines. Toutes les aspérités du terrain ont été lissées, comme si on avait aplati des clichés de journaux. Il ne restait presque plus de verdure : juste la foule, au loin, comme des tiges d’herbe couchées par le vent.
Seiichirō lui demanda si ce panorama la rendait heureuse. Elle répondit que non.
— Au fond, Kyōko, tu penses comme moi, dit-il. La fin du monde est une idée qui t’attire. Tu n’as pas oublié la clarté des terrains calcinés. Aujourd’hui, tu regardes cette ville à la lumière d’un temps disparu, j’en suis sûr. Quand tu marcheras sur ces trottoirs bien lisses en béton neuf, tu regretteras le sol brûlé sous tes pieds, la sensation de marcher sur des braises. Depuis les immeubles vitrés, tu seras triste de ne plus voir, dans le paysage, ces pissenlits qui poussaient au milieu des décombres après les incendies.
La destruction que tu aimais appartient désormais au passé. C’est dans cette destruction que tu as poli ta fierté, jusqu’à la rendre sublime ; tu te glorifies d’avoir vécu en l’idéaliserant. Et s’il y a une chose que tu abhorres, ce sont bien ces mots de « renaissance », de « phénix », de « reconstruction », cette obsession d’exalter le bâti, de toujours vouloir améliorer, d’aspirer sans cesse à « mieux », faire « un pas de plus » comme être humain… Oui, je suis persuadé que tu détestes tout cela. Il doit être difficile pour toi de vivre à cette époque… tu ne peux pas le nier.
— Et toi, alors ? répliqua Kyōko en lui donnant une tape. On ne peut même pas dire que tu vis vraiment à cette époque. Tu passes ton temps à prêcher la destruction imminente.
— C’est vrai, admit Seiichirō.
Peu à peu, il parlait avec la spontanéité lyrique d’un jeune exalté. Cependant, il ne s’autorisait ce ton que chez lui ; à l’extérieur, il maintenait les apparences, évitait de dire ce que l’on jugeait déplacé.
— Comment voudrais-tu que je vive sans la certitude que la fin du monde approche ? Si je croyais que la boîte rouge posée sur le chemin de mon bureau à cause des travaux de reconstruction resterait là pour toujours, comment pourrais-je emprunter ce chemin sans ressentir dégoût et horreur ? Si je devais accepter que cette fichue boîte rouge, avec ses ouvertures grotesques, demeure là à jamais, pourrais-je lui permettre de rester ne serait-ce qu’une seconde de plus, gueule ouverte ? Tu ne crois pas que je la frapperais de toutes mes forces ? Que je me battrais contre cette boîte rouge jusqu’à la renverser, la réduire en morceaux ?
Si je peux supporter la vue d’une pareille boîte, accepter et consentir à son existence ; si, chaque matin à la gare, je me contente de boire en regardant le chef de gare au visage de phoque, si je tolère les murs couleur œuf de l’ascenseur du bureau, si, pendant la pause de midi, je monte sur le toit en supportant le ballon gonflable de publicité, eh bien, tout cela n’est possible que parce que j’ai la certitude absolue que le monde va à sa fin.
— En somme, tu avales tout. Tu tolères tout ; tout t’est égal…
— Comme le chat d’un vieux conte, dit Seiichirō, la seule manière qu’il avait de lutter était d’engloutir. C’était sa seule façon de vivre. Il avalait tout ce qu’il croisait : des carrioles, des chiens, un bâtiment scolaire. S’il avait soif, il avalait un château d’eau, même des cortèges royaux, jusqu’à une vieille dame, ou une charrette de lait… Oui, j’aimerais savoir comment ce chat a vécu.
Toi, tu rêves de la destruction passée. Moi, je prévois celle du futur. Et pendant ce temps, entre ces deux mondes en ruine, nous survivons en buvant chaque jour à petites gorgées. Cette façon de tenir est d’une insensibilité terrifiante : nous vivons en serrant contre nous un fantôme qui ne cherche qu’à prolonger sa vie indéfiniment. Ce spectre gagne du terrain, plonge des milliers de gens dans la paralysie ; désormais, la frontière entre rêve et réalité s’est effacée, ou bien tout le monde a fini par croire que cette illusion est le réel.
— Alors tu dois être le seul à savoir que c’est une illusion. C’est pour cela que tu peux tout avaler comme si de rien n’était, dit Kyōko.
— Oui. Parce que je sais que la véritable réalité, c’est « la réalité d’un monde sur le point d’être détruit ».
— Et comment peux-tu le savoir ?
— Je le vois, simplement. Tout le monde pourrait saisir le fond même de ses propres actes, s’il regardait bien. Mais personne ne veut regarder. Moi, j’ai le courage de fixer cette réalité. Je ne peux pas m’empêcher de voir clairement ce qui va se passer. Je vois distinctement la marche rapide des aiguilles sur le cadran.
Seiichirō s’enfonçait dans l’ivresse. Son visage écarlate, la lourdeur soudaine de ses gestes révélaient qu’il ne tenait plus ses pensées qu’à un fil. Avec son costume bleu, sa cravate et ses chaussettes sombres, ce jeune homme prêt à se fondre à tout instant dans la foule anonyme exhalait un parfum de vie collective jusque dans la petite tache négligée sur sa chemise. Ce n’était pas une saleté naturelle : on aurait dit une tache laborieusement travaillée afin de singer la négligence. Chez Kyōko, il devenait la contradiction faite chair : méduse arrachée à l’eau, lacérée sur le sable, ses idées, ses élans, tout n’était plus qu’un magma informe qu’il ne gouvernait plus.
Soudain, Seiichirō changea de sujet.
— Comment était Shun, avant l’entraînement ?
— Il avait l’air très bien. Il est revenu avec une grande confiance en lui.
Kyōko lui raconta une partie de la bagarre de l’après-midi.
Seiichirō éclata de rire. Il avait très peu de chances de se retrouver un jour impliqué dans ce genre d’histoire, mais il adorait entendre parler des combats des autres. Il félicita chaleureusement Kyōko pour son sang-froid pendant la scène.
Il inspira profondément l’air de la nuit avancée et, toujours assis, s’étira avec délice. Sa pomme d’Adam, très saillante, luisait vivement à la lumière de la lampe au rythme de son mouvement. Puis, comme jaillissant de cette posture, il se leva brusquement, s’approcha de Kyōko et lui serra la main.
— Bonne nuit. Je m’en vais. Tu dois être fatiguée par le voyage.
— Pourquoi es-tu venu, exactement ?
Kyōko posa la question sans se lever de sa chaise. Ses yeux ne rencontrèrent pas ceux de Seiichirō ; elle fixait les angles aigus de ses orteils vernis de rouge, qui semblaient avoir gagné en tranchant à cette heure tardive.
— Qu’est-ce que tu es venu chercher ?
Il fit quelques pas en aller et retour devant l’entrée, balançant sa serviette, comme s’il prenait plaisir à regarder son ombre se déplacer sur la vieille porte en chêne. Puis il dit :
— J’ai un peu mal à la tête. C’est tout. …Je suppose que je suis venu pour te consulter, pour entendre ton avis.
— De quoi parles-tu ?
— Je me dis que je devrais peut-être songer à me marier, avant trop longtemps.
Kyōko, qui était sortie jusqu’au vestibule pour raccompagner Seiichirō, ne répondit rien à cela. En pleine nuit, une bourrasque soudaine s’était levée : elle frappait les trois murs et la barrière de pierre entourant le jardin d’entrée, tourbillonnait, et revenait en rafales. Dans le cercle de lumière de la lanterne, les baies rouges et luisantes, ainsi que les jeunes feuilles d’un vert pâle et vigoureux du cognassier du Japon se balançaient dans le vent. Les nombreuses baies rouges oscillaient, raides, suspendues.
— Quel vent affreux, dit Kyōko au moment de se séparer.
Les yeux perplexes de Seiichirō se retournèrent aussitôt avec sensibilité. Il savait bien que Kyōko n’était pas du genre à dire : « Quel vent affreux », même par une tempête pareille. Kyōko, de son côté, trouva que ce regard soudain et soupçonneux, dans un moment pareil, relevait du comble de l’impertinence. Pourtant, Kyōko n’avait pas la moindre raison de haïr Seiichirō.
…Masako, restée seule dans la pièce de style occidental, s’éveilla au bruit du départ des invités. Ce soir, pensa-t-elle en jetant un œil à la pendulette près de son oreiller, le dernier invité était rentré anormalement tôt. Elle se redressa, avança à pas de loup et ouvrit le tiroir du coffre à jouets. Elle avait l’habitude de l’ouvrir sans faire le moindre bruit. Il était rempli de robes pour ses poupées d’habillage, et une odeur de camphre s’en dégagea. Masako adorait les petites boules de camphre enveloppées de cellophane colorée, et elle en avait rempli le tiroir. Elle aimait même plus que tout cette senteur forte et austère ; lorsqu’elle était seule, elle plongeait le nez dans le tiroir et respirait profondément.
Dans la faible lueur du lampadaire filtrant par la fenêtre, les costumes des poupées prenaient une teinte bleu pâle ou rose pâle, difficile à discerner. La jupe de dentelle rigide et bon marché avait un bord ondulé. Il arrivait à Masako de trouver ces costumes, qui ne la faisaient jamais transpirer, plutôt ennuyeux.
Jetant des regards autour d’elle, elle sortit brusquement la langue, la coinçant fermement entre ses dents du haut et du bas. Masako tira alors une photographie de sous les vêtements de poupée. Puis elle se précipita vers la fenêtre, la leva vers la lumière du lampadaire et contempla intensément la photographie de son père exilé.
C’était un jeune homme très apathique, mince, mais beau, portant des lunettes sans monture, les cheveux séparés par une raie au milieu, et un minuscule nœud de cravate serré nerveusement autour du col.
Masako fixa la photographie de son père d’un regard qui n’avait rien de sentimental ; elle regardait plutôt comme si elle cherchait quelque chose. Puis, comme accomplissant le rituel habituel de son éveil au cœur de la nuit, elle murmura tout bas, à l’intérieur de sa bouche :
— Attends-moi. Un jour, Masako te fera sûrement revenir.
La photographie exhalait l’odeur du camphre. Pour Masako, cette odeur était celle de la nuit profonde, celle des secrets, et celle de son père. À son parfum, Masako retrouvait le sommeil. L’odeur de chien, qui dégoûtait tant Kyōko, avait disparu.