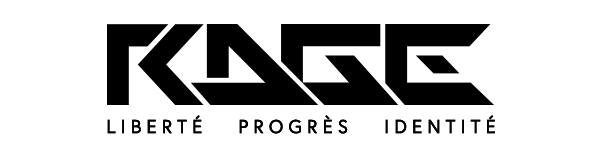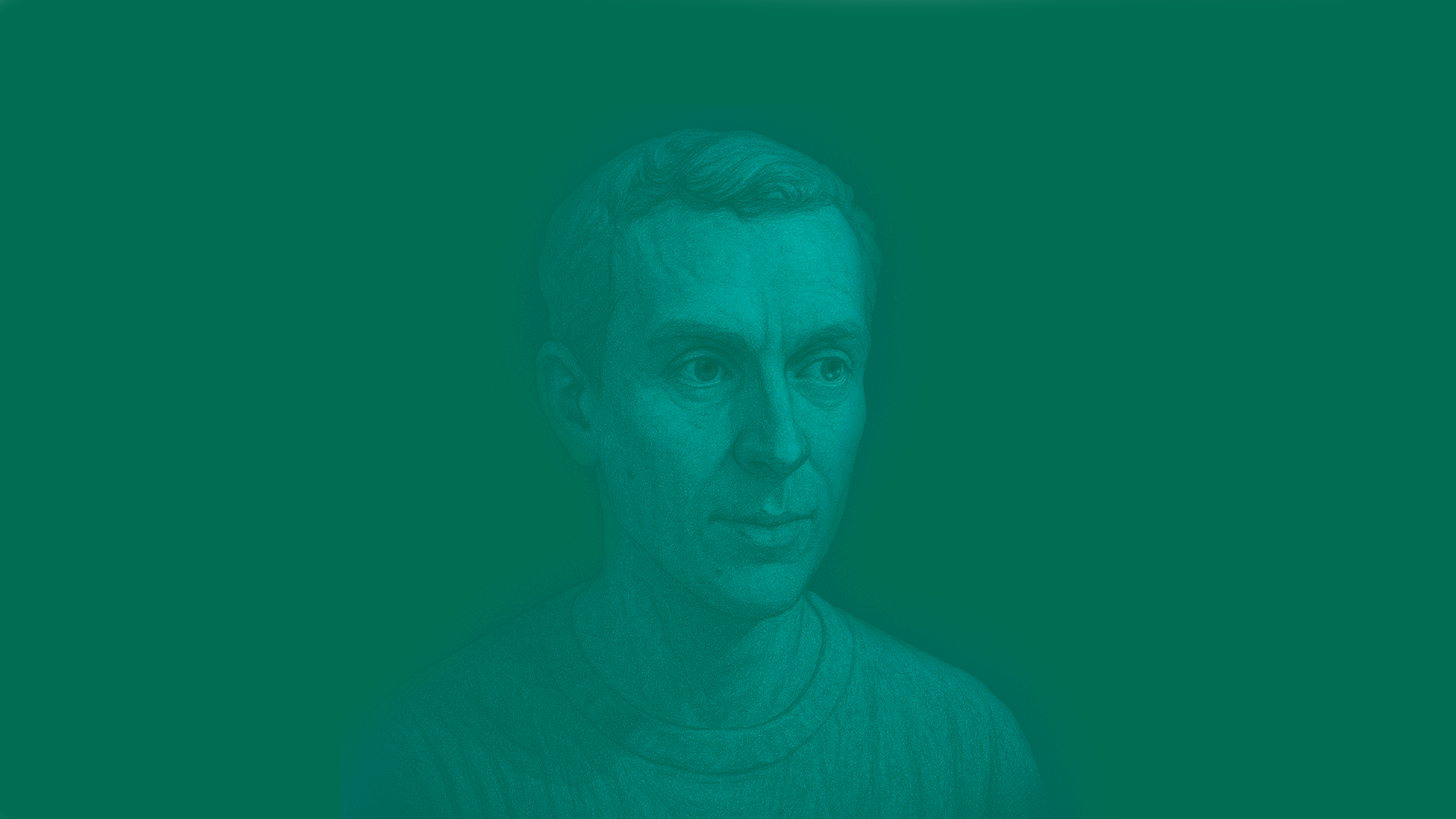Cette série d’articles constitue l’introduction de l’ebook sur la technique regroupant une vingtaine de textes. Elle permet de pouvoir naviguer dans les textes du corpus en comprenant ce qu’ils ont à apporter au sujet traité. Vous pouvez vous procurer l’ouvrage par un tip de la valeur de votre choix.
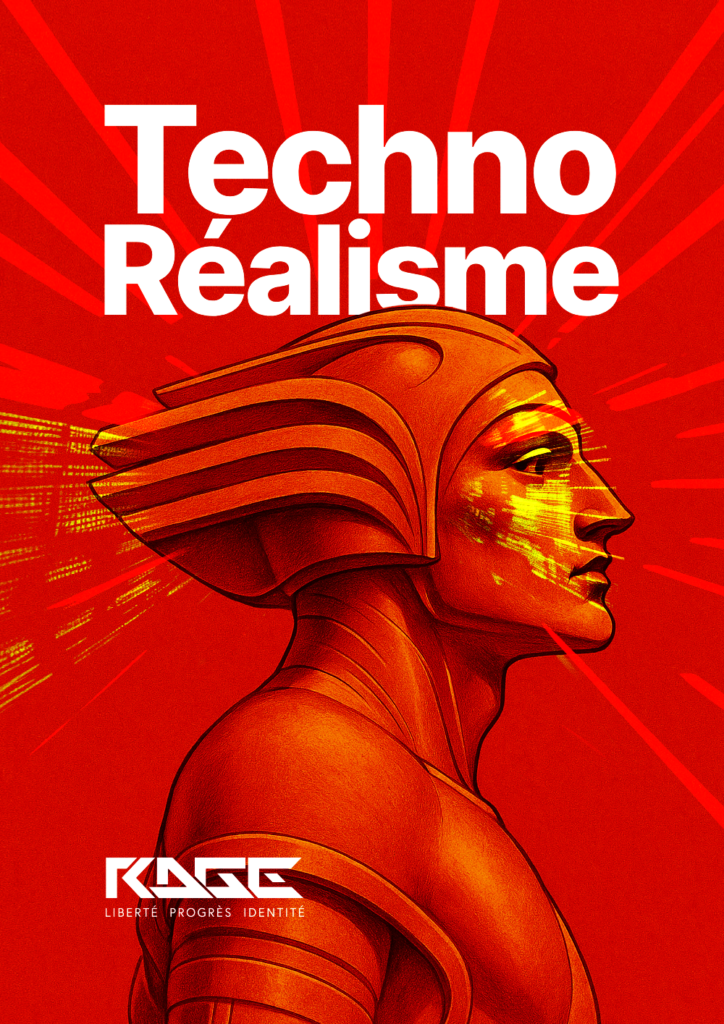
La technologie n’est pas neutre. C’est exactement l’avis de Heidegger, mais ce dernier semble l’affirmer pour des raisons a priori différentes de Nietzsche. Ce qui préoccupe Heidegger n’est pas la puissance, mais le manque d’authenticité de la technologie moderne. Il rejoint cependant Nietzsche sur la conclusion voulant que cette technologie moderne conduit à l’aboutissement du nihilisme et favorise le type de vie du dernier homme. On ne peut pleinement comprendre Heidegger sans revenir aux Anciens. Pour des raisons de droits d’auteur, il est le grand absent de cette sélection de textes, mais son ouvrage sur la question de la technique aurait évidemment mérité sa place ici et je peux tout de même lui rendre hommage à travers quelques citations.
De même l’essence de la technique n’est absolument rien de technique. Aussi ne percevrons-nous jamais notre rapport à l’essence de la technique, aussi longtemps que nous nous bornerons à nous représenter la technique et à la pratiquer, à nous en accommoder ou à la fuir. Nous demeurons partout enchaînés à la technique et privés de liberté, que nous l’affirmions avec passion ou que nous la niions pareillement. Quand cependant nous considérons la technique comme quelque chose de neutre, c’est alors que nous lui sommes livrés de la pire façon : car cette conception, qui jouit aujourd’hui d’une faveur toute particulière, nous rend complètement aveugles en face de l’essence de la technique
— Martin Heidegger, Sur la Question de la technique
L’essence de la technique n’est en rien technique et la technique n’est pas neutre. Quelle est alors l’essence de la technique ? Pour comprendre Heidegger, il faut comprendre Husserl et Aristote. Heidegger donnait la lecture de Husserl comme seul prérequis pour comprendre ses cours. Husserl, père de la phénoménologie, cherche à sortir la modernité de l’impasse ouverte par Descartes : celle d’un sujet qui, partant du doute radical, ne tient pour certain que son propre penser, au risque du solipsisme. Ce point de départ coupe l’esprit du monde et prolonge l’idée galiléenne d’une nature réduite à des modèles mathématiques accessibles par la seule raison. Contre cela, Husserl affirme que la conscience est toujours conscience de quelque chose : le sens naît dans la relation sujet/monde. Cette approche, bien que transcendantale, se rapproche d’Aristote, pour qui le monde se donne d’abord à nous, et la connaissance procède du particulier vers l’universel. Descartes reste, lui, plus proche de Platon : il part de l’idée pour atteindre le réel. Chez Husserl, la perception dépend du point de vue qu’offre notre corps : changer de position, c’est changer de monde. Le corps et l’esprit sont indissociables. Cela peut sembler trivial, mais la modernité avait fini par accorder plus de réalité à ses abstractions qu’au monde vécu. Nietzsche le dira avec force : « Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. »
Heidegger, bien qu’il dépassera Husserl, a conservé ces prémisses de Husserl et, comme Aristote, il part du langage du quotidien, du bavardage, pour expliquer les choses. Explorons alors un peu plus Aristote, car cela pourrait nous être utile pour comprendre Heidegger et l’histoire de la technologie. Dans le livre 2 de la physique d’Aristote intitulé De la nature, il commence par expliciter ceci :
Les êtres que nous voyons peuvent être tous partagés en deux grandes classes : ou ils sont le produit direct de la nature, ou ils viennent de causes qui ne sont plus elle. Ainsi c’est la nature qui produit les animaux et les parties diverses dont leurs corps sont composés ; c’est elle encore qui produit les plantes, et les éléments simples tels que la terre, le feu, l’air et l’eau ; car nous disons de toutes ces choses et de toutes celles qui leur ressemblent, qu’elles existent par le fait seul de la nature. Tous ces êtres que nous venons d’indiquer, présentent une grande différence par rapport à ceux qui ne sont plus comme eux des produits de la nature. Tous les êtres naturels portent en eux-mêmes le principe de leur mouvement ou de leur repos… […] Il n’en est plus de même pour les êtres qui ne sont pas naturels et qu’on peut appeler les produits de l’art : un lit par exemple, un vêtement ou tel objet analogue n’ont en eux-mêmes, en tant qu’on les rapporte à chacune des classes du mouvement et en tant que l’art les produit, aucune tendance spéciale à changer d’état… […] J’ai déjà expliqué ce que j’entends quand je dis qu’une chose est telle chose par accident ; mais je reviens à cette explication, et je cite un exemple. Si quelqu’un qui est médecin se soigne lui-même et se rend la santé, je dis que c’est indirectement et par accident que le médecin est guéri ; car ce n’est pas en tant que médecin a proprement parler, c’est en tant que malade ; et c’est par accident que le médecin est guéri, et seulement parce qu’il s’est trouvé à la fois que la même personne fût malade et médecin ; mais ces deux qualités auraient pu fort bien être séparées l’une de l’autre au lieu d’être réunies. On peut en dire autant pour tous les êtres qui sont le produit de l’art.
— Aristote, La Physique
Il sépare les choses entre celles qui sont par nature, c’est-à-dire celles qui ont le principe de leur mouvement en elle, et celles qui sont le produit de l’art, c’est-à-dire la technè. Puis il donne l’exemple du médecin qui se soigne lui-même et il explicite que ce n’est pas parce qu’il se soigne lui-même qu’il a ce principe en lui par nature. Il occupe en fait deux positions, celle du malade et celle du docteur et c’est le malade qui est guéri par le docteur. Le docteur est guéri par accident. Il veut mettre en avant que cette faculté du médecin n’existe pas par essence, par nature, mais qu’il en fait l’acquisition et que c’est donc une technique. Cet exemple est important, car Aristote met ici en avant une chose capitale qui est l’esprit de l’homme et son rapport à la technique. La technique est l’art de l’esprit de l’homme, de sa raison. La technè est donc le produit du logos et le logos est ce qui fait la distinction de l’homme comme animal rationnel d’Aristote. Pour lui, la technique est humaine. L’exemple du médecin se soignant lui-même n’est pas anodin, car il met en avant que l’homme peut appliquer sa technique à lui-même et donc devenir le créateur de sa propre créature en lui-même, comme le dira Nietzsche plus tard.
En l’homme sont réunis créature et créateur : en l’homme, il y a la matière, le fragment, l’exubérance, le limon, la boue, la folie, le chaos ; mais en l’homme il y a aussi le créateur, le sculpteur, la dureté du marteau, la contemplation divine du septième jour. Comprenez-vous cette antithèse ?
— Nietzsche, Par-dela bien et mal
Toutefois, l’esprit de l’homme ne peut pas être lui-même le produit de la technique, donc cela pose la question de savoir d’où vient cette faculté. Dans la culture grecque, c’est un cadeau des dieux et pas n’importe lequel, c’est le cadeau du titan Prométhée qui a offert le feu aux hommes. Un feu qu’ils n’auraient pas dû avoir, car c’est réservé aux dieux. Donc la technique est divine chez eux et l’homme doit l’utiliser avec précaution. Alors, Aristote rompt avec cette idée divine. On retrouve beaucoup de similitudes avec Heidegger bien sûr, mais lui marque une rupture avec l’homme comme animal rationnel d’Aristote en introduisant le Dasein (être-là) dont la particularité est de penser son être. La raison pour laquelle il va diverger d’Aristote est qu’il voit chez lui, et dans toute la tradition philosophique occidentale qui s’appuie sur lui, que c’est une erreur d’imaginer que le monde se livre à nous comme s’il était « posé là » et attendant qu’on le catégorise. Avec une telle approche, Aristote réduit tout à des étants, y compris l’Être qui devient une substance, c’est-à-dire un objet de connaissance. C’est très clair dans la suite de l’extrait d’Aristote que je viens de partager avec vous. Il dit :
Voilà ce que j’entends par nature. On dit des êtres qu’ils sont naturels, et qu’ils sont de nature, quand ils ont en eux-mêmes le principe qu’on vient de dire. Ceux-là sont ce que je nomme des substances ; car la nature est toujours un sujet, et elle est toujours dans un sujet.
— Aristote, La Physique
C’est encore plus clair dans le Parménide de Platon, qui met dans la bouche d’un Parménide fictif un propos bien différent de celui du Parménide historique.
Parménide — Remontons donc au commencement et disons ce qui doit s’ensuivre, si l’un n’existe pas. Il faut d’abord lui reconnaître cette propriété, semble-t-il, qu’il est objet de science ; autrement, on ne sait même pas ce qu’on dit, quand on dit : si l’un n’existe pas.
Platon, Parménide
Heidegger y voit ici ce qu’il nomme l’oubli de l’Être, qui chez lui n’est pas un étant, mais ce qui se dévoile. Je pense donc je suis disait Descartes, alors que Heidegger nous dit plutôt, en tant que Dasein, je suis donc je pense. On voit le lien avec Husserl et la phénoménologie qui veut qu’on ait toujours conscience de quelque chose et Heidegger nous dit qu’on a toujours conscience de soi au sein d’un monde dans lequel on est jeté au sein duquel l’Être se dévoile. L’Être se dévoile dans le temps, à travers des époques de compréhension différentes et la technique est un des modes de dévoilement de l’Être. L’essence de la technique est donc pour lui, le dévoilement de l’Être ou, comme le nommaient les Grecs, l’alétheia. Heidegger ne croit pas que la technologie soit démoniaque en soi, mais il accuse le monde moderne d’être la source d’une technologie produisant de l’inauthenticité. Pour lui, la différence entre authenticité et inauthenticité relève du questionnement des mots que l’on emploie, et donc de la technologie qu’on produit et qu’on utilise. Nous avons tendance à nous cacher derrière le on. On sait que l’on va mourir, mais nous ne nous disons que rarement Je vais mourir et pensons rarement ce que cela implique. Le on est la manière ordinaire dont nous existons la plupart du temps. Il est une forme d’inauthenticité qui nous dépossède de nous-mêmes en étant normalisateur parce qu’il aplatit et règle d’avance ce qu’il est permis de penser, faire, espérer. Il n’est pas mauvais en soi, mais il représente un mode de vie par défaut, un choix de confort où nous vivons selon les règles établit, selon la morale de troupeau nietzschéenne. C’est une perte de soi dans la fonctionnalité d’un système de plus en plus technologique, qui met à demeure la nature et la traite comme un fond, un stock. C’est l’efficacité pour l’efficacité, comme Platon reprochait à Gorgias de ne se soucier que de l’efficacité de ses méthodes sans considérations pour leurs conséquences.
Autrefois la technique n’était pas seule à porter le nom de τεχνη. Autrefois τεχνη désignait aussi ce dévoilement qui pro-duit la vérité dans l’éclat de ce qui paraît.
Autrefois τεχνη désignait aussi la pro-duction du vrai dans le beau. La ποιησις des beaux-arts s’appelait aussi τεχνη.
Au début des destinées de l’Occident, les arts montèrent en Grèce au niveau le plus élevé du dévoilement qui leur était accordé. Ils firent resplendir la présence des dieux, le dialogue des destinées divine et humaine. Et l’art ne s’appelait pas autrement que τεχνη. Il était un dévoilement unique et multiple. Il était pieux, c’est-à-dire « en pointe », προμος : docile à la puissance et à la conservation de la vérité.
[…]
Pourquoi portait-il l’humble nom de τεχνη ? Parce qu’il était un dévoilement pro-ducteur et qu’ainsi il faisait partie de la ποιησις. Le nom de ποιησις fut finalement donné, comme son nom propre, à ce dévoilement qui pénètre et régit tout l’art du beau : la poésie, la chose poétique. Le même poète dont nous avons entendu la parole :
Mais, là où il y a danger, là aussi
Croît ce qui sauve.
nous dit :
…l’homme habite en poète sur cette terre.
— Martin Heidegger, Sur la Question de la technique
Nous observons toutefois que la source de la norme s’est déplacée. Nietzsche voyait le problème de la norme dans le désir de Platon de réduire la vérité à la logique et ne jamais être incohérent. C’est un affront à la nature et à la biologie et c’est pourquoi il nous enjoint de revenir au corps. Or, la technologie, quand elle se fait flatterie sophistique, se sert de nos plus bas instincts biologiques pour nous offrir le confort et tend elle aussi au nivellement, à la normalisation. Le vrai, le juste, le beau… peu importe nous dit la publicité. Venez comme vous êtes. “Chacun a sa propre vérité et tout le monde est beau à sa façon, car les systèmes normatifs sont toujours faux”. Le système nivelle et tend vers la moyenne. C’est une normalisation qui advient d’elle même par la destruction des normes. Entre Platon et Gorgias, il n’y a peut-être pas à choisir, car ils incarnent peut-être chacun un archétype à éviter, celui du prêtre et celui du bourgeois. Toutefois, une autre lecture oblige à voir que Platon pointe du doigt un danger réel qui menace les bonnes natures comme Calliclès ; celui de voir les marchands devenir les maîtres de la cité et du temple, par l’usage d’un art dévoyé. Pour être un surhomme nietzschéen, c’est-à-dire un César avec l’âme du Christ, Calliclès aurait du rejetter à la fois Platon et Gorgias.
Heidegger nous enjoint alors, non pas à aller contre la technologie, mais à poser un regard différent sur elle. Cela passe pour lui par la poésie. En cela, il me semblait tout indiqué de commencer cette sélection par le Chant XVIII de l’Iliade où Homère décrit comme Héphaïstos confectionne pour Achille le bouclier qu’il emmènera dans son combat contre Hector. La description ne se contente pas d’évoquer l’aspect utilitariste et la qualité du bouclier pour remplir la tâche de protection. Homère utilise pas moins de 130 vers pour expliquer dans le détail comment Héphaïstos fait littéralement jaillir un monde.
Heidegger n’est pas fataliste, mais il est conscient que les questions qu’on se pose sur l’essence de la technique arrivent toujours trop tard.
L’Arraisonnement est ce qui rassemble cette interpellation, qui met l’homme en demeure de dévoiler le réel comme fonds dans le mode du « commettre ». En tant qu’il est ainsi pro-voqué, l’homme se tient dans le domaine essentiel de l’Arraisonnement. Il ne pourrait aucunement assumer après coup une relation avec lui. C’est pourquoi la question de savoir comment nous pouvons entrer dans un rapport avec l’essence de la technique, une pareille question sous cette forme arrive toujours trop tard.
—Martin Heidegger, Sur la Question de la technique
Nietzsche ne parle jamais de technologie telle qu’on l’entend aujourd’hui, comme le fera après lui Heidegger, mais on comprend ainsi la filiation que ce dernier entretien avec son ainé. Il existe chez Nietzsche la morale d’esclave et la morale de maîtres comme il existe chez Heidegger deux techniques, la technè grecque authentique et la technologie moderne inauthentique. La morale d’esclave s’oppose aux natures fortes et la technologie moderne favorise un dévoilement inauthentique de l’Être, car elle ont la même racine. La morale d’esclave est peut-être la première technologie inauthentique ayant pour aboutissement le nihilisme technologique du Gestell. C’est ce basculement qui ouvre la voie au techno-capital de Nick Land qui repose sur l’histoire du capitalisme.
Remerciement spécial à @Athens_Stranger dont la série d’explications philosophiques sur la technologie et le nihilisme ont en partie guidé le choix de la sélection des textes présentés dans ce recueil, ainsi que la réflexion menée dans l’introduction les présentant. Je vous encourage à vous inscrire à son site Athens Corner qui regorge de contenus d’une qualité rare.